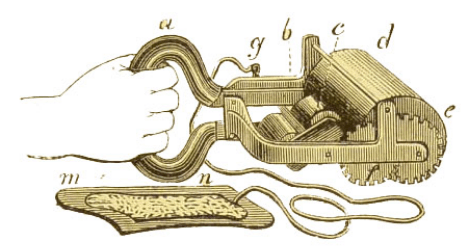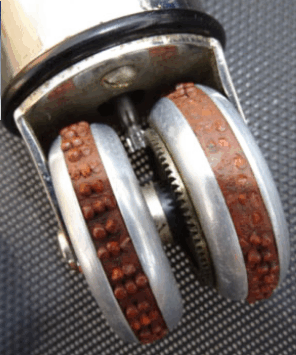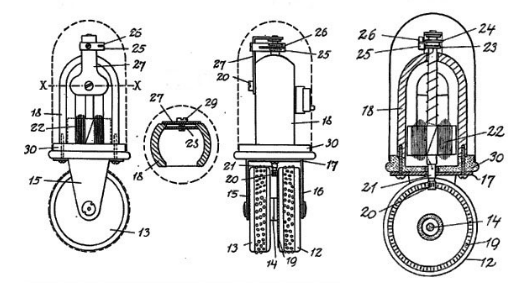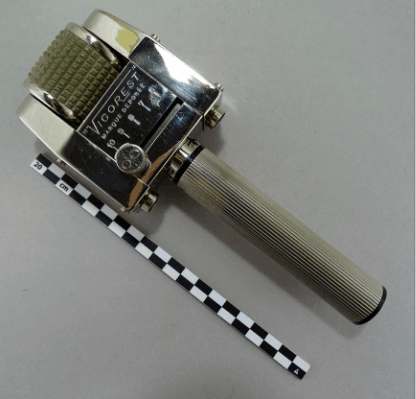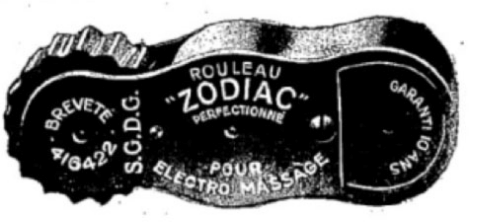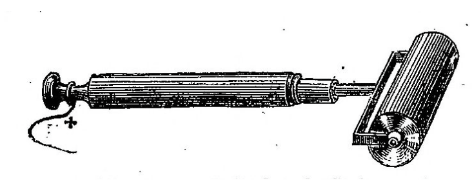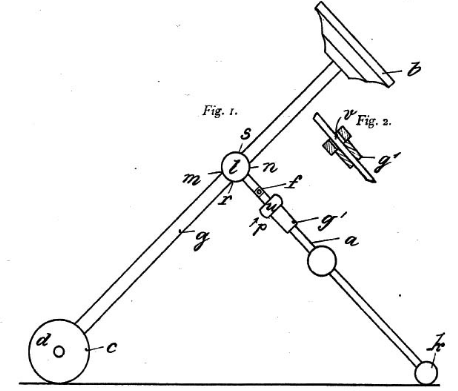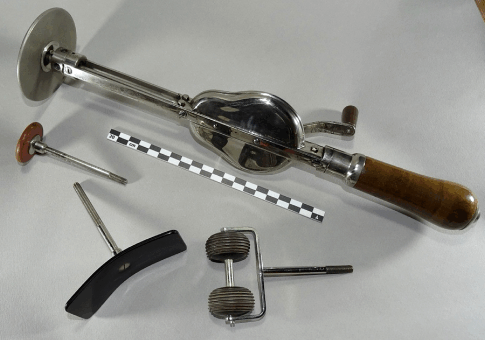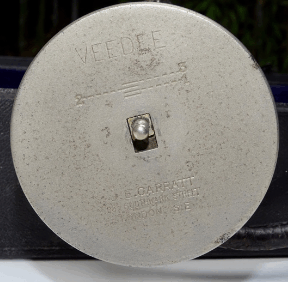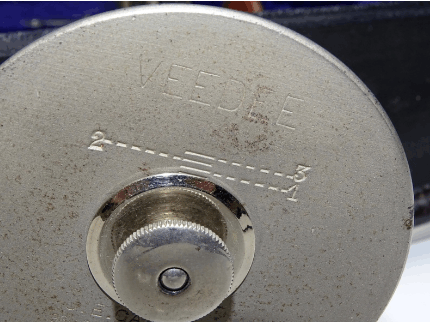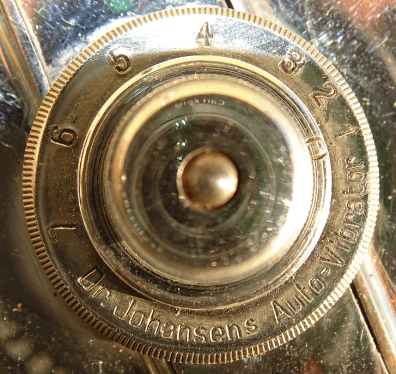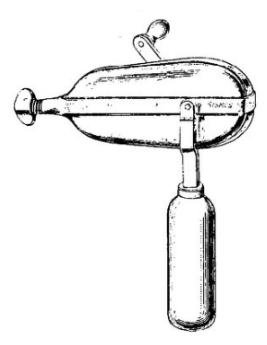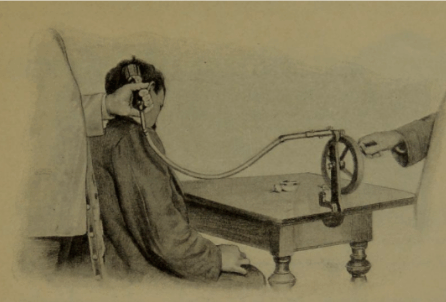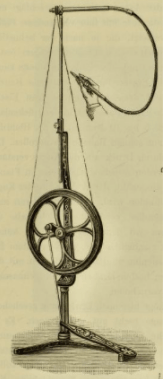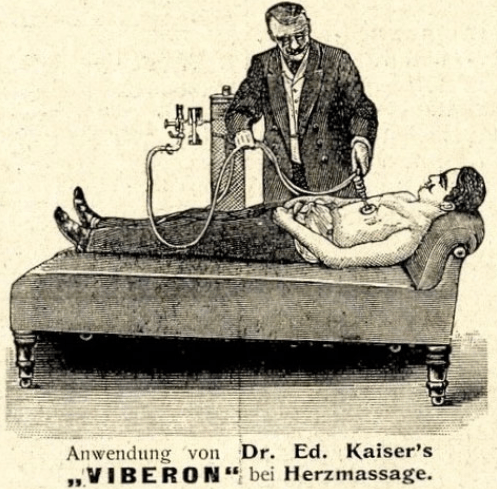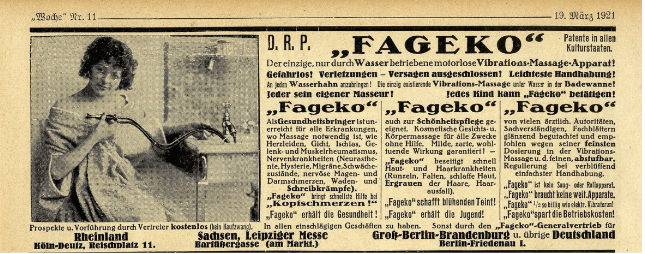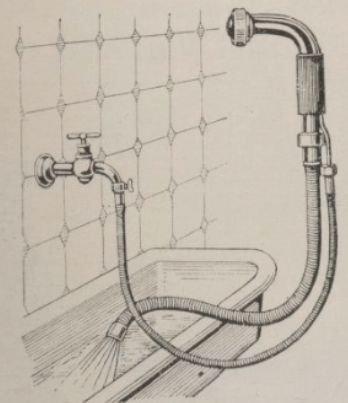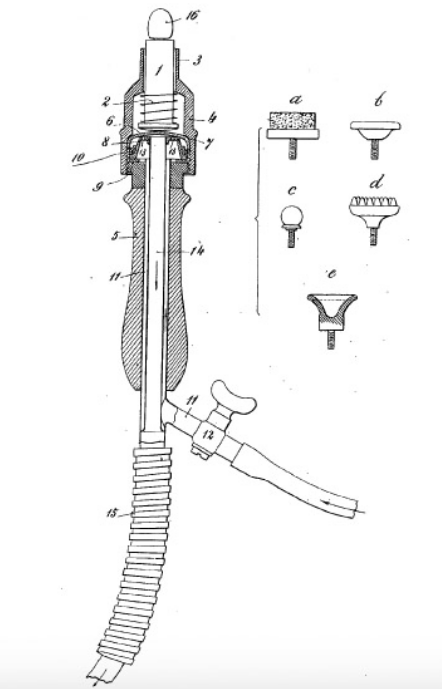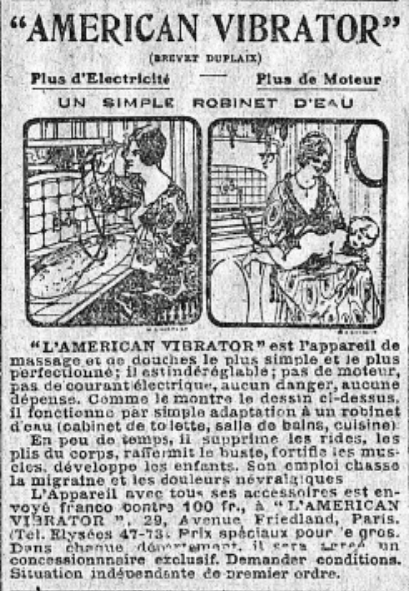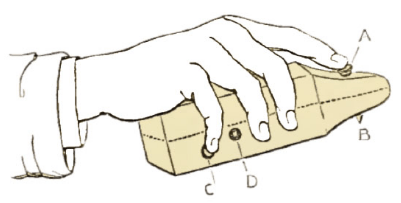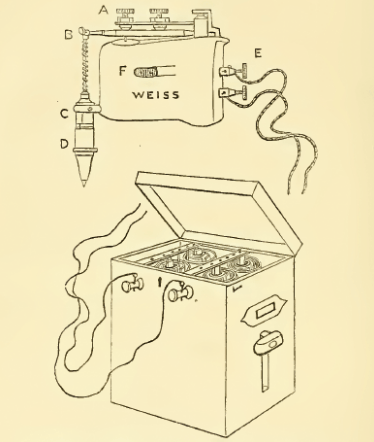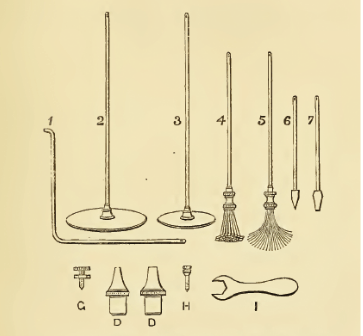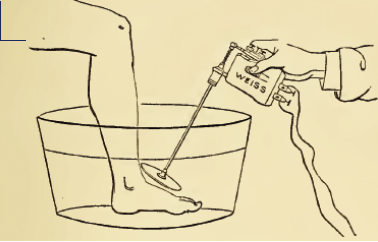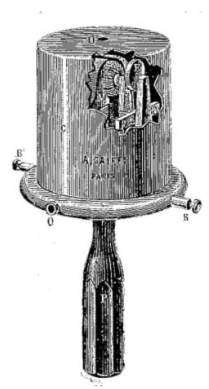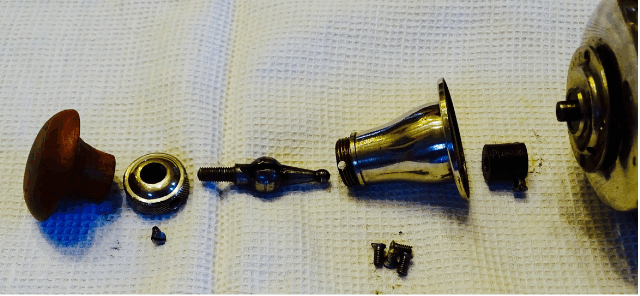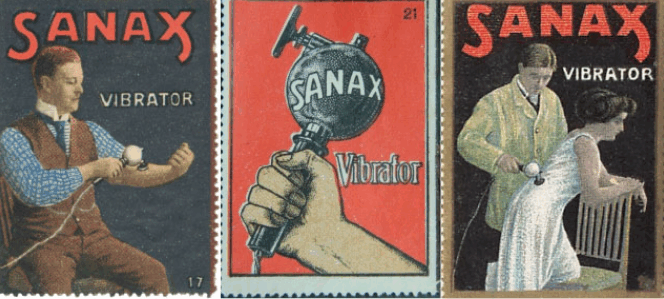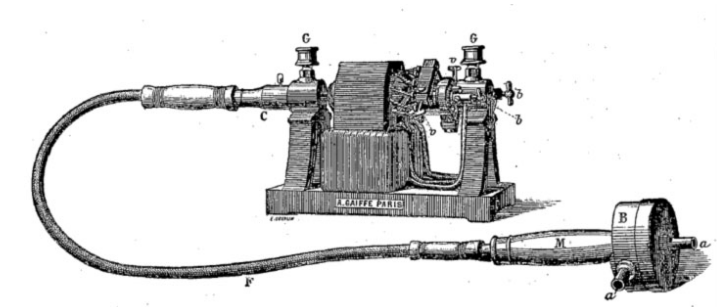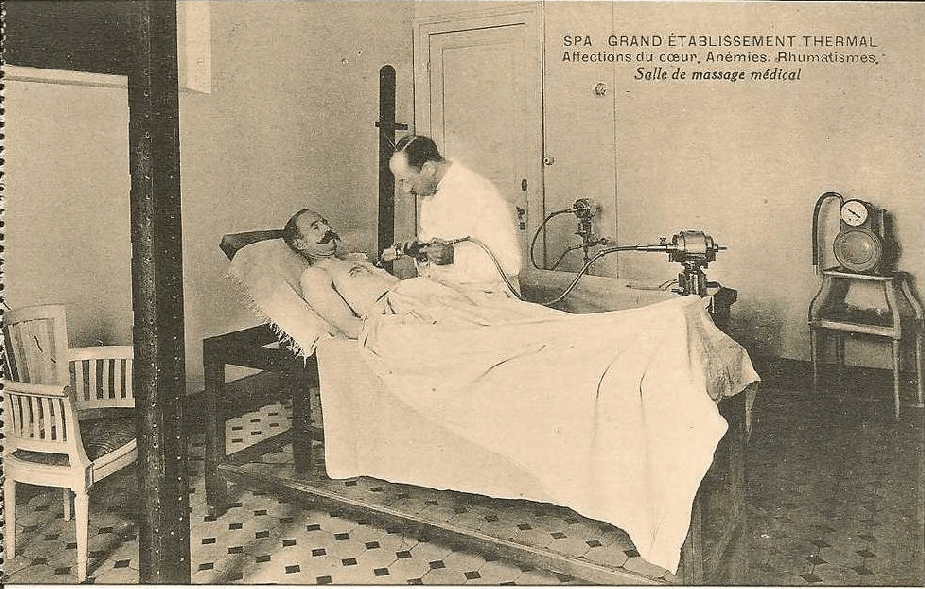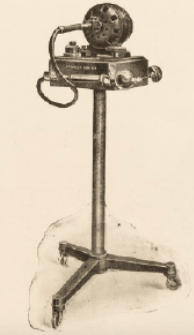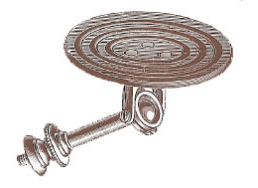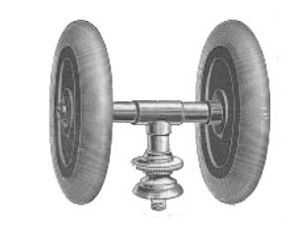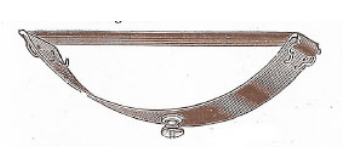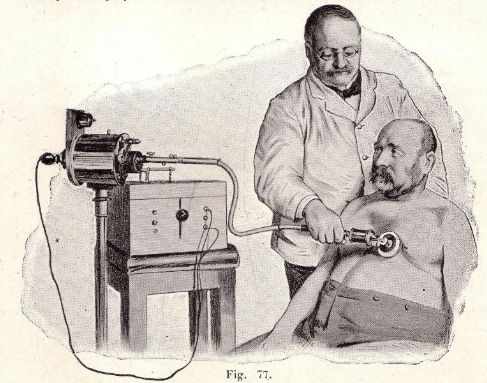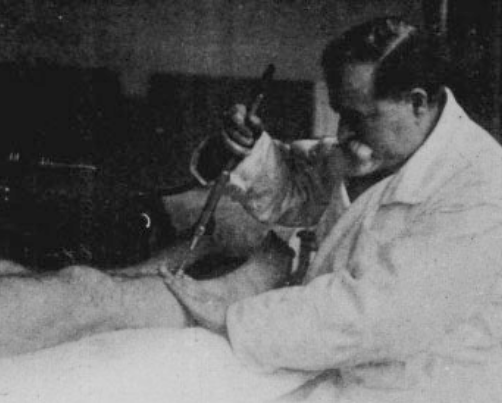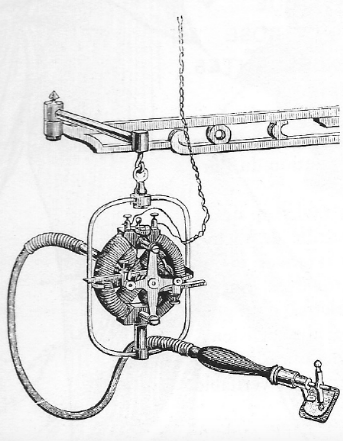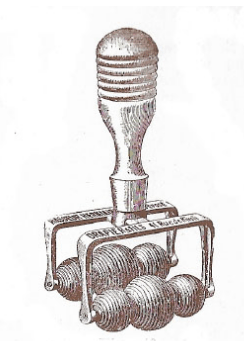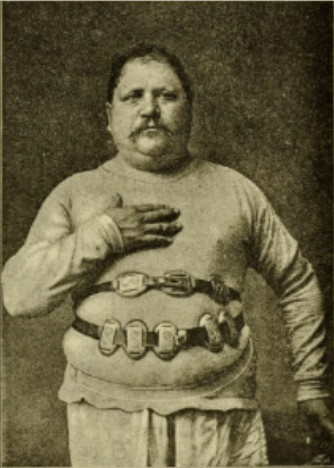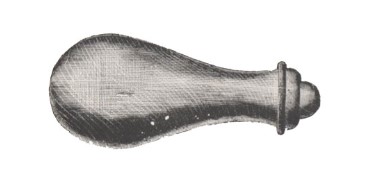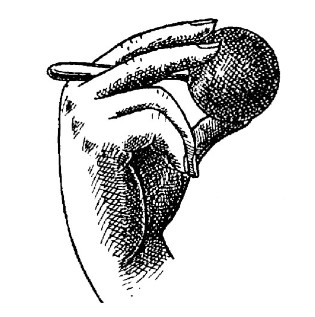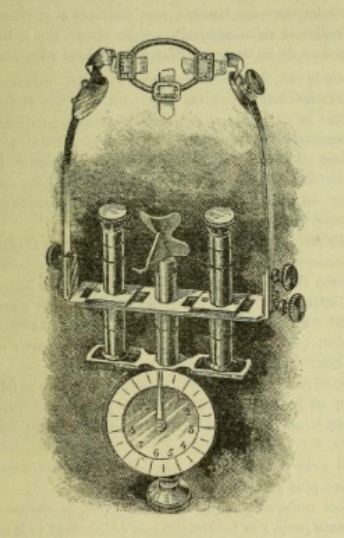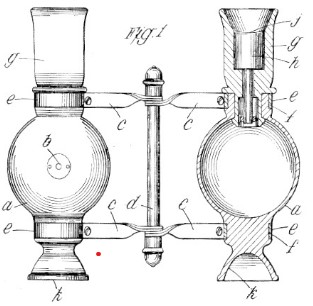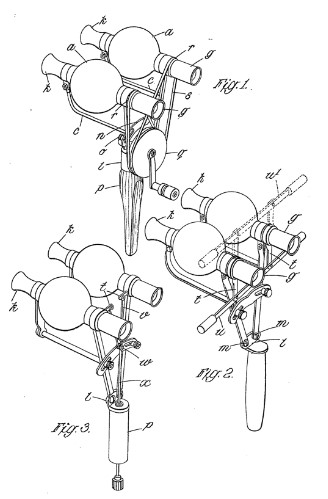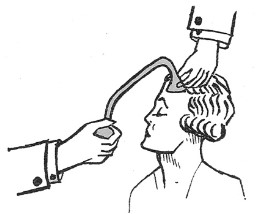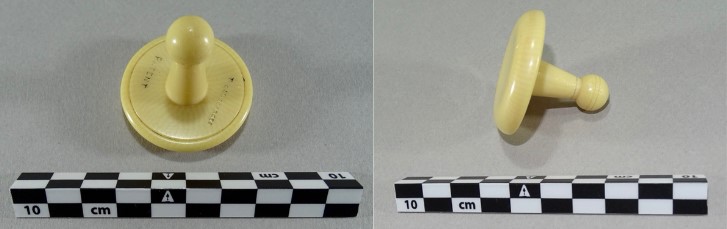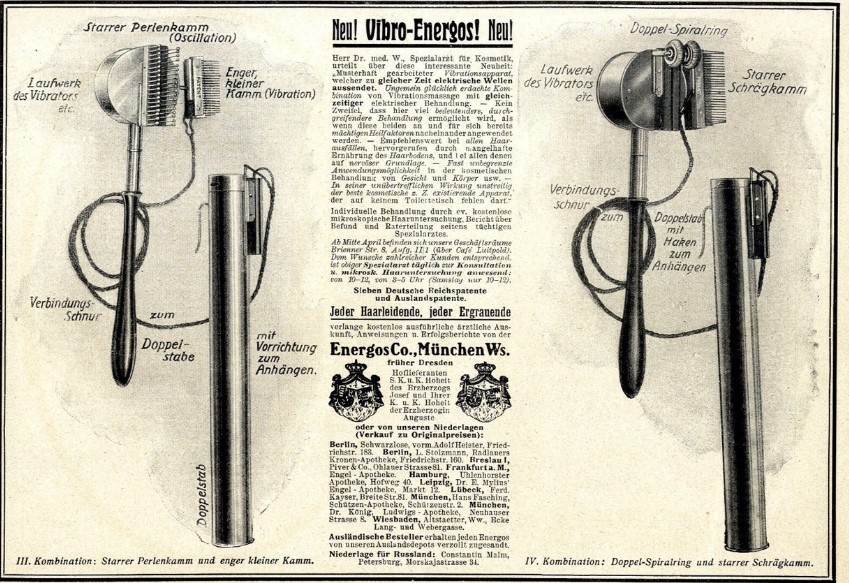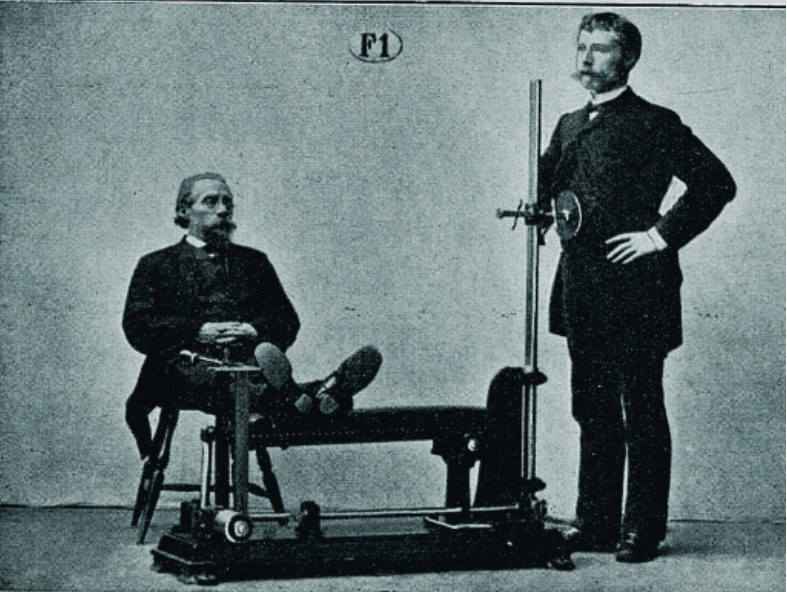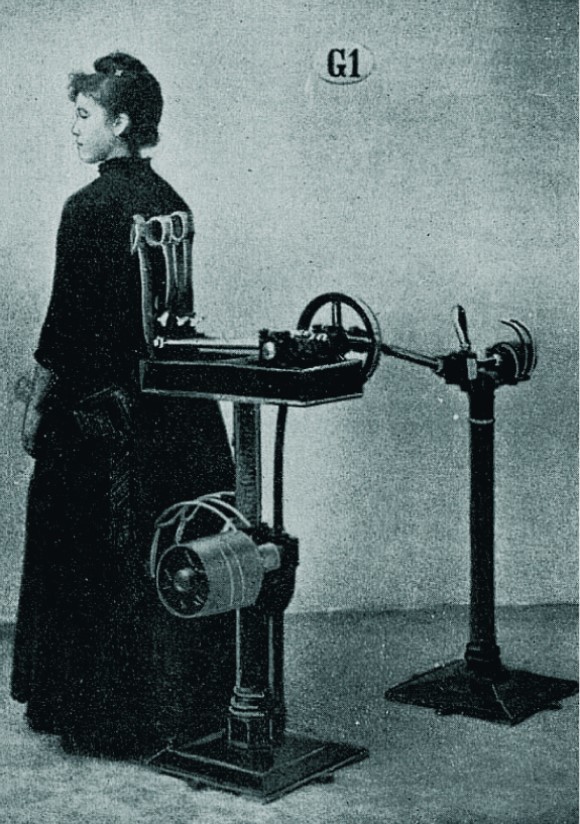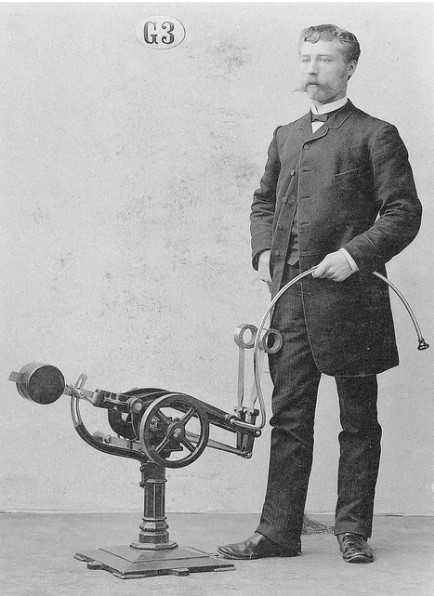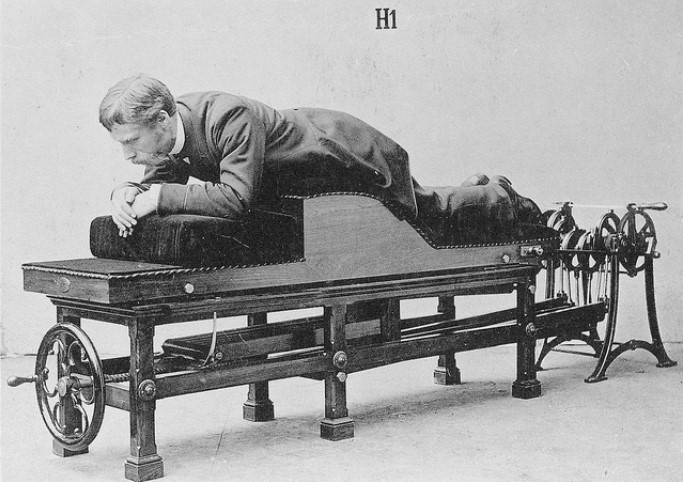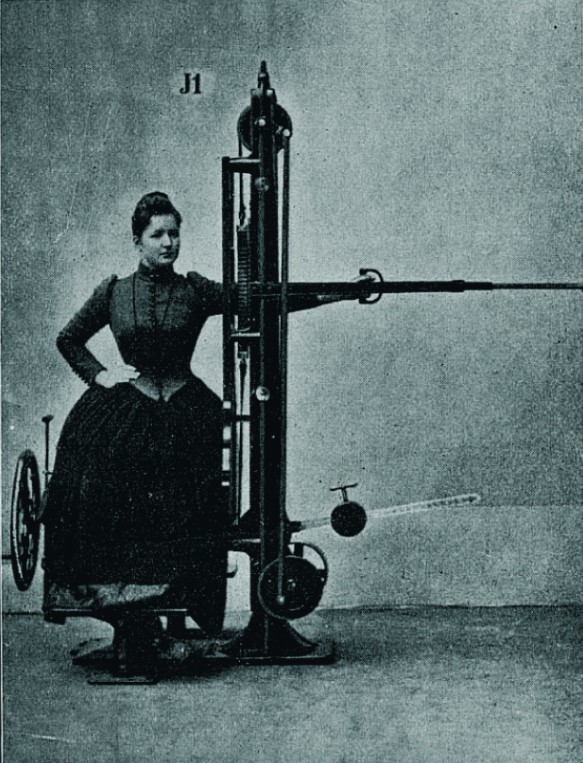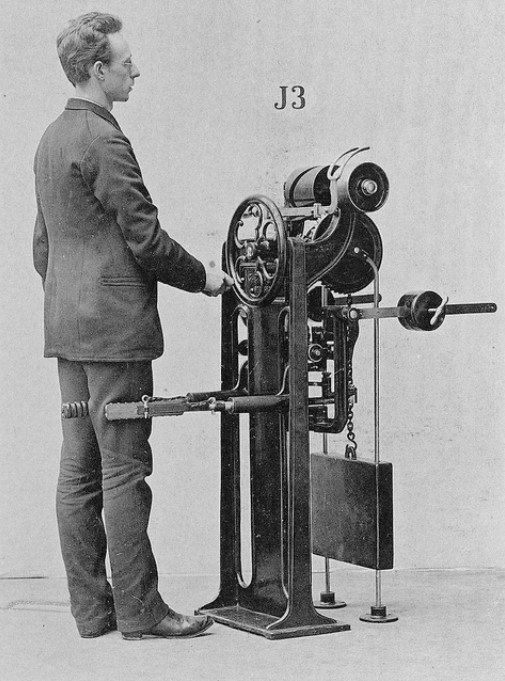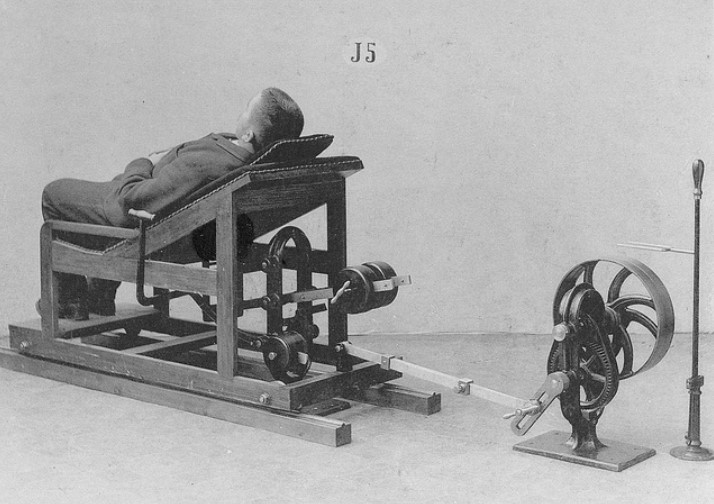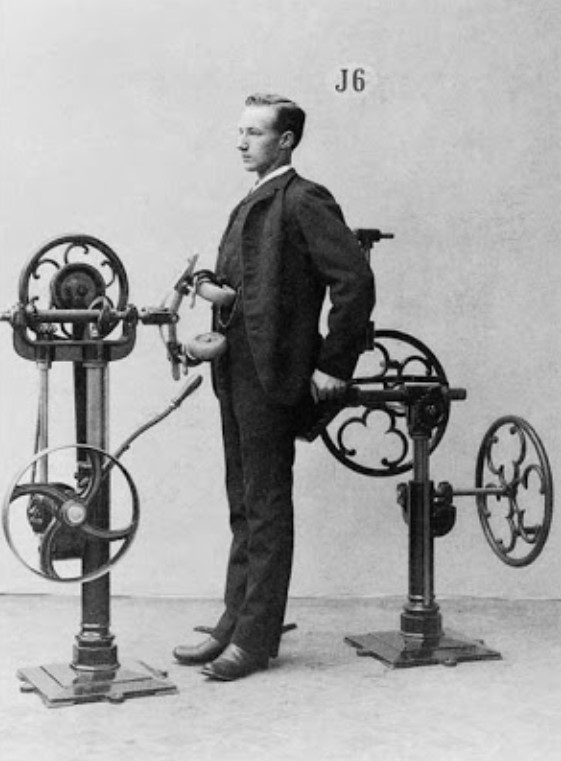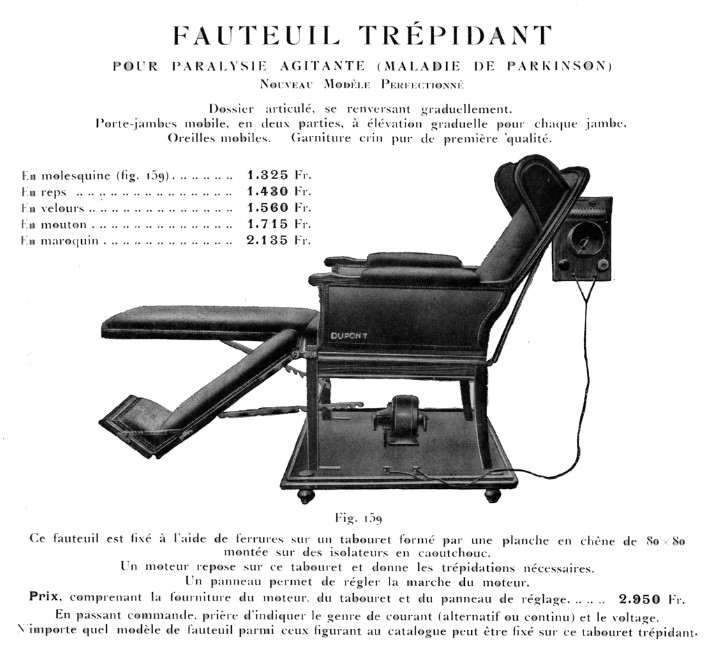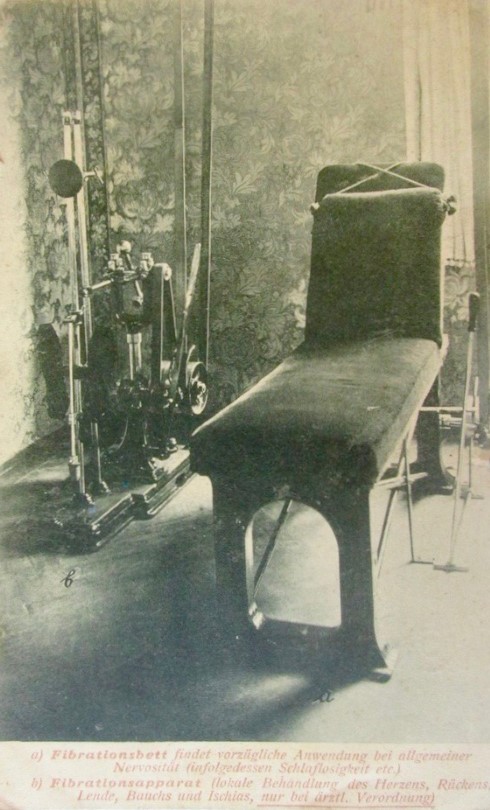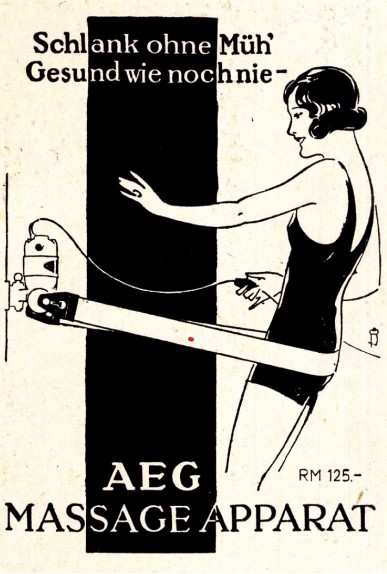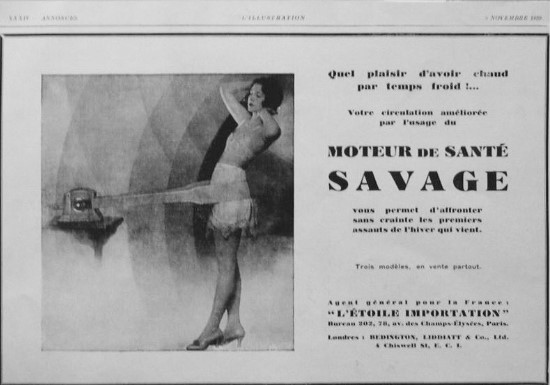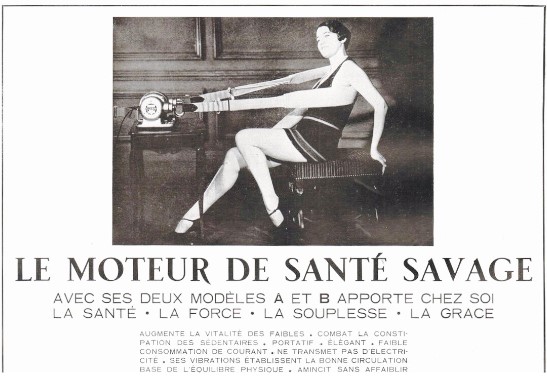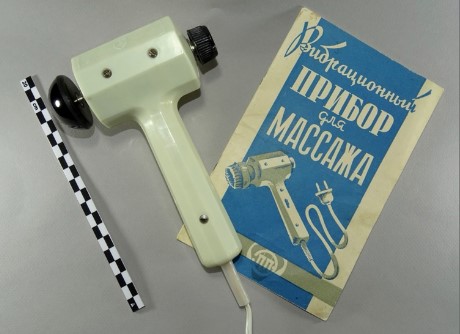Restitution de textes :
(Complète, en cours) par Alain
Cabello-Mosnier le vendredi 11 février
2022.
Dernière mise à jour : .
Je
vous restitue ce mémoire rédigé par Bernard
Petitdant dans le cadre d'un DU d’Histoire de la Médecine,
Université de Paris. L'auteur a eu la bienveillance non seulement
de me laisser restituer ici ce travail auquel j'ajoute tout un canevas
de liens hypertextes mais aussi de citer le CFDRM
de Paris ainsi que le parèdre
(dieu subalterne) que je suis devenu pour cette délicieuse
initiative.
Je
rappelle que ce travail est un acte d'amour à l'attention
du massage
complètement désintéressé duquel je
ne tire aucune rétribution n'ayant à mon actif aucun
livre à vendre.
J'aime
regarder le CFDRM comme un merveilleux châteaux construit
au bord d'une falaise friable au bas de laquelle le temps le précipitera
le temps venu.
Selon
la grille habituelle de notre site, je vous rassemble ci-dessous,
la liste des noms propres et parfois communs que Bernard Petitdant
cite mais aussi les ouvrages auxquels il se réfère.
Les liens violets renvoient à
des liens au sein du présent site, les bleus
ou cette flèche  évoquent une navigation externe à ce travail
et ce que je mes en gris entre parenthèses [Note du CFDRM]
est une précision que j'apporte. Conformément à
l'usage sur le CFDRM, le mot massage et ceux qui lui sont
associés, seront mis en gras.
évoquent une navigation externe à ce travail
et ce que je mes en gris entre parenthèses [Note du CFDRM]
est une précision que j'apporte. Conformément à
l'usage sur le CFDRM, le mot massage et ceux qui lui sont
associés, seront mis en gras.
198 Noms propres cités : Anne (in memoriam) p. 1 ; Adelon Nicolas
Philibert p. 16 ; Amar J. p. 29 ;
Amiot J.
p. 43 ; Amorós Franciscop. 27 ;
Andry de Boisregard Nicolas  p.
24 ; Brousses J. p.
57 ; Archambaud p.
29 ; Avicenne
p. 45 ; Ballexserd p.
24 ; Barcklay J. p.
33 ; Boyer Achille Barthélémy
p. 63 ; Basedow Johann Bernhard p.
24 ; Brousses J. p.
57 ; Archambaud p.
29 ; Avicenne
p. 45 ; Ballexserd p.
24 ; Barcklay J. p.
33 ; Boyer Achille Barthélémy
p. 63 ; Basedow Johann Bernhard  p. 21 ; Beethoven p. 21 ; Begin p.
27 ; Bell J. ; Bergman p. 75, 80
; Berne G.
p. 30 ; Bilz F.E. p.
75 ; Bois-Reymond Emil Heinrich
(du) p. 38 ; Bourneville
p. 30 ; Bouvier Sauveur Henri Victor p. 25 ; Brandebourg Frédéric-Guillaume
(de)
p. 21 ; Beethoven p. 21 ; Begin p.
27 ; Bell J. ; Bergman p. 75, 80
; Berne G.
p. 30 ; Bilz F.E. p.
75 ; Bois-Reymond Emil Heinrich
(du) p. 38 ; Bourneville
p. 30 ; Bouvier Sauveur Henri Victor p. 25 ; Brandebourg Frédéric-Guillaume
(de)  p. 20 ; Brichieri Comombi L., p. 107 ; Brousses
p. 95 ; Bum p.
71 ; Calvert R.N. p. 41 ;
Cheek J. p. 29 ; Busch F. p.
22 ; Charcot p. 153 ;
Choul G. (du) p. 62 ; Cleoburey W.
p. 33 ; Coghill-Hawkes Mary p.
34 ; Coulon p.
62 ; Coury Ch. ; Brier P. p.
25 ; Alain Cabello-Mosnier p. 4 ; Cecil T. p.
58 ; Lucas-Championnière J. p. 30
; Dagron
G. p. 17 ;
Defrance J.
p. 25 ; Delpech Jacques Mathieu
p. 20 ; Brichieri Comombi L., p. 107 ; Brousses
p. 95 ; Bum p.
71 ; Calvert R.N. p. 41 ;
Cheek J. p. 29 ; Busch F. p.
22 ; Charcot p. 153 ;
Choul G. (du) p. 62 ; Cleoburey W.
p. 33 ; Coghill-Hawkes Mary p.
34 ; Coulon p.
62 ; Coury Ch. ; Brier P. p.
25 ; Alain Cabello-Mosnier p. 4 ; Cecil T. p.
58 ; Lucas-Championnière J. p. 30
; Dagron
G. p. 17 ;
Defrance J.
p. 25 ; Delpech Jacques Mathieu  p. 25 ; Desessartz
p. 25 ; Desessartz  p.
24 ; Desseaux A. p. 25 ; Détert
Rudolf p. 70 ; Deville E.
p. 58 ; Dowse Stretch Th.
p. 17 ; Drapier p.
75 ; Dujardin-Beaumetz G. p. 17 ; Dumas J.L. p.
21 ; Anquetil Duperron A-H. p. 15
; Duplaix Amable p. 111 ; Dupont
p. 153 ; Duval Vincent p.
25 ; Eiger J. p. 65 ; El Boujjoufi
T. p. 25 ; Estradère J. p. 14,
p. 15, p. 16, p. 17... ; Eulenburg Moritz
p. 23 ; Fabiani-Salmon Jean-Noël Prof. p. 4 ;
Fabre
p. 29 ; Flashar
pp. 62,70 ; Fallen C p.
144 ; Fleissner Heinrich p. 87 ;
Frank Johann
Peter p.
24 ; Desseaux A. p. 25 ; Détert
Rudolf p. 70 ; Deville E.
p. 58 ; Dowse Stretch Th.
p. 17 ; Drapier p.
75 ; Dujardin-Beaumetz G. p. 17 ; Dumas J.L. p.
21 ; Anquetil Duperron A-H. p. 15
; Duplaix Amable p. 111 ; Dupont
p. 153 ; Duval Vincent p.
25 ; Eiger J. p. 65 ; El Boujjoufi
T. p. 25 ; Estradère J. p. 14,
p. 15, p. 16, p. 17... ; Eulenburg Moritz
p. 23 ; Fabiani-Salmon Jean-Noël Prof. p. 4 ;
Fabre
p. 29 ; Flashar
pp. 62,70 ; Fallen C p.
144 ; Fleissner Heinrich p. 87 ;
Frank Johann
Peter  p.
21 ; Fréderic Ier de Prusse p.
21 ; Fréderic Ier de Prusse
 p.
20 ; Fritz Libbie S. p. 83 ; Frumerie G.
p. 30 ; Garratt J.E. p.
98 ; Gautier J.
p. 17 ; Jan
van Geuns p. 43 ; George V (le Roi) p. 34 ; Georgii Carl August p. 28 ; Gibney J. M. D.
p. 33 ; Girard J.
p. 42 ; Göranssons Mekaniska Verkstadt ; Gower Ch.
p. 33, 73 ; Grafstrom A. V. A p.
41 ; Grose Jean-Henri
p. 15 ; Grosvenor
p. 33 ; Guérin Jules p. 25 ; Gutsmuths
p. 21 ; Guyenot P.
p. 40 ; Harel Claude p.
4 ; Henri Hartmann
p. 94/95 ; Hoerni B. p.
29 ; Hoffmann Friedrich
pp. 20, 21 ; Humbert François p.
25 ; Imbault-Huart M.J. ;
Jahn Friedrich
Lorinser
K.I. p.
23 ; Johansen p. 101 ; Johnson
W. p. 59 ; Kaiser Eduard p.
108 ; Katsch H. p. 98 ; Kellgren A.
; Kleen E.
p. 17 ; Klein B. p.
65 ; Klemm p. 68, 69, 70, 71, 72; Kouindjy
p. 95 ; Krügkula
p. 69 ; Labadie-Lagrave F. p. 95 ;
Lacroix de Lavalette Louis (de) p. 94
; Lagrange F.
. p. 18 ;
Laisné Napoléon p. 27
; Lardry J-M.
p. 18 ; Larousse P. p.
71 ; Latson W.R. p. 41 ; Le Betou
I.G.I. p. 16 ; Le Gentil
p. 15 ; Leca A-P. ; Legueu F.. p. 95 ; Paul Lehmsted
p. 139 ; tHansson N. p.
40 ; Hildur Ling
p.37 ; Ling Hjalmar p.
28 ; Ling
Pehr Henrik p.
20 ; Fritz Libbie S. p. 83 ; Frumerie G.
p. 30 ; Garratt J.E. p.
98 ; Gautier J.
p. 17 ; Jan
van Geuns p. 43 ; George V (le Roi) p. 34 ; Georgii Carl August p. 28 ; Gibney J. M. D.
p. 33 ; Girard J.
p. 42 ; Göranssons Mekaniska Verkstadt ; Gower Ch.
p. 33, 73 ; Grafstrom A. V. A p.
41 ; Grose Jean-Henri
p. 15 ; Grosvenor
p. 33 ; Guérin Jules p. 25 ; Gutsmuths
p. 21 ; Guyenot P.
p. 40 ; Harel Claude p.
4 ; Henri Hartmann
p. 94/95 ; Hoerni B. p.
29 ; Hoffmann Friedrich
pp. 20, 21 ; Humbert François p.
25 ; Imbault-Huart M.J. ;
Jahn Friedrich
Lorinser
K.I. p.
23 ; Johansen p. 101 ; Johnson
W. p. 59 ; Kaiser Eduard p.
108 ; Katsch H. p. 98 ; Kellgren A.
; Kleen E.
p. 17 ; Klein B. p.
65 ; Klemm p. 68, 69, 70, 71, 72; Kouindjy
p. 95 ; Krügkula
p. 69 ; Labadie-Lagrave F. p. 95 ;
Lacroix de Lavalette Louis (de) p. 94
; Lagrange F.
. p. 18 ;
Laisné Napoléon p. 27
; Lardry J-M.
p. 18 ; Larousse P. p.
71 ; Latson W.R. p. 41 ; Le Betou
I.G.I. p. 16 ; Le Gentil
p. 15 ; Leca A-P. ; Legueu F.. p. 95 ; Paul Lehmsted
p. 139 ; tHansson N. p.
40 ; Hildur Ling
p.37 ; Ling Hjalmar p.
28 ; Ling
Pehr Henrik  p.
23 ; Loder Wentworth p. 140;
Lloyd William p.
140; Londe
Charles p. 16 ;
Ludwig p.
23 ; Loder Wentworth p. 140;
Lloyd William p.
140; Londe
Charles p. 16 ;
Ludwig  p.
22 ; Lyons A.S. ; Macaura GJ.
p. 98 ; Malgaigne François p. 28
; Marcireau J.
p. 46 ; Marfort J. E.
pp. 95, 105 ; Martin JP. p.
98 ; Mcafee N.E.
p. 41 ; Meibomius J.H.
p. 65 ; Mesnard
p. 31 ; Milkman George W. p.
81 ; Monet
J. p. 29 ; Mortimer-Granville p. 107 ; Mudry Albert
p. 4
; Murrell p. 17, 18
; Muschike
Emil p. 116
; Nachtegall
p. 36/37 ; Napoléon p.
22 ; Natton p. 61 ; Neumann Albert
p. 23 ; Nicholls D.A. p. 29 ; Norström G.
p. 30 ; Paget Almeric p. 34 ;
Pallud Johan p. 4 ; Panckoucke
p. 16, 64, ; Paré A
p. 18 ; Petidant Bernard p.
1 ; Petit L.
p. 25, 68 ; Petrucelli R.J. ; Peytoureau
p. 137; Pfister G. p.
37 Piesen Julius p. 87; Piorry p. 16 ;
Phélippeaux M.V.A. p. 19 ; Ponge Charles p. 108 ; Pravaz Charles
p. 22 ; Pugh
John p. 33 ;
Quin G. p. 20 ;
Ravelden Henry,
dit Admiral Henry
p. 58 ; Récamier Joseph p.
75, 80,81; Régnier L.R. pp. 40,
95, 144; Reibmayr A.
p. 64, ; Remondiere R.
p. 29 ; Reveil Pierre-Oscar p. 16
; Rizet p. 65 ;
Rodeck C.G. p. 107 ; Romanelli L. p.
107 ; Rostan L. p. 16 ; Rothstein Hugo p.
22 ; Lyons A.S. ; Macaura GJ.
p. 98 ; Malgaigne François p. 28
; Marcireau J.
p. 46 ; Marfort J. E.
pp. 95, 105 ; Martin JP. p.
98 ; Mcafee N.E.
p. 41 ; Meibomius J.H.
p. 65 ; Mesnard
p. 31 ; Milkman George W. p.
81 ; Monet
J. p. 29 ; Mortimer-Granville p. 107 ; Mudry Albert
p. 4
; Murrell p. 17, 18
; Muschike
Emil p. 116
; Nachtegall
p. 36/37 ; Napoléon p.
22 ; Natton p. 61 ; Neumann Albert
p. 23 ; Nicholls D.A. p. 29 ; Norström G.
p. 30 ; Paget Almeric p. 34 ;
Pallud Johan p. 4 ; Panckoucke
p. 16, 64, ; Paré A
p. 18 ; Petidant Bernard p.
1 ; Petit L.
p. 25, 68 ; Petrucelli R.J. ; Peytoureau
p. 137; Pfister G. p.
37 Piesen Julius p. 87; Piorry p. 16 ;
Phélippeaux M.V.A. p. 19 ; Ponge Charles p. 108 ; Pravaz Charles
p. 22 ; Pugh
John p. 33 ;
Quin G. p. 20 ;
Ravelden Henry,
dit Admiral Henry
p. 58 ; Récamier Joseph p.
75, 80,81; Régnier L.R. pp. 40,
95, 144; Reibmayr A.
p. 64, ; Remondiere R.
p. 29 ; Reveil Pierre-Oscar p. 16
; Rizet p. 65 ;
Rodeck C.G. p. 107 ; Romanelli L. p.
107 ; Rostan L. p. 16 ; Rothstein Hugo
 p.
23 ; Rousseau
pp. 20, 21 ; Rowe W.H.
p. 17 ; Sachs
Stanislaus p. 95 ; Salzmann Christian-Gotthilf p.
23 ; Rousseau
pp. 20, 21 ; Rowe W.H.
p. 17 ; Sachs
Stanislaus p. 95 ; Salzmann Christian-Gotthilf
 p. 21 ; Santesson p.37
; Sartori Graziano p. 108
; Schreiber J.
pp. 55, 71 ; Seacombe Benjamin p. 91 ; Semerak
Josef p. 86 ; Semmelweis
Ignaz
p. 21 ; Santesson p.37
; Sartori Graziano p. 108
; Schreiber J.
pp. 55, 71 ; Seacombe Benjamin p. 91 ; Semerak
Josef p. 86 ; Semmelweis
Ignaz  p.
22 ; Simons Heinrich,
pp. 80, 118, 139; Spiess A.
p. 23 ; Stapfer Horace
p.31 ; Sibrower F.C. p. 107 ; Stresemann p.
22 ; Simons Heinrich,
pp. 80, 118, 139; Spiess A.
p. 23 ; Stapfer Horace
p.31 ; Sibrower F.C. p. 107 ; Stresemann
 p.
24 ; Terlouw T. p. 42 ;
Tissot C.-J.
p. 18 ; Thompson Edwin p.
92 ; Thooris A.
p. 18 ; de La Tourette Gilles. p. 153 ;
Vandermonde p.
24 ; Terlouw T. p. 42 ;
Tissot C.-J.
p. 18 ; Thompson Edwin p.
92 ; Thooris A.
p. 18 ; de La Tourette Gilles. p. 153 ;
Vandermonde  p.
24 ; Velter A. ; Verdier p.
24 ; Velter A. ; Verdier
 p. 24 ; Virchow Rudolf p.
38 ; Weber A.S.
p. 66 ; ; Westberg J. p.
37 ; Wischnewetzky L. p. 40, p. 143 ;
Zabludowski
pp. 65, 105 ; Zalkind Hélène p. 117
; Zalkind Issak Robert p.
116 ; Zander Gustav
pp. 39, 106 ; Zappulli 0. p.
107 ;
p. 24 ; Virchow Rudolf p.
38 ; Weber A.S.
p. 66 ; ; Westberg J. p.
37 ; Wischnewetzky L. p. 40, p. 143 ;
Zabludowski
pp. 65, 105 ; Zalkind Hélène p. 117
; Zalkind Issak Robert p.
116 ; Zander Gustav
pp. 39, 106 ; Zappulli 0. p.
107 ;
Noms des institutions cités :
– Université
de Paris - Faculté
de médecine de Paris
– Centre
Français de Documentation et de Recherche sur
le Massage : site http://www.cfdrm.fr
– Département
des Sciences de l’Education de Lambesc http://www.educaix.com
– Institut
de Formation de Masso-kinésithérapie de
Nice (IFMK) http://portail.unice.fr/jahia/Jahia/site/myjahiasite/pid/12544
Bibliographie citée par Bernard Petitdant
:
Chacun des noms propres
répertoriés plus haut renvoient dans leur
grande majorité à des ouvrages, mais ci-dessous,
nous ne citons plus que les noms associés à
un titre de livre déjà mentionné, augmenté des fonctions web, fiche technique, accès
aux dictionnaires. L'auteur en restitue la liste
en fin de Mémoire mais avec des redondances que
le CFDRM élimine.
Bibliographie francophone citée :
Lyons A.S.,
Petrucelli R.J. Histoire illustrée de la
médecine Paris : Presse de la Renaissance
; 1979
2 Perez
S. Histoires des médecins – Artisans et artistes
de la Santé de l’Antiquité à
nos jours Paris : Per rin ; 2018
Grmek M.D.
Histoire de la pensée médicale Antiquité
et Moyen-Age Paris : Seuil ; 1995
Imbault-Huart
M.J. La médecine au Moyen-Age à travers
les manuscrits de la Bibliothèque Nationale
Paris : Ed. de la Porte Verte ; 1983
Coury Ch.
La médecine de l’Amérique précolombienne
Paris : Roger Dacosta ; 1969
Leca A-P.
La médecine égyptienne au temps des
pharaons Paris : Roger Dacosta ; 1971
Velter A.,
Lamothe M.J. Les outils du corps Paris : Messidor-Temps
actuels ; 1984
Martin J.P.
Instrumentation chirurgicale et coutellerie en France,
des origines au XIXème siècle Paris
: L’Harmattan ; 2013
- L’histoire
des seringues, injecteurs et aspirateurs étudiés
comme modèle de l’évolution technologique
des instruments médicaux DU Histoire de la
Médecine Université Paris Descartes
2018
Bidault
P., Lepart J. Étains médicaux et pharmaceutiques
Paris : Ed. Ch. Massin ; sd
Renner Cl.
Histoire illustrée des étains médicaux
Paris : EGV Éditions 2011
Martin J.P.
L’instrumentation médico-chirurgicale en
caoutchouc en France XVIIIème, XIXème
siècle Paris : L’Harmattan ; 2013
-
Le Gentil Voyage dans les mers de l’Inde tome 1
Paris : Imprimerie Royale ; 1779
-
-
Estradère J. Du massage, son historique, ses manipulations,
ses effets thérapeutiques. Paris Adrien Delahaye
; 1863 TDM

Lardry J-M. Etude de l’ouvrage intitulé «
Du massage, son historique, ses manipulations, ses
effets thérapeutiques » du Dr Jean
Dominique
Joachim Estradère Kinesither Rev 2016 ; 16
(171) : 88-91
Gymnastique
médicinale et chirurgicale, ou essai sur
l'utilité du mouvement, ou des différents
exercices du corps, et du repos dans la cure des
maladies par Clément Joseph Tissot (1747-1826)
Piorry article « Massage » Une société
de Médecins et de chirurgiens Dictionnaire
des sciences médicales Tome 31 Paris : C.L.F.
Panckoucke ; 1819.
Rostan L. article « Massage » in Adelon,
Béclard, Biett, et al. Dictionnaire de Médecine
Tome 14 Paris : Béchet jeune ; 1826
- Formulaire
raisonné des médicaments nouveaux
Paris : J.B. Baillière ; 1864
Londe Ch. Gymnastique médicale ou l’exercice
appliqué aux organes de l’homme. Paris :
Croullebois ; 1821
- Londe Ch.
Bibliographie : Nouvelles preuves du danger des
lits mécaniques Archives générales
de médecine 1828 ; 1(16), 646-8
Reveil O. Formulaire raisonné des médicaments
nouveaux Paris : J.B. Baillière ; 1864 TDM 
Gautier J. Du massage ou manipulation appliqué
à la thérapeutique et à l'hygiène
Le Mans : Monnoyer ; 1880
Dagron G.
Le massage et la massothérapie : les frictions
aux masseurs, la massothérapie aux médecins
Paris : Masson ; 1900
-
Paré A Œuvres Lyon : Jean Grégoire ;
1664
Tissot C.-J. Gymnastique médicinale et chirurgicale,
ou essai sur l'utilité du mouvement, ou des
différents exercices du corps, et du repos
dans la cure des maladies Paris : Bastien ;
1780
Thooris A. Gymnastique et massage médicaux
Paris : G. Doin & Cie ; 1951 TDM 
Lagrange F. Les mouvements méthodiques et
la mécanothérapie Paris : Félix
Alcan ; 1899 TDM 
Phélippeaux M.V.A. Etude pratique sur les frictions et le
massage ou guide du médecin masseur Paris
: L’Abeille médicale ; 1870 TDM 
Dumas J.L.
Histoire de la pensée. Renaissance et Siècle
des Lumières Paris : Tallandier ;
1990
Quin G. Approche comparée des pratiques
médicales de « massage »
et de « gymnastique » à
la fin du XIXème siècle et au début du XXème
siècle (Angleterre, France, Allemagne, Suisse)
Histoire des sciences médicales 2014 ;
48(2) : 215-24
- Genèse et structure
d'un inter-champ orthopédique (première
moitié du XIXème siècle) : Contribution à
l'histoire de l'institutionnalisation d'un champ
scientifique. Revue d'histoire des sciences
2011 ; 64(2) : 323-47
- Le mouvement
peut-il guérir ? Les usages médicaux
de la gymnastique au XIXème siècle Lausanne : Editions
BHMS ; 2019
- Monet J., Quin G. Sauveur-Henri-Victor
Bouvier (1799–1877): orthopédiste, chirurgien
et promoteur de l’éducation physique Gesnerus
2013 ; 70(1) : 53–67
- Quin G. Jules
Guérin: brève biographie d’un acteur
de l’institutionnalisation de l’orthopédie
(1830–1850) Gesnerus 2009 ; 66(2) : 237–55
- Quin G., Monet J. De Paris a` Strasbourg : L’essor
des établissements orthopédiques et
gymnastiques (première moitié du XIXème
siècle) Histoire des Sciences médicales
2011 ; 45(4) : 369-79
- Quin G. A Professor of Gymnastics in
Hospital. Napoléon Laisné (1810-1896)
introduce Gymnastics at the « Hôpital
des Enfants malades » Staps 2009 ;
86(4) :79-91
Andry de Boisregard N. L'Orthopedie ou l'Art de prevenir et
de corriger dans les enfans les difformites du corps.
Le tout par des moyens a la porte´e des Peres
& des Meres, & de toutes les personnes qui
ont des enfans a` elever. Bruxelles : Georges
Fricx ; 1743 TDM  [1ère éd. 1741] [1ère éd. 1741]
Vandermonde
Ch.-A. Essai sur la manière de perfectionner
l'espèce humaine Paris : Vincent ;1756
Desessartz
J.Ch. Traité de l'éducation corporelle
des enfants en bas âge Paris : J. Th.
Hérissant ; 1760
Verdier J.
 Discours
sur l’éducation nationale, physique et morale
des deux sexes Paris : chez l’auteur ; 1772 Discours
sur l’éducation nationale, physique et morale
des deux sexes Paris : chez l’auteur ; 1772
Ballexserd
J. Dissertation sur l'éducation physique
des enfans depuis leur naissance jusqu'à
l'âge de puberté Paris : Vallat-La-Chapelle ;
1762
Desseaux A. François Humbert,
orthopédiste méconnu, initiateur du
traitement curatif des “boiteux” Histoire des sciences
médicales 2015 ; 49(3/4) : 381-92
Defrance J., Brier P., El Boujjoufi T.
Transformations des relations entre médecine
et activités Gesnerus 2013 ; 70/1 :
86–110
Petit L. Le massage par le médecin, physiologie,
manuel opératoire, indications Paris :
Alexandre Coccoz ; 1885 TDM 
Defrance J., Brier P., El Boujjoufi T.
Transformations des relations entre médecine
et activités Gesnerus 2013 ; 70/1 :
86–110
Lardry J.M. Étude de l’ouvrage
« Application de la gymnastique à
la guérison de quelques maladies avec des
observations sur l’enseignement actuel de la gymnastique »
de Napoléon-Alexandre Laisné. Kinesither
Rev 2016 ;16(174) : 63-6
Georgii A. Kinésithérapie ou Traitement
des maladies par le mouvement selon la méthode
de Ling Paris : Germer Baillière ; 1847 TDM 
Laisné N. Du massage, des frictions et manipulations
appliquées à la guérison de
quelques maladies Paris : Victor Masson et
fils ; 1868 *** * 
Lainé N. Application de la gymnastique
à la guérison de quelques maladies
avec des observations sur l’enseignement actuel
de la gymnastique Paris : Louis Leclerc ;
1865 TDM 
Monet J. La naissance de la kinésithérapie
Paris : Glyphe ; 2009
Petitdant B. Origines, histoire, évolutions
de la mesure de la force de préhension et des
dynamomètres médicaux Kinesither Rev 2017 ;
17(181) : 40-58
Petitdant B. Le goniomètre médical
au fil du temps Kinesither Rev 2016 ; 16(179) :
48-61
Amar J. Principes de rééducation
fonctionnelle Académie des sciences séance
du 19 avril 1915 CR hebdo Sciences 1915 ; 160 :
559-62
Hoerni B La loi du 30 septembre 1892 Histoire
des Scjences médicales 1998 ; 1(32) :
63-7
Quin G. Approche comparée des pratiques
médicales de »massage »
et de « gymnastique » à
la fin du XIX ème siècle et au début
du XXème siècle (Angleterre, France, Allemagne,
Suisse) Histoire des sciences médicales 2014 ;
48(2) : 215-24
Monet J. Emergence de la Kinésithérapie
en France à la fin du XIXème et au début
du XXème siècle Thèse Doctorat
Sociologie, Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Juin 2003
Remondiere R.
L'institution de la kinésithérapie en
France (1840-1946), Les Cahiers du Centre de Recherches
Historiques 12 | 1994, mis en ligne le 27
février 2009, consulté le 10 décembre
2020. URL : http://journals.openedition.org/ccrh/2753 ; DOI :
https://doi.org/10.4000/ccrh.2753
Ibid
Bourneville
Dr Manuel pratique de la garde-malade et de l’infirmière
Paris : Progrès médical ; 1889
Lucas-Championnière J. Traitement des fractures par le massage et
la mobilisation Paris : Rueff et Cie ; 1895
TDM 
Berne G.
Le massage manuel théorique et pratique Paris :
Rueff et Cie ; 1894 TDM 
Norström G.
Formulaire du massage Paris : JB Baillière ;
1895 TDM 
de Frumerie G.
La pratique du massage. Cours à l’usage des infirmiers
et infirmières Vigot : Paris ; 1901 TDM 
de Frumerie G. Cours de massage accessoire
des soins d’accouchements à donner aux femmes
enceintes et parturientes aux nourrices et nourrissons
Vigot : Paris ; 1904 TDM 
de Frumerie G. Le massage pour tous Indications
et technique du massage général Vigot
: Paris ; 1917 2ème éd. TDM 
de Frumerie G. Traitement manuel des déviations
pathologiques du rachis Vigot : Paris : 1924
de Frumerie G. La pratique du massage. Manuel
à l’usage des étudiants en médecine,
des infirmiers et infirmières, des candidats
au diplôme de l’état de masseur et de masseuse
Vigot : Paris ; 1941 TDM 
Monet J. Emergence de la Kinésithérapie
en France à la fin du XIXème et au début
du XXème siècle Thèse Doctorat
Sociologie, Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Juin 2003
Remondière R. La mécanothérapie
au temps de la Grande Guerre Revue historique des armées [En
ligne], 274 | 2014, mis en ligne le 18 juillet
2014, consulté le 11 décembre 2020. URL :
http://journals.openedition.org/rha/7969
de Genst H. Histoire de l'éducation
physique, tome II. Temps modernes et grands courants
contemporains Bruxelles : A. de Boeck ; 1949
Georgii C. Kine´sithe´rapie ou
Traitement des maladies par le mouvement selon la méthode
de Ling Paris : Germer Baillière ;
1847
Kellgren A.
Technique du traitement manuel suédois ( gymnastique
médicale suédoise) Paris : Maloine ;
1895
Göranssons Mekaniska Verkstadt : La
gymnastique médico-mécanique de Zander,
ses principes, ses applications suivis de quelques indications
sur la création d’établissements gymniques
d’après cette méthode – Stockholm :
Imprimerie royale, Norstedt
Zander G. : Notice sur la gymnastique
de Zander et l’établissement de gymnastique médicale
mécanique suédoise à Stockholm.
Paris : Imprimerie A. Reiff ; 1879
Guyenot P.. :
La mécanothérapie à l’institut
Zander d’Aix les Bains. Aix les bains : Imprimerie
Gérente ; 1904 TDM 
Regnier L.R. La Mécanothérapie,
application du mouvement à la cure des maladies.
Paris : J.P. Baillière ;1901
Wischnewetzky L. The mechanico-therapeutic
institute. Contributions to mechanico-therapeutics and
orthopedics Vol 1, N°1, New-York, Mechanico-therapeutic
and orthopedic Zander, 1891
Hansson N., Ottosson A. Nobel price for physical
therapy ? Rise,fall and revival of medico-mechanical
institutes Phys Ther 2015 ; 95(8) : 1184-94
Grafstrom A. V. A Text Book of Mechano-Therapy
(Massage And Medical Gymnastics) New-York : O.M.Foegri
& Co ; 1898
Mcafee N.E. Massage : An Elementary Textbook
For Nurses Pittsburgh : Reed & Witting Co ;
1917
Calvert R.N. The history of massage An illustrated
survey from around the world Healing Arts Press :
Rochester ; 2002
Latson W.R. Common disorders with rational
methods of treatment the Health Culture Company New-York
1904
Kellgren A.
The technic of Ling’s system of manual treatment Edinburg
& London : Y.J. Pentland ; 1890
Terlouw T. Roots of physical medicine, physical
therapy, and mechanotherapy in the Nederlands in the
19th century : a disputed area within the healcare
domain J Man Manipul Ther 2007 ; (15)2 : 23-41
Tissot C.-J. Gymnastique médicinale
et chirurgicale ou essai sur l'utilité du mouvement
ou des différents exercices du corps et du repos
dans la cure des maladies Paris : P., Bastien ;
1780
Amiot J.
Mémoires concernant l’histoire, les sciences,
les arts, les mœurs et les usages des Chinois Tome 4
Paris : Nyon ; 1779
Abu ‘Ali al-Husayn ibn ‘Abd Allah ibn Sina
dit Avicenne
Avicennæ Arabum Médicorum Principis Canon
Medicinæ, d’après la traduction latine
de Gérard de Crémone Venise : Juntas ;
1595 TDM 
Marcireau J. La médecine physique
secrets d’hier, techniques d’aujourd’hui Paris :
Le courrier du Livre ; 1965
Ibid
Ibid
Berne G.
Manuel pratique de massage Paris : J.B. Baillière
et fils ; 1908
Petit L. Le massage par le médecin,
physiologie, manuel opératoire, indications Paris :
Alexandre Coccoz ; 1885
Schreiber J.
Traité pratique de massage et de gymnastique
médicale, Paris : Octave Doin ; 1884 TDM *** *

Laisné N. Du massage, des frictions
et manipulations appliquées à la guérison
de quelques maladies Paris : Masson ; 1868
J. Brousses
Manuel technique de massage, Paris : Masson & Cie
; 1920 [probablement
la 5eme édition, la 1ère 1896 TDM *** *
 ] ]
Ibid.
Cecil T. Massage sèche London :
Simpkin, Marshall & Co ; 1888
Deville E.
Considérations sur le massage et son application
dans l'entorse Thèse Médecine Strasbourg :
Silbermann ; 1864 TDM 
Johnson W. The anatriptic art : a history
of the art termed anatripsis by Hippocrates, tripsis
by Galen, frictio by Celsus, manipulation by Beveridge,
and medical rubbing in ordinary language, from the earliest
times to the present day : followed by an account of
its virtues in the cure of disease and maintenance of
health, with illustrative cases London : Simpkin, Marshall,
& Co ; 1866
Ibid.
Cecil T. Massage sèche London :
Simpkin : Marshall & Co ; 1888
Natton Instruments et appareils de l’art
médical Paris : Imp Grandremy ; circa
1900
Coulon H. De l'usage des strigiles dans l'antiquité.
Mémoire lu le 18 avril 1895, au Congrès
des Sociétés Savantes à la Sorbonne
Cambrai : Régnier ; 1895
Du Choul G. Des bains et de la palestre,
Manuscrit rédigé entre 1546 et 1547 au
plus tard
Flashar Dr
Apparate zur Massage Centralblatt für Chirurgie
1886 ; 43 :745-7
Boyer A.B. Improvements in or relating to
massage apparatus or roller. Patent N°21123, date
of application 22nd Oct., 1901, accepter 23rd Nov,1901
His Majesty’s stationery office : Malcomson &
C° Ltd ; 1901
Drapier Catalogue bandages herniaires, ceintures,
bas pour varices, accessoires Paris : 1911
Une société de Médecins
et de chirurgiens Dictionnaire des sciences médicales
Article « Palette » Tome 39 Paris :
C.L.F. Panckoucke ; 1819
Ibid.
Reveil O.
Formulaire raisonné des médicaments nouveaux
Paris : J.B. Baillière ; 1864 TDM 
Reibmayr A.
Die Technik der Massage Leipzig & Wien : Franz
Deuticke ; 1892
Deville E.
Considérations sur le massage et son application
dans l'entorse Thèse Médecine Strasbourg :
Silbermann ; 1864 TDM 
Meibomius J.H. De l’utilité de la
flagellation dans la médecine et dans les plaisirs
du mariage et des fonctions des lombes et des reins
Paris : Mercier ; 1795
Klein B. D’un usage curieux en médecine.
Réflexions sur « De l’utilité
de la flagellation de J.H. Meibom »
Paris : Classiques Garnier ; 2016,
Ibid.
Rizet F. De la manière de pratiquer
le massage dans l'entorse Arras : A.Courtin ;
1864
Laisné N. Du massage, des frictions
et manipulations appliquées à la guérison
de quelques maladies Paris : Masson ; 1868
Eiger J. Zabludovski’s technik der massage
Leipzig : Georg Thieme ; 1911
Weber A.S.
Traité de la massothérapie Masson :
Paris ; 1891
Krafft Ch. Le massage des contusions et des
entorses fraîches Lausanne : George Bridel
& Cie ; 1895
Petit L.
Le massage par le médecin, physiologie, manuel
opératoire, indications Paris : Alexandre
Coccoz ; 1885 TDM 
Reibmayr A. Die Massage und ihre Verwethung
in den verschiedenen Disciplinen der praktischen Medizin
Wien : Toeplitz et Deuticke ; 1883
Reibmayr A. - Die Technik der Massage Wien :
Toeplitz et Deuticke ; 1884
Reibmayr
A. Die Technik der Massage Leipzig & Wien :
Franz Deuticke ; 1892
Berne G.
Le massage, manuel théorique et pratique Paris
: J.-B. Baillière et fils ; 1922 6eme ed. [TDM 1ère
Ed 1894 [TDM 1ère
Ed 1894  ] ]
Flashar Dr
Apparate zur Massage Centralblatt für Chirurgie
1886 ; 43 :745-7
Drapier Catalogue bandages herniaires, ceintures,
bas pour varices, accessoires Paris : 1911
Larousse P. Grand dictionnaire universel
du XIXème siècle tome2 Paris ; Larousse :
1867
Bum A. Mechanotherapie (Massage und Gymnastik)
Wien : Urban & Schwarzenberg ; 1893
Reece and Co The catalogue of drugs, or medicine
chest companion London : The Medical Hall, ; 1846
Gower Ch.
Auxiliaries to medicine in four tracts London :
Hatchard ; 1819
Flashar Dr Apparate zur Massage Centralblatt
für Chirurgie 1886 ; 43 :745-7
Bergman Dr. Le Visage et les soins à
lui donner. Le massage du visage "Récamier"
d'après le célèbre système
H. Simons, L'art
de rajeunir et d'embellir. Paris : La parfumerie
"Récamier" ;
1900
Drapier Catalogue bandages herniaires, ceintures,
bas pour varices, accessoires Paris : 1911
Bilz F.E. La nouvelle médication naturelle
: traité et aide-mémoire de médication
et d'hygiène naturelles Paris : F.E. Bilz ;
1899
Petitdant B. Des boules de massage. (article
in press) Kinesither Rev (2021), http://dx.doi.org/10.1016/j.kine.2021.02.006
Natton Instruments et appareils de l’art
médical Paris : Imprimerie Grandremy ;
circa 1900
Reibmayr A. Die Technik der Massage Leipzig
& Wien : Franz Deuticke ; 1892
Lacy L.R. An improved massaging device Patent
N° 393557, Application date, March 25th.1933 – accepted
June 8th.1933. His Majesty’s stationery office, Love
& Malcomson Ltd 1933
Bergman Dr Le visage et les soins à lui donner
: le massage du visage " Récamier "
Paris : Parfumerie Récamier ; 1900
Petitdant B. Massage et renforcement musculaire
dans les années 1920 : une lanière
à boules lisses couplée à un tendeur
de musculation Kinesither Rev 2019 ;20(219) :33-35
Milkman G.W. Combination massage roller and
exerciser Patent N°681331, application filed May
2, 1900, patented August 27, 1901. United States Patent
Office
Drapier Catalogue bandages herniaires, ceintures,
bas pour varices, accessoires Paris : Imprimerie
Chantenay ; 1911
Catalogue Manufacture d’Armes et Cycles de
St Etienne 1924 p. 193 Paris : Imprimerie Pigelet ;
1924
https://collection.sciencemuseumgroup.org.uk/objects/co140167/massager-germany-1880-1920-massager
https://www.bl.uk/business-and-ip-centre/articles/what-are-registered-designs
Fritze L.S. Massage instrument, Patent N°676604,
application filed March 19, 1900, patented June 18,
1901. United States Patent Office
Petitdant B. L’appareil de massage de P.
Semerak, pressions glissées et percussions Kinesither
Rev 2019;19(214):36–39
Semerak J. Improvements in massage and beating
apparatus for the human body. Patent 16362. Date of
application, 27th July, 1898 – Accepted 8th Oct., 1898.
Printed for Her Majesty’s Stationery Office, Malcomson
& C° Ltd, 1898
Semerak J. Massage apparatus Patent N°
634590 dated October 10, 1899 United States Patent Office
Fleissner H. Massage apparatus Patent N°
520160 Convention Date in Germany : Oct. 13, 1937,
Application date in United Kingdom : Oct. 13, 1938,
Completed specification accepted April 16, 1940. Leamington
Spa His Majesty’s stationary office 1940
Piesen J. Improvements in or relating to
massage apparatus Application date Sept. 3, 1928. N°
296676, complete accepted Jan. 31, 1929. His Majesty
stationery office Love & Malcomson 1929.
Ibid.
Martin JP. L'Elektroller Clystère
2011;2:2–3 www.clystere.com.
Petitdant B. L'Élektroller, massage
et électrothérapie Kinesither Rev 2018;18(197):56–58
Seacombe B. Magneto-electric massaging machine
Patent N° 12844, date of application, 1st June,
1909 – Complete specification left, 1st Dec., 1909 –
accepted 10 Mar., 1910. His Majesty stationery office,
Love & Malcomson, Ltd 1910
Thompson E. Improvements relating to magneto-electric
machines for massaging treatment Patent N° 223148,
date of application : April 3, 1924 – Complete
accepted : Oct. 16. 1924 –. His Majesty stationery
office, Love & Malcomson, Ltd 1924
Thompson E. Perfectionnement aux appareils
magnéto-électriques pour le massage Brevet
N° 579865 demandé le 7 avril 1924, délivré
le 14 août 1924, publié le 25 octobre 1924.
Office national de la propriété industrielle.
Imprimerie nationale.
Petitdant B. Le régénérateur
organique électromagnétique « SANITAS »
du Docteur Pion Clystère www.clystere.com
2020 ; 70 : 30-37
de Lacroix de Lavalette L. La Sismothérapie ou l'utilisation du
mouvement vibratoire en médecine générale
et particulièrement en thérapeutique gynécologique
Thèse Médecine Paris 1899 TDM 
Hartmann H.
Gynécologie opératoire Paris : Steinheil ;
1911 TDM 
Ibid.
Labadie-Lagrave F., Legueu F. Traité
médico-chirurgical de gynécologie Paris :
Félix Alcan ; 1904 TDM 
Kouindjy P. Précis de Kinésithérapie:
La mobilisation méthodique, la massothérapie,
la mécanothérapie, la rééducation,
l'éducation physique Paris : Maloine ;
1922
Régnier L.R. Mécanothérapie :
Application du mouvement à la cure des maladies
J.B. Baillière : Paris ; 1901 TDM 
Marfort J.E. Manuel pratique de massage et
de gymnastique médicale suédoise Paris :
Vigot ; 1907
Brousses J. Manuel technique de massage Paris :
Masson & Cie ; 1920
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Petitdant B. Le Vibrostat, appareil de massage
vibratoire Clystère www.clystere.com
2018 ; 63 : 4-16
Deutsche Reich, Reichpatentamt, Patenschrift
N°328245 Vibrationsapparat, Patentiert im Deutschem
Reiche vom 7 Februar 1919
Deutsches Reich, Reichpatentamt, Patenschrift
N°337035 Vibrationsapparat, Patentiert im Deutschem
Reiche vom 16 Oktober 1919
Deutsches Reich, Reichpatentamt, Patenschrift
N°432591 Vibrationsapparat, Patentiert im Deutschem
Reiche vom 29 April 1925
Deutsches Reich, Reichpatentamt, Patenschrift
N°337035 Vibrationsapparat, Patentiert im Deutschem
Reiche vom 16 Oktober 1919
Martin JP. Le Pulsoconn du Dr Macaura. Clystère
2013;19:14–8. www.clystere.com.
Petitdant B. Le Docteur Macaura et
son Pulsoconn, appareil de massage vibratoire Kinesither
Rev 2018;18(199):36–42
Macaura GJ. Vibrateur à action oscillatoire
pour massage et autres applications. Brevet No 439099,
demandé le 18 janvier 1912, délivré
le 29 mars 1912, publié le 5 juin 1912. Office
nationale de la propriété industrielle.
Imprimerie Nationale.
Macaura GJ. Appareil pulsateur pour massage
et autres applications. Brevet No 439100, demandé
le 18 janvier 1912, délivré le 29 mars
1912, publié le 5 juin 1912. Office nationale
de la propriété industrielle. Imprimerie
Nationale.
Ibid.
Macaura GJ. Improvements in and relating
to vibrators for massage or like treatments. Date of
application 6th Jul 1905. Patent No. 13932 7th Sept
1905. His Majesty's Stationery Office. Love & Malcomson
Garratt J.E. The Veedee and how to use it
London : Veedee Company ; sd
Katsch H. Haupt- Preisliste Fabrik chirurgischer
Instrumente, Orthopädisher Maschinen Bandagen und
Verbandstoffe Munschen 1906
Petitdant B. Le VEEDEE, appareil à
main pour le massage vibratoire Clystère (www.clystere.com)
2019 ; 69 :14-23
Petitdant B. Docteur Johansen et les quarante
brevets Clystère (www.clystere.com)
2020 ;71 :9-19
Johansen J.C. Anordning til anbringelse af
massagepelotter i vibratorer. Danskt Patent N°10863.
Patent udstedt den 12. Maj 1908, beskyttet fra den 8
Juli 1907
Johansen J.C. Dispositif de réglage
pour les pelotes de massage dans les instruments vibratoires.
Brevet d’invention N° 392106, demandé le
7 juillet 1908, délivré le 16 septembre
1908, publié le 18 novembre 1908. Imprimerie
Nationale
Petitdant B. Auto-vibrator du Docteur Johansen,
New American Vibrator, deux noms pour un même
instrument de massage vibratoire Kinesither Rev 2020 ;20(228) :33-6
Marfort J.E. Manuel pratique de massage et
de gymnastique médicale suédoise Paris :
Vigot Frères ; 1907
Eiger J. Zabludovski’s technik der massage
Leipzig : Georg Thieme ; 1911
Wendschuch C. Haupt Katalog Ausgabe Dresden :
Lehmannsche Buchdruckrei ;1910
Mortimer-Granville J. Nerve Vibration and
excitation London : J. & A. Churchill ;
1883
Rodeck C.G. Appareil de massage vibratoire
à air comprimé Brevet N° 463551 demandé
le 11 octobre 1913, délivré le 19 décembre
1913, publié le 26 février 1914. Office
national de la propriété industrielle.
Imprimerie nationale.
Sibrower F.C. Appareil pneumatique pour massage
vibratoire Brevet N° 782530 demandé le 22
août 1934, délivré le 18 mars 1935,
publié le 6 juin 1935. Office national de la
propriété industrielle. Imprimerie nationale.
Brichieri Comombi L., Zappulli 0., Romanelli
L. Dispositif pneumatique portatif pour massage vibratoire
Brevet N° 835726 demandé le 25 mars 1938,
délivré le 3 octobre 1938, publié
le 29 décembre 1938. Office national de la propriété
industrielle. Imprimerie nationale.
Historical makers of microscopes and microscope
slides http://microscopist.net
consulté le 29 janvier 2021
Berliner Adressbuch, https://digital.zlb.de
consulté le 29 janvier 2021
Ibid.
Sartori G. Device for mechanical skin treatment
or massage, Patent N°8726, date of application 27th
Apr., 1901, accepted 9th Jan. 1902. Printed for His
Majesty Stationery Office, Malcomson & Co Ltd, 1902.
Sartori G. Für Betrieb mittelst eines
gasförmigen Druckmittels eingerichtete Massiervorrichtung
Patent N° 22732 26 Juli 1901. Schweizerische Eidgenossenschaft
Sartori G. Apparatus for massaging, Patent
N°732897, application filed August 14, 1902, patented
July 7, 1903. United States Patent Office.
Sartori G. Massiervorrichtung Österreichische
patentschrift N°17826 Angemeldet am 16. Juli 1902
– Beginn der Patentdauer : 15 April 1904. Kais.
Königl. Patentamdt Ausgegeben am 10 OKtober 1904
Coliez G. La foire commerciale de Leipzig
en 1928 Revue industrielle 1928 ; 74 :601
Duplaix A. Appareil de massage Brevet N°
488311 demandé le 8 novembre 1917, délivré
le 18 juin 1918, publié le 20 septembre 1918.
Office national de la propriété industrielle.
Imprimerie nationale.
Le Matin N° 12980 du 12 septembre 1919,
page 4
Anonyme Revue de la publicité La Publicité
1919 ;140 :348
Brodart H. Catalogue illustré n°
10, Instruments de chirurgie, orthopédie Paris ;
1934
Catalogue de l’exposition du 3ème
congrès de Physiothérapie, Paris 29 mars-2
avril 1910. Imprimerie Aragno, Paris.
Rainal Frères Catalogue général
1825-1934 Paris : H.M. Boutin ; 1934
Mortimer-Granville J. Treatment of pain by
mechanical vibrations The Lancet 1881; 117(2999): 286-88
Mortimer-Granville J. Nerve Vibration as
a therapeutic agent The Lancet 1882 ; 119(3067) :
949-51
Mortimer-Granville J. Nerve Vibration and
excitation London : J. & A. Churchill ;
1883
Labadie-Lagrave F., Legueu F. Traité
médico-chirurgical de gynécologie Paris :
Félix Alcan ; 1904
Annuaire du commerce Didot-Bottin 1921, Tome
3, Rue de l’Université, Paris
Zalkind R.I. Appareil pour massage par tapotement,
fonctionnant à la main ou au moteur. Brevet d’invention
N° 464586, demandé le 22 octobre 1913, délivré
le 16 janvier 1914, publié le 25 mars 1914. République
Française. Office national de la propriété
industrielle
Zalkind R.I. Appareil électrique pour
massage vibratoire. Brevet d’invention N° 498484,
demandé le 18 avril 1919, délivré
le 20 octobre 1919, publié le 13 janvier 1920.
République Française. Office national
de la propriété industrielle.
Zalkind R.I. Appareil à massage vibratoire.
Brevet d’invention N° 502467, demandé le
9 août 1919, délivré le 21 février
1920, publié le 15 mai 1920. République
Française. Office national de la propriété
industrielle
Zalkind R.I. Appareil électrique pour
massage vibratoire. Brevet d’invention N° 498484,
demandé le 18 avril 1919, délivré
le 20 octobre 1919, publié le 13 janvier 1920.
République Française. Office national
de la propriété industrielle.
Petitdant B. Un appareil français
de massage vibratoire, production d’Issak Robert Zalkind
Kinesither Rev 2019 ; 19(216) : 60-3
https://brand-history.com/heinrich-simons-g-m-b-h-berlin-teltow/simo-vibrator/simo-vibrator-simo-vibrator-der-dauerhafteste-und-betriebssicherste-elektrische-hand-vibrator-unentbehrlich-fur-eine-erfolgreiche-schonheits-und consulté le 29 janvier 2021 et le
08/04/23
Petitdant B. Un appareil électrique
portatif de massage vibratoire Rupalley et Cie Clystere
2017 ; 60 : 6-18
Labadie-Lagrave F., Legueu F. Traité
médico-chirurgical de gynécologie Paris :
Félix Alcan ; 1904
Drapier Catalogue bandages herniaires, ceintures,
bas pour varices, accessoires Paris : 1911
Eiger J. Zabludovski’s technik der massage
Leipzig : Georg Thieme ; 1911
Ibid
Kouindjy P. Précis de Kinésithérapie:
La mobilisation méthodique, la massothérapie,
la mécanothérapie, la rééducation,
l'éducation physique Paris : Maloine ;
1922
Muschik E. Improvements in massage apparatus,
Patent N°8461, Date of application 9th Apr. 1898,
accepted 16th July, 1898. Printed for His Majesty Stationery
Office, Malcomson Ltd, 1898.
Muschik E. Massage device, Patent N°636163,
application filed June 6, 1898, patented October 31,
1899. United States Patent Office
Muschik E. Massage-apparat, Patentschrift
N°17778, 22. September 1898 Schweizeriche Eidgenossenschaft.
Muschik E. Massageapparat. Danskt Patent
N°1898. Patent udstedt den 28. Oktober 1898, beskyttet
fra den 17 Marts 1899
Anonyme Un nouvel appareil pour le massage
vibratoire L’Illustration 28 janvier 1939.
Drapier Catalogue bandages herniaires, ceintures,
bas pour varices, accessoires Paris : 1911
Ibid.
Petitdant B. Des boules de massage. (article
in press) Kinesither Rev (2021), http://dx.doi.org/10.1016/j.kine.2021.02.006
Reibmayr A. Die Technik der Massage Leipzig
& Wien : Franz Deuticke ; 1892
Anonyme La médecine qui guérit
: les panacées authentiques, les remèdes
infaillibles. Paris : Institut Biothérapic-Alexia ;
sd
Siffermann Dr. L’œil humain et ses anomalies
fonctionnelles guéries par le massage avec l’appareil
Dion Strasbourg : F. Staat ; 1899
Dion Ch., Goubaux Y. Appareil pour le traitement
des altérations de la vue Brevet N° 13073
- 20 août 1896 Bureau fédéral de
la propriété intellectuelle
Dion Ch. Improvements in apparatus for the
massage of the eyes for the cure of myopy, Patent N°10101,
Date of application 4th May. 1903, accepted 18th feb,
1904. Printed for His Majesty Stationery Office, Love
& Malcomson Ltd, 1904
Dion Ch. Système d’appareil perfectionné
pour la gymnastique rationnelle des yeux, pour la guérison
de la myopie et les altérations de la vue Brevet
N° 342985 demandé le 7 mai 1904, délivré
le 23 juillet 1904, publié le 22 septembre 1904.
Office National de la Propriété Industrielle.
Siffermann Dr. L’œil humain et ses anomalies
fonctionnelles guéries par le massage avec l’appareil
Dion Strasbourg : F. Staat ; 1899
Lacy L.R. Improved apparatus for massaging
the eyes Patent N° 363101, Application date, Nov
20th.1930 – Complete left, Aug 20th.1931 – accepted
Dec 17th.1931. His Majesty’s stationery office, Love
& Malcomson, Ltd 1932
Lacy L.R. Improved apparatus for massaging
the eyes Patent N° 434927, Application date, March
26th.1935 – accepted Sept 11th.1935. His Majesty’s stationery
office, Courier Press 1935
Peytoureau Dr. Manuel de face-massage Paris : Editions
Hygie ; 1936 TDM

Ibid.
Ibid.
Stumm M. Appareil pneumatique pour massage
facial Brevet N° 641449 demandé le 3 septembre
1927, délivré le 16 avril 1928, publié
le 3 août 1928. Office national de la propriété
industrielle. Imprimerie nationale.
Peytoureau Dr. Manuel de face-massage Paris : Editions
Hygie ; 1936 TDM

Goetze M., Simons H.
Massageapparat mit versetzt angeorducten cylindrischen
Walzen, Patentschrift N°9924, 28. Januar 1895 Schweizeriche
Eidgenossenschaft.
Simons H. Massageapparat mit cylindrischer
Walze, Patentschrift N°10625, 29. Juni 1895 Schweizeriche
Eidgenossenschaft.
Simons H. Massageapparat mit kugelförmigen
Massagerollen, Patentschrift N°10626, 29. Juni 1895
Schweizeriche Eidgenossenschaft
Simons H. Mit einem daumenartigen und einem
konischen Ende versehene Massagevorrichtung, Patentschrift
N°10702, 29. Juni 1895 Schweizeriche Eidgenossenschaft
Petitdant B. Un coffret d'instruments de
massage du XIXe siècle de Heinrich Simons Kinesither
Rev 2019;19(206):35-42
Bergman Dr. Le visage et les soins à
lui donner Le massage du visage "Récamier''
d'après le célèbre système
H. Simons, L'art de rajeunir et d'embellir Paris : La
parfumerie "Récamier'';
1900.
Lehmstedt P. Improvements in and relating
to massage apparatus Patent N° 6627, date of application,
18th Mar., 1902 – Complete specification left, 22nd
Nov., 1902 – accepted 5th Feb., 1903. His Majesty stationery
office, Love & Malcomson, Ltd 1903
Lloyd W., Loder W. An improved shaving appliance
Patent N° 27348, date of application, 1st Dec.,
1906 – Complete specification left, 12th Apr., 1907
– accepted 13th June 1907. His Majesty stationery office,
Love & Malcomson, Ltd 1907
Peytoureau Dr. Manuel de face-massage Paris : Editions
Hygie ; 1936 TDM

Lloyd W., Loder W. An improved device for
applying preparations to the skin Patent N° 19350,
date of application, 28th Aug., 1907 – accepted 7th
Nov. 1907. His Majesty stationery office, Love &
Malcomson, Ltd 1907
Göranssons Mekaniska Verkstadt La gymnastique
médico-mécanique de Zander, ses principes,
ses applications suivis de quelques indications sur
la création d’établissements gymniques
d’après cette méthode Stockholm :
Imprimerie royale, Norstedt et Söner ; 1896
Zander G. Notice sur la gymnastique de Zander
et l’établissement de gymnastique médicale
mécanique suédoise à Stockholm.
Paris, Imprimerie A. Reiff, 1879
Guyenot P.. :
La mécanothérapie à l’institut
Zander d’Aix les Bains. Aix les bains : Imprimerie
Gérente ; 1904 TDM  TDM TDM 
Göranssons Mekaniska Verkstadt La gymnastique
médico-mécanique de Zander, ses principes,
ses applications suivis de quelques indications sur
la création d’établissements gymniques
d’après cette méthode Stockholm :
Imprimerie royale, Norstedt et Söner ; 1896
Wischnewetzky L. The mechanico-therapeutic
institute. Contributions to mechanico-therapeutics and
orthopedics Vol 1, N°1, New-York : Mechanico-therapeutic
and orthopedic Zander ; 1891
Régnier L.R.:
La Mécanothérapie, application du mouvement
à la cure des maladies. Paris : J.P. Baillière ;
1901TDM 
Ibid.
Fallen C. : The Zander institute for
mechanico-therapeutics or swedish movements and massage
by machinery. New-York : circa 1890
Régnier L.R.: La Mécanothérapie,
application du mouvement à la cure des maladies.
Paris : J.P. Baillière ; 1901
Fallen C. : The Zander institute for
mechanico-therapeutics or swedish movements and massage
by machinery. New-York : circa 1890
Régnier L.R.: La Mécanothérapie,
application du mouvement à la cure des maladies.
Paris : J.P. Baillière ; 1901
Göranssons Mekaniska Verkstadt La gymnastique
médico-mécanique de Zander, ses principes,
ses applications suivis de quelques indications sur
la création d’établissements gymniques
d’après cette méthode Stockholm :
Imprimerie royale, Norstedt et Söner ; 1896
Zander G. Notice sur la gymnastique de Zander
et l’établissement de gymnastique médicale
mécanique suédoise à Stockholm.
Paris : Imprimerie A. Reiff ; 1879
Guyenot P. : La mécanothérapie
à l’institut Zander d’Aix les Bains. Aix les
Bains : Imprimerie Gérente ; 1904
Wischnewetzky L. The mechanico-therapeutic
institute. Contributions to mechanico-therapeutics and
orthopedics Vol 1, N°1, New-York : Mechanico-therapeutic
and orthopedic Zander ; 1891
Petitdant B. Les appareils de mécanothérapie
de Zander Clystère 2015 ; 36 : 13-33
Ibid.
Régnier L.R. La Mécanothérapie, application
du mouvement à la cure des maladies, J.P. Baillière
;1901 ParisTDM 
Ibid.
Ibid .
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid
Dupont Lits, fauteuils, voitures et appareils
mécaniques pour malades et bléssés.
Harambat : Paris ; circa 1925
Gilles de La Tourette G. Considérations
sur la médecine vibratoire, ses applications
et sa technique Nouvelle Iconographie de la Salpêtrière
1892 ; 5 : 265-75
Loi n°46-857 du 30 avril 1946 Réglementation
des professions de masseur gymnaste médical,
de masseur kinésithérapeute et de pédicure
Journal officiel de la République Française
1 mai 1946 p 3653
Macron A. La profession de masseur-kinésithérapeute
instituée par la loi n°46-857 du 30 avril
1946 genèse et évolutions d’une profession
de santé réglementée. Thèse
Faculté de Droit, Université de Montpellier
2015
Revues : Une société de Médecins
et de chirurgiens Dictionnaire des sciences médicales
Article « Palette » Tome 39 Paris :
C.L.F. Panckoucke ; 1819
Bibliographie anglophone et
autre, citée
Le Betou I.G.I. Therapeutic manipulation
or Medicina mechanica : a successful treatment of
various disorders of the human body, by mechanical
application. London : Simpkin, Marshall & Co
; 1851
Bell J. Mechanotherapy, Man and Machines
Physiotherapy 1994 ; 80(2) : 61-6
Kleen E. Handbook of massage Philadelphia :
Blakiston ; 1892
Dowse Stretch Th. Lectures on massage
& electricity in the treatment of disease (masso-electrotherapeutics)
London: Hamilton, Adams & Co ; 1889
Rowe W.H. Massage: A treatise on masso-electra-therapeutics
Hartlepool : Pearson & Bell ; 1898
Kleen E. Handbook of massage Philadelphia :
Blakiston ; 1892
Busch F. General orthopaedics, gymnastics
and massage in Von Ziemssen’s handbook of general
therapeutics vol.5 New-York : William Wood &
Co ; 1886
Frank J.P. System einer vollständigen
medicinischen Polizey Mannheim : Schwan ;
1784
Busch F. General orthopaedics, gymnastics
and massage in Von Ziemssen’s handbook of general
therapeutics vol.5 New-York : William Wood &
Co ; 1886
Lorinser K.I. Zum Schutz der Gesundheit
in den Schulen Berlin : Ludwig Hold ; 1836
Busch F. General orthopaedics, gymnastics
and massage in Von Ziemssen’s handbook of general
therapeutics vol.5 New-York : William Wood &
Co ; 1886
Spiess A. Turnbuch für Schulen als
Anleitung fiir den Turnunterricht durch die Lehrer
der Schulen 2vol. Bale : Schweighaufer’sche
Verlagsbuchhandlung ; 1847
Spiess A. Die Lehre der Turnkunst
4 vol. Bale : Schweighaufer’sche Verlagsbuchhandlung ;
1874
Busch F. General orthopaedics, gymnastics
and massage in Von Ziemssen’s handbook of general
therapeutics vol.5 New-York : William Wood &
Co ; 1886
Neumann A.C. Die Heil-gymnastick oder die Kunst die
Leibesübungen, angewandt zur Heilung von Krankheiten
Berlin : P.Jeanrenaud ; 1852
Eulenburg M. Die Schwedische Halgymnastik, Versuch
einer wissenschaftlichen Begründung derselben
Berlin : A. Hirschwald ; 1853
Murrell W. Massotherapeutics or Massage as a mode
of treatment Philadelphia : Blakiston, son
& C° ; 1890
Georgii A. A few words on kinesipathy or swedish
medical gymnastics. The application of active and
passive movements to the cure of diseases according
to the method of P.H. Ling London : Hippolyte
Bailliere ; 1850
Busch F.
General orthopaedics, gymnastics and massage in
Von Ziemssen’s handbook of general therapeutics
vol.5 New-York : William Wood & Co ; 1886
Pugh Jo
A physiological, theoric and practical treatise
on the utility of the science of muscular action
for restoring the power of the limbs London :
C. Dilly ; 1794
Barcklay J. The muscular motion of the human body
Edinburgh : W. Laing and A. Constable ;
1808
Cleoburey W. A full account of the system of friction,
as adopted and pursued with the greatest success
in cases of contracted joints and lameness, from
various causes Oxford : Munday and Slatter ;
1825
Gibney J. M. D.treatise on the properties and medical
application of the vapour bath: in its different
varieties and their effects : in various species
of diseased action London : Thomas and George
Underwood ; 1829 
Anonyme Immoral « massage »
establishment Br Med J 1894 ; 2: 88
Nicholls D.A., Cheek J. Physiotherapy and
the shadow of prostitution: the Society of Trained Masseuses
and the scandals of 1894 Soc Science Med 2006; 62 :
2336-48
http://www.csp.org.uk/frontline/article/foreign-fields-physiotherapy-during-first-world-war consulté le 15 décembre 2020
http://www.scarletfinders.co.uk/180.html consulté le 15 décembre 2020
Goldstone A.L. Massage as an orthodox medical
treatment past and future Complementary Ther Nursing
Midwifery 2000 ; 6 : 169-71
Pfister G. Cultural confrontation: German
Turnen, swedish gymnastics and english sports- european
diversity in physical activities from a historical perspective
Culture, Sport, Society 2003 ; 6(1) : 61-91
Pfister G. Cultural confrontation: German
Turnen, swedish gymnastics and english sports - european
diversity in physical activities from a historical perspective
Culture, Sport, Society 2003 ; 6(1) : 61-91
Westberg J. Adjusting swedish gymnastics
to the female nature: discrepancies in the gendering
of girls’ physical education in the mid-nineteenth century
Espacio, Tiempo y Educatión 2018 ; 5(1) :
261-79
Pfister G. Cultural confrontation: German
Turnen, swedish gymnastics and english sports - european
diversity in physical activities from a historical perspective
Culture, Sport, Society 2003 ; 6(1) : 61-91
Ibid.
Liste
des figures proposées par l'auteur :
[Fig.1] La
Turnerkreuz [logo
crusifère  formé par Friedrich
Ludwig Jahn
formé par Friedrich
Ludwig Jahn  (1778-1852)
composée d'une croix stylisée avec 4 F
pour « Frisch,
fromm, fröhlich, frei »
c'est-à-dire : « frais, pieux,
fier, libre »] (1778-1852)
composée d'une croix stylisée avec 4 F
pour « Frisch,
fromm, fröhlich, frei »
c'est-à-dire : « frais, pieux,
fier, libre »]
[Fig.2] Rebouteux
breton massant
une cheville « foulée »
[Carte-postale d'un masseur de Pont-Scorit  en Bretagne] en Bretagne]
[Fig.3] Médaille
commémorative du centenaire de l’EFOM [1900]
[Fig.4] Diplôme
d’infirmière-masseuse de l’EFOM de 1932
© Collection de l’auteur
[Fig.5] Schématisation
des pôles d’intérêts de la SDK à
sa création et leurs animateurs d’après
Monet
[Fig.6]
Portait de de Pehr
Henrik Ling
[Fig.7]
Portait de Gustav
Zander
[Fig.8] Figure
8 : Portrait de Johann Georg Mezger
[Fig.9] Plaque
commémorative apposée sur un mur de la
piscine de l’hôtel Amstel
[Fig.10],
Massage podal d’après une édition de 1595
du Canon d’Avicenne
TDM  [source
et propriété du CFDRM (http://www.cfdrm.fr)] le massage podal est présenté,
pour la période explorée dans ce travail,
dans un environnement d’établissement de bains [source
et propriété du CFDRM (http://www.cfdrm.fr)] le massage podal est présenté,
pour la période explorée dans ce travail,
dans un environnement d’établissement de bains
[Fig.11] Carte
postale ancienne de Géorgie montrant un Massage podal
[voir Caucase : d'hommes à Tifflis, Géorgie, Caucase].
[Fig.12]
Ce n’est pas un supplice mais un traitement
par massage podal en Ouganda
[Nous la retrouvons publiée
l'année suivante dans le Journal des Voyages - N°780,
Année : 1911 TDM  ] ]
[Fig.13] Carte
postale ancienne montrant l’installation nécessaire
pour amener l’eau thermale d’Aix les Bains
dans la salle de douche-massage
[Fig.14] Carte
postale ancienne montrant bien qu’en hydrothérapie, balnéothérapie ou crénothérapie, le massage reste un massage standard
[Fig.15] Les
instruments de l’Admiral Henry
[Fig.16] marteau
de fer et cuillère de bois de l’Admiral Henry,
[Fig.17] Gant
de crin double tricotage, à gauche et gant de
laine à droite
[Fig.18] Gant
brosse sans pouce du catalogue Natton
[Fig.19] Le
strigile illustrant le livre de G. du Choul
[Fig.20] Les
rouleaux de Flashar, à gauche le grand, à
droite le petit
[Fig.21] La
roulette du Dr Boyer, à gauche les illustrations
de son brevet montrant l’intérêt d’un axe
flexible pour s’adapter aux galbes corporels, à
droite, illustration du catalogue Drapier
[Fig.22] Battoir
musculaire de bois monoxyle
[Fig.23] Le
Massagebett du Pr Zablukovski
[Fig.24] Le
Massagebock et un exemple d’utilisation
[Fig.25] Le
« Masso-lit » du Dr Weber
[Fig.26] La
table de massage du Docteur Krafft
[Fig.27] Lanière
de massage d’après le catalogue Drapier
[Fig.28] Le
Rückenreiber ou lanière de massage
[Fig.29] Battoir
musculaire de caoutchouc
[Fig.30] Le
marteau de Klemm liste 1/3
[Fig.31] Le
marteau de Flashar, fabriqué par Rudolf Détert
à Berlin
[Fig.32] La
boule du marteau est en caoutchouc, en bas, la tête
est faite d’un matériau dur recouvert de caoutchouc
[Fig.33] Le
réveille-muscle ou frappeur du catalogue Drapier
de 1911
[Fig.34] Le
percuteur de Klemm
[Fig.35] Patient
utilisant le percuteur de Klemm
[Fig.36] Les
quatre régions du « pommelling hammer »
[Fig.37] Le
Pulsator du Docteur Gower
[Fig.38] Le
doigtier du Docteur Krügkula
[Fig.39] Le
croissant de Flashar
[Fig.40] Les
différents éléments d’une boule
de massage démontable
[Fig.41] Boule
de bois lisse non démontable © Collection
de l’auteur
[Fig.42] À
gauche, rouleau ondé a une branche sur poignée,
à droite, rouleau à boules cannelées.
[Fig.43] Rouleaux
parallèles à cylindres striés à
gauche, à boules cannelées à droite
[Fig.44] Rouleau
à cannelures du catalogue Natton.
[Fig.45] Un
exemple de rouleau caoutchouc de la gamme Punkt-Roller
© Collection de l’auteur
[Fig.46] L’estampille
de Punkt Roller
[Fig.47] Publicité
pour le Radio-Masseur, rouleau chauffant parue dans
la revue L’Illustration du 3 novembre 1928
[Fig.48] Rouleau
de Mager, à droite, rouleau d’Heinrich
[Fig.49] Le
rouleau de L.R. Lacy commercialisé par Neu-Vita
[Fig.50] Lanière
à boules de la Parfumerie Récamier liste 2/3
[Fig.51] Lanière
à boules à poignées amovibles servant
elles-mêmes de masseurs à boules lisses
© Collection de l’auteur
[Fig.52] Lanière
à boules du catalogue Drapier
[Fig.53 A]
L’extenseur-masseur à câbles caoutchouc
dont les poignées servent de crispateur.
[Fig.53 B]
Gros plan d’un crispateur montrant la disposition du
tendeur de caoutchouc
[Fig.54] Le
Roléo, instrument à boules des plus simples
© Collection de l’auteur
[Fig.55] Luxueux
instrument à boules en boîtier d’acajou
© Collection de l’auteur
[Fig.56] Le
Thermoroller Protos Siemens ouvert pour être branché
[Fig.57] À
gauche, le Thermoroller fermé pour être
utilisé, à droite, gros plan de la tête
à boules
[Fig.58] L’appareil
de Semerak © Collection de l’auteur
[Fig.59] L’appareil
de Semerak, face inférieure, de gauche à
droite : les roues caoutchoutées, les tables
des marteaux, un élément de carrosserie
de l’appareil et le bouton de réglage
[Fig.60] L’Élastoma
© Collection de l’auteur
[Fig.61] Le
rouleau de Butler : (d,e) cylindre métallique
recouvert de cuir vernis, (c) électro-aimant,
(a, b) aimant fixe, (f) rouage de transmission de mouvement,
(g) borne du câble de l’électrode (m,n).
[Fig.62] L’Elektroller
© Collection de l’auteur
[Fig.63] La
couronne solidaire de la roue entraîne l’engrenage
à l’extrémité de l’axe
[Fig.64] Les
différents éléments cachés
à l’intérieur de la poignée cylindrique
de l’appareil
[Fig.65] Le
Vigorator
[Fig.66] Le
Zodiac, Illustration d’une publicité publiée
dans la revue La Culture Physique N°220 du 1er mars
1914, revue qui assurait la vente du « Zodiac »
[Fig.67] Le
cylindre de Stein
[Fig.68] Le
régénérateur organique électromagnétique
« SANITAS » du Dr Pion
[Fig.69] Vue
inférieure, entre les deux électrodes
annelées servant à rouler sur la peau
se trouvent les aimants
[Fig.70] Le
Vibrostat, vue d’ensemble © Collection de l’auteur
liste
3/3
[Fig.71] Illustration
du brevet de Stanislas Sachs permettant de visualiser
le fonctionnement
[Fig.72] Pulsoconn
de la première génération, fin
du XIXème siècle © JP Martin (www.clystère.com)
[Fig.73] Le
Pulsoconn du docteur Macaura conforme au brevet français
No 439100 et son concusseur caoutchouc en cloche. ©
Collection de l’auteur
[Fig.74] Le
Veedee et trois de ses concusseurs (p.100)
[Fig.75] Gros
plan du disque distal gradué du Veedee sans sa
fixation
[Fig.76] Gros
plan du réglage à l’aide du bord de la
rondelle sur les graduations
[Fig.77] Les
concusseurs se fixent dans les emplacements prévus
immédiatement avant le disque
[Fig.78] Le
Manipulse et un concusseur de caoutchouc en cloche détérioré
par le temps
[Fig.79] L’extrémité
inférieure du Manipulse. Lorsque le concusseur
vissé au centre est retiré les masselottes
coulissant sur leur pied de biche entrent en contact
avec la peau.
[Fig.80] Le
New American Vibrator, avec trois concusseurs dont un
installé à 45°.
[Fig.81] Le
bouton de réglage du New American Vibrator
[Fig.82] Le
vibrateur de Marfort
[Fig.83] Le
Vibrationsapparate du Pr. Zabludovski à moteur
à main fixé sur table
[Fig.84] Le « Concussor »
du Docteur Ewer
[Fig.85] Encart
publicitaire pour l’Esthética
[Fig.86] Illustration
d’une publicité parue dans un journal allemand
le 28 février 1903
[Fig.87] Publicité
pour le Fageko parue dans la revue Woche de mars 1921
[Fig.88] Le
Taifun présenté à la foire de Leipzig
en 1928
[Fig.89] Illustration
du brevet d’Amable Duplaix. Le tuyau (11) est branché
au robinet d’eau courante qui remonte en périphérie
du tuyau central, soulève un diaphragme que comprime
le ressort (2) et s’évacue par le tuyau central
(14). Les va et vient du diaphragme, du ressort et du
piston (1) génèrent les vibrations. A
droite, les différents concusseurs adaptables
[Fig.90] La
publicité décriée de l’American
vibrator
[Fig.91] Le
Clock-percuteur dans sa version à ressort.
[Fig.92] Dernière
génération du Clock-percuteur fabriqué
par Weiss & Sons
[Fig.93] Les
différents concusseurs de Mortimer-Granville
[Fig.94] La
longue tige des concusseurs permet un traitement dans
l’eau sans dommage pour l’instrument
[Fig.95] Vibrateur
à dynamo
[Fig.96] L’appareil
de type A d’après le catalogue ROZAL (avec l’autorisation
d’Hélène Zalkind)
[Fig.97] L’appareil
de type B © Collection de l’auteur
[Fig.98] Publicité
pour le Simo-Vibrator, modèle Berlin, d’Heinrich Simons
[Fig.99] L’appareil
produit par Rupalley et Cie liste 3/3
[Fig.100]
Les éléments du cône, de gauche
à droite le concusseur, la bague vissée,
la pièce en épi de faitage, le cône
chromé, le tube contenant le ressort se vissant
sur l’axe moteur
[Fig.101]
Ensemble de publicité au format timbre-poste
courante en Allemagne dans les années 1920-1930
[Fig.102]
Le moteur entraîne un flexible (F) qui fait tourner
un excentrique contenu dans la boîte (B) surmontant
le manche (M), différents concusseurs se fixent
en bout ou latéralement (a)
[Fig.103]
Un vibrateur électrique simplifié utilisé
à l’Établissement thermal de Spa
[Fig.104]
Le Vibrateur Power vendu par Stanley Cox Ltd
[Fig.105]
Le tabouret supportant le moteur, le flexible et le
Trémolo suspendu à droite
[Fig.106]
Concusseur à disque pneumatique pour le tronc
[Fig.107]
Concusseur à plateau et son support à
cardan pour la région précordiale
[Fig.108]
Concusseur d’ébonite en V pour le pharynx
[Fig.109]
Concusseur à double rouleau en ébonite
caoutchoutée
[Fig.110]
Concusseur dit « Le Frontal »
à lame souple
[Fig.111]
Exemple de concusseur rond
[Fig.112]
Le Pr Zabludovski est représenté utilisant son
appareil de massage vibratoire électrique fonctionnant
avec un accumulateur [note CFDRM : c'est à la
page
145 de la 1ère
édition française est de 1904, Ed.
G. Steinheil TDM
 ] ]
[Fig.113]
Le Dr Pierre Kouindjy appliquant des percussions à
l’aide d’un manche muni de lanières dont la rotation
est actionnée par un vibrateur électrique
simplifié visible à gauche
[Fig.114]
« Humanisation » des vibrations
réalisées par le Dr Pierre Kouindjy
[Fig.115]
Le vibrateur de Muschik dessin publié dans L’Illustration
28 janvier 1939
[Fig.116]
Masseur herniaire du catalogue Drapier
[Fig.117]
Boules de massage, lisse en haut à gauche et
striée en haut à droite, le bouchon à
vis fermant l’orifice de remplissage par de la grenaille
de plomb est visible au pôle supérieur.
En bas, boule striée pleine, non lestable.
[Fig.118]
Boule à poignée lestée de grenaille
de plomb, notez la vis de bois permettant l’accès
à la cavité interne pleine de grenaille
de plomb. © Collection de l’auteur
[Fig.119]
La ceinture de massage abdominal du Docteur Schaffer
[Fig.120]
Boule de petite taille adaptée au traitement
des doigts
[Fig.121]
L’optogène et comment le tenir pour l’utiliser
[Fig.122]
L’appareil du Dr Dion
[Fig.123]
Traitement d’un patient
[Fig.124]
Illustration du premier brevet de l’Oculiser
[Fig.125]
Illustration du brevet de l’Oculiser de 1935 avec 3
variantes du mécanisme de rotation des œillères
[Fig.126]
Le Tampon-masseur et la manière de s’en servir
[Fig.127]
La ventouse de massage facial
[Fig.128]
La pince du Docteur Acquaviva
[Fig.129]
Le coffret Heinrich Simons
de Berlin portant les armoiries des Grands-Ducs de Mecklembourg
et les mentions G.m.b.H. et Hoflieferanten liste 4/4
[Fig.130]
Le Massager, sur le cliché de droite, notez la
surface inférieure légèrement concave.
[Fig.131]
Publicité pour le Vibro-Energos parue en 1912
[Fig.132]
Le grand vibrateur
[Fig.133]
Machine F2 pour vibration du corps entier comme en équitation
[Fig.134]
Percussions du tronc
[Fig.135]
Percussions du membre inférieur
[Fig.136]
Machine H1 assurant le pétrissage de l’abdomen
[Fig.137]
Machine assurant le frottement du membre supérieur
[Fig.138]
Machine assurant les frottements du membre inférieur
[Fig.139]
Frottements des pieds
[Fig.140]
Machine pour le frottement du dos
[Fig.141]
Machine assurant des frottements circulaires de l’abdomen
[Fig.142]
Fauteuil trépidant de la Société
Dupont
[Fig.143]
Carte postale ancienne montrant un Fibrationbett à
droite et sa machinerie dénommée Fibrationapparat
à gauche
[Fig.144]
Publicité allemande pour une machine à
sangle
[Fig.145]
Publicité pour une machine à sangle parue
dans la revue L’illustration en novembre 1932
[Fig.146]
Publicité montrant un usage au niveau de la ceinture
scapulaire parue dans la revue L’illustration du 8 juin
1939
[Fig.147]
Le Concentra, instrument fabriqué en RFA
[Fig.148]
Le Massinet Type 2, instrument fabriqué en RDA
[Fig.149]
Instrument fabriqué en URSS
[Fig.150]
Le Relax fabriqué en Suède |
Page
1
MÉMOIRE POUR LE DIPLÔME UNIVERSITAIRE
en HISTOIRE DE LA MÉDECINE
Présenté
et soutenu
Le
25 septembre 2021
Par
PETITDANT
Bernard
Massage manuel et instrumental en Europe
du début du XIXème siècle à l’entre-deux-guerre.
Université
de Paris
Faculté
de médecine de Paris
Présenté
et soutenu
Le 25 septembre 2021
Page
2
Bernard Petitdant – Mémoire DU Histoire de la Médecine
– 2021
To study history
means to look back and
analyse prior facts
and experience, thus meaning
that without
history, there are no retrospective studies,
no evidence based medicine and no guidelines.
How can someone introduce a new idea
without
knowing the old ones ?
Professor
Albert Mudry
Ear,
Nose, Throat & Audiology News 2015 ; 4(24)
Étudier
l’histoire signifie regarder en arrière et
analyser des faits et expérience antérieurs, cela
signifie
que sans histoire, il n’y a pas
d’études rétrospectives,
pas
de médecine fondée sur la preuve et pas de directives.
Comment quelqu’un peut-il présenter
une idée nouvelle
sans connaître
les anciennes ?
Professeur
Albert Mudry
Ear,
Nose, Throat & Audiology News 2015 ; 4(24)
Page
3
À tous les miens,
À mes amis,
À Anne in memoriam.
Page
4
Remerciements
Que
les Professeurs Jean-Noël Fabiani-Salmon, Johan Pallud, trouvent
ici la marque de ma sincère reconnaissance pour leur gestion
de ce DU et la qualité de leur enseignement.
Monsieur Claude Harel, coordinateur pédagogique,
a su, dans les conditions difficiles de cette période de
pandémie, mener à bien ce DU, qu’il en soit sincèrement
remercié.
Que tous ceux, qui m’ont fait l’amitié
de relire, corriger, critiquer le manuscrit de ce mémoire
en m’apportant leurs encouragements, trouvent, ici, la marque de
mes bien sincères remerciements.
Le travail de fourmi, mené de longue
date, par Alain
Cabello-Mosnier pour enrichir son site
le Centre Français de Documentation et de Recherches sur
les Massages (CFDRM), m’a été d’une aide précieuse,
qu’il en soit remercié.
Page
5
Résumé
Titre
: Massage manuel et instrumental en Europe du début du XIXème
siècle à l’entre-deux-guerres
Résumé : Le mot français “massage”
est commun à de nombreuses langues européennes d’origine
latines ou germaniques. Il est d’un usage récent et d’une
étymologie incertaine.
Après
avoir tenté de déterminer son origine d’usage et étymologique,
nous retraçons brièvement l’histoire du massage
manuel en Europe et son intrication avec la gymnastique
orthopédique. Nous présentons ensuite un
panorama, sans avoir la prétention d’être exhaustif,
du massage
instrumental. Contrairement à ce qui se rencontre
habituellement, cette présentation des instruments de massage
ne se fait pas en fonction du type de manoeuvre
que ces appareils suppléent. Nous avons tenté ici
une classification en fonction des caractéristiques techniques
propres des divers instruments de massage.
Mots
clés : Appareil, Instrument, Kinésithérapie,
Massage, Physiothérapie, Histoire, Vibrothérapie
Title : Manual and instrumental massage in
Europe from the beginning of the 19th century to the interwar period
Abstract : The French word "massage" is common to many
European languages of Latin or Germanic origin. Its use is recent
and its etymology uncertain. After trying to determine its origin
and its etymology, we briefly review the history of manual massage
in Europe and its entanglement with orthopedic gymnastics. Then
we present a panorama, without pretending to be exhaustive, of instrumental
massage. Contrary to what is usually encountered, this presentation
of the massage instruments is not done according to the type
of maneuver that these devices provide. Here we have attempted a
classification according to the specific technical characteristics
of the various massage devices.
Keywords : Device, Instrument, Tool,
Physitherapy, Massage, History, Vibrotherapy
Page
6
Liste des abréviations
:
APMC : Almeric Paget Massage Corps
APMMC : Almeric Paget’s Military Massage Corps
BMJ : British Medical Journal
CFDRM
: Centre Français de Documentation et de Recherches sur les
Massages
CNRTL : Centre
National de Ressources Textuelles et Lexicales
DRGM : Deutsches Reichsgebrauchsmuster
EFOM
: École Française d’Orthopédie et de Massage
G.m.b.H : Gesellschaft mit beschränkter
Haftung
INPI : Institut
National de la Propriété Industrielle
ISTM : Incorporated Society of Trained Masseuses
Ltd : Limited
Rd : Registred design
RDA : République Démocratique allemande
RFA : République Fédérale d’Allemagne
SDK
: Société de Kinésithérapie
STM : Society of Trained Masseuses
URSS:
Union des Républiques Socialistes Soviétiques
Page
7
Table
des matières
Remerciements
...................................................................................................................... 4
Liste des abréviations ............................................................................................................. 6
Introduction ......................................................................................................................... 10
1 Première
partie : Sources bibliographiques ................................................................. 12
1.1 Recherches ........................................................................................................... 12
1.2 Limites .................................................................................................................. 13
2 Deuxième
partie : Le sens des mots ........................................................................... 15
2.1 Étymologie ............................................................................................................ 15
2.2 Synonymes ............................................................................................................ 16
2.3 Évolution
du vocabulaire ........................................................................................ 18
2.4 Définition ............................................................................................................... 19
3 Troisième
partie : Les prémices ................................................................................. 20
3.1 Médecine,
gymnastique et massage ........................................................................ 20
3.2 En
Allemagne ........................................................................................................ 20
3.3 En
France ............................................................................................................. 24
3.4 Au
Royaume Uni ................................................................................................... 33
3.5 En
Suède .............................................................................................................. 35
4 Quatrième
partie : L’Histoire tortueuse du massage dit suédois .................................. 41
5 Cinquième
partie : Le massage manuel....................................................................... 45
5.1 Les
différentes manœuvres .................................................................................... 47
5.1.1 L’onction ........................................................................................................... 48
5.1.2 Les
frictions douces ........................................................................................... 50
5.1.3 Les
frictions moyennes ou rudes ......................................................................... 50
5.1.4 Les
pressions douces ......................................................................................... 51
5.1.5 Les
pressions fortes ........................................................................................... 51
5.1.6 Les
percussions ................................................................................................. 52
5.2 Évolution .............................................................................................................. 52
6 Sixième
partie : Le massage instrumental .................................................................... 55
6.1 Le
meilleur instrument ......................................................................................... 55
6.2 Le
meilleur instrument, mais ...! .......................................................................... 55
6.3 Proposition
de classification des instruments ...................................................... 55
6.3.1 Les
instruments simples ............................................................................... 58
6.3.1.1 Les
instruments de l’Admiral Henry .......................................................... 58
6.3.1.2 Les
brosses ................................................................................................ 60
6.3.1.3 Les
gants ................................................................................................... 60
Page 8
6.1.4 Le strigile ou raclette
................................................................................
62
6.1.5 Le rouleau et la roulette
............................................................................
62
6.1.6 La palette ou férule
ou tapette ou battoir ...................................................
64
6.1.7 Le faisceau de branches
particulièrement de branches de bouleau...............
64
6.1.8 Les onguents, pommades
et huiles .............................................................
65
6.1.9 L’installation du
patient .............................................................................
65
6.2 Les instruments élaborés
..............................................................................
67
6.2.1 La lanière
de massage ...............................................................................
68
6.2.2 Le battoir ..................................................................................................
69
6.2.2.1 Le marteau de Klemm
............................................................................
70
6.2.2.2 Le marteau de massage
..........................................................................
70
6.2.2.3 Le percuteur de Klemm
..........................................................................
71
6.2.2.4 Le marteau à
pommeau (pommelling hammer) .........................................
72
6.2.2.5 Le Pulsator du Docteur
Gower ...............................................................
73
6.2.2.6 Le doigtier percuteur
du Docteur Krügkula .............................................
74
6.2.3 Le croissant du Docteur
Flashar .................................................................
74
6.2.4 La roulette .................................................................................................
74
6.2.5 La boule de massage
.................................................................................
75
6.2.6 Les rouleaux .................................................................................................
76
6.2.7 Évolution et
combinaison de différents instruments ........................................
80
6.2.8 L’appareil de P. Semerak
.............................................................................
85
6.2.9 L’Elastoma ....................................................................................................
87
6.3 Les instruments de
massage induisant une électrisation simultanée
...................... 87
6.3.1 Les instruments produisant
un courant électrique ...........................................
88
6.3.1.1 Le rouleau de Butler
...........................................................................
88
6.3.1.2 L’Élektroller
.........................................................................................
88
6.3.1.3 Le Vigorator ........................................................................................
90
6.3.1.4 Le Zodiac .............................................................................................
91
6.3.2 Les instruments reliés
à une pile ......................................................................
92
6.3.2.1 Le cylindre de Stein
...........................................................................................
92
6.3.2.2 Le Sanitas du Docteur
Pion .................................................................................
93
6.4 Les instruments de
massage vibratoire ........................................................................
94
6.4.1 Les instruments de
massage vibratoire manuel ...........................................................
95
6.4.2 Les instruments de
massage vibratoire manuels à manivelle ........................................
98
6.4.2.1 Le Pulsoconn du Docteur
Macaura ........................................................................
98
6.4.2.2 Le Veedee .............................................................................................................
99
6.4.2.3 Les instruments du
Docteur Johansen ...................................................................
101
6.4.2.4 Le vibrateur de Marfort
........................................................................................
105
6.4.2.5 Le Vibrationsapparate
du Professeur Zabludovski ................................................
105
6.4.2.6 Le concussor du Docteur
Ewer ..............................................................................
106
6.4.3 Les instruments de
massage vibratoire à ressort .......................................................
107
6.4.4 Les instruments de
massage vibratoire fonctionnant avec un fluide sous pression
...107
6.4.4.1 Le Viberon ..............................................................................................................
108
6.4.4.3 Le Taifun .................................................................................................................
110
Page 9
6.4.4.4 L’American
vibrator ..........................................................................
111
6.4.5 Les
instruments de massage vibratoire électriques portatifs ................. 113
6.4.5.1
Le
« Clock-work percutor » de Joseph Mortimer
Granville .............. 113
6.4.5.2 Vibrateur
à dynamo ..........................................................................
116
6.4.5.3 Les
appareils de la marque Rozal ......................................................
116
6.4.5.4 Le
Simo-Vibrator modèle Berlin .......................................................
118
6.4.5.5 L’appareil
de Rupalley et Cie ............................................................
118
6.4.5.6 Le
Sanax ............................................................................................
120
6.4.6 Les instruments de
massage vibratoire fixes ..........................................
121
6.4.6.1 Le Vibrateur Caiffe ............................................................................
121
6.4.6.2 Les vibrateurs électriques
simplifiés .................................................
121
6.4.6.3 Le vibrateur de Muschik ...................................................................
127
6.5 Les instruments dédiés ...............................................................................
129
6.3.5.1 Le masseur herniaire ..............................................................................
129
6.3.5.2 Les instruments de
massage abdominal .................................................
129
6.3.5.2.1 Les boules de massage
abdominal ...................................................
129
6.3.5.2.2 La ceinture de massage
abdominal du Docteur Schaffer .................
131
6.3.5.3 Les instruments pour
les doigts ..............................................................
132
6.3.5.4 Les instruments pour
les yeux ................................................................
132
6.3.5.4.1 L’optogène ........................................................................................
132
6.3.5.4.2 L’appareil de Charles
Dion ................................................................
133
6.3.5.4.3 L’Oculizer de Leonard
Russell Lacy ...................................................
135
6.3.5.5 Les instruments dédiés
au massage facial et des zones pileuses ...........
136
6.3.5.5.1 Le tampon-masseur ..........................................................................
137
6.3.5.5.2 La ventouse pour massage
pneumatique .........................................
137
6.3.5.5.3 La pince plastique
du Docteur Acquaviva .........................................
138
6.3.5.5.4 Instruments divers
en coffret ...........................................................
139
6.3.5.5.5 The Massager ....................................................................................
140
6.3.5.5.6 Le Vibro-Energos ...............................................................................
141
6.3.6 Les machines à
masser ...............................................................................
143
6.3.6.1 Les machines de Gustav
Zander .............................................................
143
6.3.6.1.1 Machines assurant
un massage vibratoire .......................................
144
6.3.6.1.2 Machines assurant
des percussions .................................................
146
6.3.6.1.3 Machine assurant des
pétrissages ....................................................
148
6.3.6.1.4 Machines assurant
des frottements .................................................
149
6.3.6.2 Les machines apparentées .....................................................................
153
6.3.6.3 Les machines à
sangle.............................................................................
155
Conclusion ..........................................................................................................................
158
Table des illustrations .........................................................................................................
162
Table des tableaux ..............................................................................................................
166
Bibliographie .......................................................................................................................
167
Résumé...............................................................................................................................
188
Page
10
Introduction
Le foisonnement des
idées, des recherches, des inventions, des matériaux,
de la fin du XIXème siècle et du début
du XXème a contribué à proposer
une multitude de nouvelles machines, de nouveaux outils dans tous
les domaines de l’industrie, des sciences et en particulier un grand
nombre d’instruments de massage.
Ce travail se propose de les recenser, de les décrire, sans
avoir la prétention d’être exhaustif, et de les classer
selon une nouvelle méthodologie.
De la pensée médicale à
la description des « outils du corps », nombreux sont
les travaux consacrés à l’Histoire de la médecine1
ou des médecins2. Certains s’intéressent
à la pensée médicale3, à
une période historique particulière 4 5 6.
D’autres aux instruments utilisés à toutes époques7
ou pendant une période plus ou moins longue 8.
D’autres détaillent un type spécifique d’instruments9,
les instruments d’une spécialité ou les instruments
fabriqués dans un matériau particulier 10 11
12.
Le choix de ce sujet vient d’un goût passionné
pour l’histoire de notre profession de masseur-kinésithérapeute
et d’une collection d’instruments de massage. Ce travail
ne fait qu’entrouvrir un dossier, sans pouvoir, bien sûr,
être exhaustif.
Aucun document, ne
semble avoir été dédié, spécifiquement,
aux instruments utilisés pour réaliser les manœuvres
de massage. De plus, au lieu de les présenter,
1 Lyons A.S., Petrucelli R.J.
Histoire illustrée de la médecine Paris : Presse de
la Renaissance ; 1979
2 Perez S. Histoires
des médecins – Artisans et artistes de la Santé de
l’Antiquité à nos jours Paris : Per-
rin ; 2018
3 Grmek M.D. Histoire de la pensée
médicale Antiquité et Moyen-Age Paris : Seuil ; 1995
4 Imbault-Huart M.J. La médecine au
Moyen-Age à travers les manuscrits de la Bibliothèque
Nationale
Paris : Ed. de la Porte Verte
; 1983
5 Coury Ch. La médecine de
l’Amérique précolombienne Paris : Roger Dacosta ;
1969
6 Leca A-P. La médecine égyptienne
au temps des pharaons Paris : Roger Dacosta ; 1971
7 Velter A., Lamothe M.J. Les outils du corps Paris : Messidor-Temps
actuels ; 1984
8 Martin J.P. Instrumentation
chirurgicale et coutellerie en France, des origines au XIXème siècle
Paris :
L’Harmattan ; 2013
9 Martin J.P. L’histoire des seringues, injecteurs et aspirateurs
étudiés comme modèle de l’évolution
technologique des instruments médicaux
DU Histoire de la Médecine Université Paris Descartes
2018
10 Bidault P., Lepart J. Étains
médicaux et pharmaceutiques Paris : Ed. Ch. Massin ; sd
11 Renner Cl. Histoire illustrée des
étains médicaux Paris : EGV Éditions 2011
12 Martin J.P. L’instrumentation médico-chirurgicale
en caoutchouc en France XVIIIème, XIXème siècle
Paris : L’Harmattan ; 2013
Page
11
classiquement,
en fonction de la manœuvre
qu’ils remplacent, c’est une classification en fonction de leurs
caractéristiques techniques qui a été préférée.
Après
avoir indiqué l’origine des sources bibliographiques, sont
définies la terminologie utilisée et son évolution.
Les limites de cette étude sont tout d’abord présentées
avant de passer en revue les techniques manuelles de massage
décrites par les auteurs du XIXème et du
début du XXème siècle. Ces manœuvres
connues, ce sont les instruments et appareils, plus ou moins complexes,
destinés à suppléer la main qui sont décrits.
Enfin,
sont évoquées les raisons de l’abandon relatif de
ces instruments et leur évolution.
Page
12
1.1 Recherches
Le
mot « massage »
et les manœuvres
mises en œuvre pour le réaliser ont conservé leurs
dénominations françaises à l’étranger.
Son orthographe est identique dans de nombreuses langues comme l’Anglais,
l’Allemand, le Néerlandais,
le Suédois, le Danois. Par contre, le Norvégien, le
Polonais, l’Italien, l’Espagnol par exemple ont adapté le
mot qui se reconnaît facilement. Seul le Finnois l’a complètement
modifié.
Des
documents dispersés et disparates sont collectés,
classés selon les caractéristiques techniques de ces
instruments.
Ce travail se limite aux documents rédigés
en Français, en Anglais. Pour une éventuelle iconographie
ont été ajouté ceux rédigés en
Allemand et en Suédois compte tenu de l’importance des Écoles suédoise et allemande
de massage et de gymnastique
au cours de la période définie dans le titre.
Les recherches bibliographiques ont été
effectuées sur les moteurs de recherches classiquement utilisés
comme Pubmed,
Science
direct, Google scholar, Researchgate. Nous avons ajouté des sites en kinésithérapie
et rééducation dont Kinésithérapie la Revue, Kinésithérapie
Scientifique, Réédoc, Kinédoc.
Nous avons terminé par des sites spécifiques d’Histoire,
d’Histoire de la médecine et les sites numérisant
des documents anciens comme la Bibliothèque
Inter-Universitaire Santé, Gallica de la Bibliothèque
Nationale de France, Centre Français
de Documentation et de Recherches sur les Massages (CFDRM), The Medical Heritage
Library,
Internet
Archive, The Wellcome Library et Google livres.
Le site de l’Institut National de la Propriété Industrielle
(INPI) et le site Espacenet nous ont permis la recherche des brevets des divers
instruments.
Cette
recherche numérique a été complétée
par une recherche manuelle dans les catalogues de fabricants de
matériel médical, dans les références
des différents ouvrages, articles ou brevets retenus et dans
notre documentation personnelle.
Page
13
Les
mots-clés utilisés sont « appareil »,
« histoire », « instrument »,
« kinésithérapie »,
« massage »,
« masseur »,
« masseuse »,
« physiothérapie »,
« device », « tool »,
« history », « massager »,
« physiotherapy » combinés sur les
sites généralistes. Seul le mot « massage »
a été pris en compte sur les sites d’Histoire ou numérisant
des livres anciens. Dans les catalogues de matériels, le
mode de numérisation ne permettant pas toujours une recherche
par mot-clé, la recherche s’est faite manuellement dans la
table des matières.
La
recherche des brevets a été réalisée
soit par le nom de l’inventeur, soit par le numéro du brevet
s’il était connu, soit avec un ou plusieurs mots clés
décrivant l’instrument ou son fonctionnement. Si un brevet
a été trouvé avec certitude, une nouvelle recherche
est entreprise pour savoir si l’inventeur n’avait pas déposé
d’autres demandes pour le même instrument, dans d’autres pays
ou pour des instruments nouveaux.
Cette
recherche bibliographique s’est faite également en fonction
des limites géographiques, chronologiques et des régions
à masser
après les avoir définies. Les publications faites
au Royaume Uni,
mais avec uniquement une édition américaine numérisée
ou celles portant sur L'histoire du massage faites par des
auteurs des États
Unis d'Amérique ont été aussi prises
en considération dans cette investigation.
Cette
étude s’intéresse au massage
manuel et instrumental
en Europe entre le XIXème
siècle et l’Entre-deux-guerres. Les types de massage
doivent également être circonscrits. Seuls les massages
cutanés seront considérés. Les massages
des orifices et conduits naturels, des muqueuses, des glandes ne seront pas décrits
excluant ainsi le massage
gynécologique, le massage
prostatique, le massage
tympanique. Les ouvrages et articles traitant spécifiquement
de ces régions sont donc exclus de notre recherche bibliographique.
Ainsi les massages des viscères seront possibles uniquement
à travers la paroi abdominale ou le massage de l’œil
à travers la paupière.
Page 14
Estradère sépare
le massage
thérapeutique du massage
hygiénique. Dès l’introduction de sa
thèse il insiste sur le fait que le massage doit être
considéré comme un acte médical. Le massage
thérapeutique doit être réservé au
médecin, ou éventuellement en sa présence s’il
ne souhaite pas prendre une part active à ces manœuvres,
par contre le massage hygiénique peut être pratiqué
par un aide spécialement formé. Tous les auteurs,
médecin ou non, émettent la même opinion. Le
médecin laissera des consignes précises pour l’exécution
du traitement et sa présence ne sera pas indispensable. Sans
risque de complications, en présence d’un masseur
maîtrisant parfaitement son art, agissant sans brutalité,
un bénéfice pourra être retiré du massage
hygiénique.
Les
manœuvres, mises en œuvre pour l’un ou l’autre de ces types
de massage, sont identiques, seul l’opérateur et la
finalité changent, aucune distinction ne sera faite dorénavant
entre les deux types de massage.
13 – Estradère, Du massage, son historique, ses manipulations, ses effets
thérapeutiques. Paris Adrien Delahaye ; 1863 TDM 
Page
15
L’étymologie
du mot massage est incertaine. Actuellement on considère
que le mot "massage" prend ses racines, soit du
grec " massein "
 qui
ne signifierait pas masser mais pétrir
et le mot massage n'en descendrait pas, soit de l'hébreux
« mashesh », soit de l'arabe
« masah » ou « massa »
signifiant presser
légèrement, toucher,
palper. qui
ne signifierait pas masser mais pétrir
et le mot massage n'en descendrait pas, soit de l'hébreux
« mashesh », soit de l'arabe
« masah » ou « massa »
signifiant presser
légèrement, toucher,
palper.
Pour
le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL)
le suffixe « age » a été ajouté
au verbe « masser ». Pour cette même
source le verbe transitif masser au sens de « regrouper »
date de la seconde moitié du XIIIème siècle.
Par contre le récit de voyage de 1778 de Le
Gentil citant le voyage
de Jean-Henri Grose traduit de l’Anglais
donne, à ce terme, le sens qui nous intéresse ici.
Ainsi, pour le CNRTL en s’appuyant sur l'apparition du mot dans
des récits de voyages en Orient, l'emprunt à l'arabe
est plus probable que l'origine grecque.
Le
mot « massage » est donc apparu, semble-t-il,
au XVIIIème siècle. Le premier document
en Français l’utilisant serait l’ouvrage de Anquetil
Duperron comprenant sa relation
de voyage aux Indes orientales et sa traduction du Zend-Avesta
de Zoroastre TDM  .
Le premier ouvrage comportant le mot « massage »
dans son titre est la thèse de Jean Dominique Joachim Estradère
soutenue en 1863. Il apparaît dans l’Oxford English Dictionary
en 1876 . .
Le premier ouvrage comportant le mot « massage »
dans son titre est la thèse de Jean Dominique Joachim Estradère
soutenue en 1863. Il apparaît dans l’Oxford English Dictionary
en 1876 .
14 http://www.cnrtl.fr/etymologie/masser consulté le 15 décembre 2020
15
Le
Gentil Voyage dans les mers de l’Inde
tome 1 Paris : Imprimerie Royale ; 1779
16
Grose J.-H.
Voyage aux Indes orientales Londres 1758 TDM 
17 Anquetil
Duperron A-H. Zend-Avesta de Zoroastre
Tome 1 Paris : Tillard ; 1771 (p356) TDM 
18 Estradère
J. Du massage, son historique, ses manipulations,
ses effets thérapeutiques. Paris Adrien Delahaye ; 1863 TDM 
19 Lardry J-M. Etude de l’ouvrage
intitulé « Du massage, son historique, ses manipulations,
ses effets thérapeutiques » du Dr Jean Dominique Joachim
Estradère Kinesither Rev 2016 ; 16 (171) : 88-91
20
Bell J. Mechanotherapy, Man and Machines Physiotherapy 1994; 80(2)
: 61-6
Page 16
L’origine
récente du mot « massage »
peut se confirmer avec l’utilisation en parallèle du mot
« massement ».
En effet, au début du XIXème siècle,
le mot massage ne semble pas parfaitement fixé. Piorry
,
en rédigeant l’article « Massage »
dans le dictionnaire en 60 volumes, ajoute à ce titre en
plus petit caractère « massement »
et il utilise tout au long de l’article indifféremment l’un
ou l’autre. De même, [Léon] Rostan
utilise aussi le terme « massement »
dans la rédaction de l’article « Massage »
du Dictionnaire de Médecine d’Adelon.
Cette terminologie se retrouve aussi sous la plume de Charles
Londe. Cette fois, le
suffixe « ment » a été ajouté
au verbe « masser ».
Pour
être complet, il nous faut ajouter le terme « psélaphie »
ou « psellaphie » du grec tâtonner,
caresser, toucher
repris par Estradère citant l’article « palette »
du dictionnaire de Panckoucke.
psélaphie est
utilisé pour « exprimer élégamment
ce que l’on appelle lourdement et grossièrement le massage,
le massement »
Dans
la première partie du XIXème siècle
les auteurs sont partagés. En 1828, Rostan dans son article
« Massage » du Dictionnaire d’Adelon
affirme que le massage n’est pas pratiqué dans nos
contrées. D’autres ne font pas la distinction entre la gymnastique
et le massage. Le massage est pour certains la forme
passive de la gymnastique. De Betou
ignore le massage. Pour lui, gymnastique active et passive
sont des manipulations thérapeutiques (therapeutic manipulation),
les différentes manœuvres
sont considérées indépendamment les unes des
autres sans être regroupées sous le
21 Piorry article « Massage » Une société
de Médecins et de chirurgiens Dictionnaire des sciences médicales
Tome 31 Paris : C.L.F. Panckoucke ; 1819.
22 Rostan
L. article « Massage » in
Adelon, Béclard, Biett, et al. Dictionnaire de Médecine
TDM  Tome 14 Paris : Béchet jeune ; 1826 Tome 14 Paris : Béchet jeune ; 1826
23
Londe
Ch. Gymnastique médicale ou l’exercice
appliqué aux organes de l’homme. Paris : Croullebois ; 1821
TDM 
24 Une société
de Médecins et de chirurgiens Dictionnaire des sciences médicales
Article « Palette » Tome 39 Paris : C.L.F. Panckoucke
; 1819
25 Estradère
J. Du massage, son historique, ses manipulations,
ses effets thérapeutiques. Paris : Adrien Delahaye ; 1863
TDM 
26 Rostan L. article «
Massage » in Adelon, Béclard, Biett, et al. Dictionnaire
de Médecine Tome 14 Paris : Béchet jeune ; 1826
27 Reveil
O. Formulaire raisonné des médicaments
nouveaux Paris : J.B. Baillière ; 1864 TDM 
28 Le Betou I.G.I. Therapeutic
manipulation or Medicina mechanica : a successful treatment of various
disorders of the human body, by mechanical application. London :
Simpkin, Marshall & Co ; 1851
Page 17
vocable
général de massage. Alors que pour Estradère
le massage est une entité distincte même si
le massage
hygiénique prépare ou suit la gymnastique.
Le
terme « manipulation »,
souvent complété par les adjectifs « thérapeutique »
ou « médicale », se rencontre avec
« friction »
ou « rubbing » (frottement).
Il ne semble pas qu’une définition précise de ces
termes existe. Les auteurs les utilisent alternativement, voire
ensemble, dans un titre d’ouvrage.
Seule, la distinction entre frottement doux (soft rubbing)
ou fort (hard rubbing) existe. Le mot anglais shampooing,
dérivé de l'indien chamboni,
signifie friction.
Il a donc un sens plus large que de nos jours. Une confusion existe,
parfois, entre massage et mouvement
passifs de la gymnastique
ainsi il a été proposé de ne parler que des
« manipulations
du massage » et des « mouvements de
la gymnastique ».
A
une époque où la terminologie n’est pas encore fixée
se rencontre aussi le terme mécanothérapie
(mechano-therapy). C’est un mode de traitement par le mouvement
qui regroupe le massage et la gymnastique
médicale, car tous deux utilisent la mécano-transduction
pour stimuler les tissus. Pour Bell
ce terme regroupe une gamme d’activités mécaniques
utilisées à des fins thérapeutiques.
Certains
ont voulu imposer « massothérapie »,
la forme accourcie de « massage
thérapeutique »
ou de « l’application du massage
à la thérapeutique ».
C’est aussi un moyen d’associer le mot « massage »
avec une autre thérapeutique telle l’électrothérapie,.
Murrell
utilise également le terme de « massotherapeutics »
en anglais, non pour en faire un domaine réservé,
mais pour mettre l’accent sur l’aspect scientifique de cet agent
thérapeutique.
29 Estradère
J. Du massage, son historique, ses manipulations,
ses effets thérapeutiques. Paris : Adrien Delahaye ; 1863
TDM 
30 Gautier
J. Du massage ou manipulation appliqué
à la thérapeutique et à l'hygiène Le
Mans : Monnoyer ; 1880 TDM 
31 Kleen
E. Handbook of massage Philadelphia :
Blakiston ; 1892
32 Bell J. Mechanotherapy, Man
and Machines Physiotherapy 1994 ; 80 (2) : 61-6
33
Dagron G. Le massage et la massothérapie : les frictions
aux masseurs, la massothérapie aux médecins Paris
: Masson ; 1900 TDM 
34 Dujardin-Beaumetz
G. De la massothérapie Nice-Médical
1887 ; 3 :33-41
35 Dowse
Stretch Th. Lectures on massage &
electricity in the treatment of disease (masso-electrotherapeutics)
London: Hamilton, Adams & Co ; 1889
36
Rowe
W.H. Massage : A treatise on masso-electra-therapeutics
Hartlepool : Pearson & Bell ; 1898
Page 18
Avant
que n’apparaissent le mot « massage »
il n’est fait mention que de « friction »,
terme ancien déjà utilisé, par exemple, par
Ambroise Paré
ou plus près de la période qui nous intéresse
par Tissot
.
La friction est « un frottement
exécuté sur toutes les parties du corps ou sur quelques-unes
seulement … ».
La friction est souvent associée dans les récits
de voyages ou chez les auteurs antiques à l’onction
qui est « l’action par laquelle on applique des substances
grasses sur les parties préalablement
soumises aux frictions. ».
L’onction n’appartient plus aux
manœuvres
de massage
hygiénique ou thérapeutique. Le mot
« friction » est resté comme
dénomination de l’une des manœuvres du massage.
Quant
à « massement »
il a rapidement disparu. Il ne semble pas avoir été
utilisé au-delà des années 1850. Seul Thooris
réutilise, au milieu du XXème siècle,
le terme « pour désigner, par un autre mot que
massage, un ensemble de pratiques complétant les effets
du mouvement ».
Avec
l’apparition d’appareils
assurant la mobilisation des articulations et le massage,
le terme « mechano-therapy » a adopté
ces appareils. En France, le sens est plus restrictif puisque « la
mécanothérapie
est l’art d’appliquer à la Thérapeutique et à
l’Hygiène certaines machines, imaginées
pour provoquer des mouvements corporels méthodiques, dont
on a réglé d’avance la forme, l’étendue et
l’énergie ».
Le Reader’s Digest Universal Dictionary définit la
mécanothérapie
comme la physiothérapie utilis-
37 Murrell
W. Massotherapeutics or Massage as a mode
of treatment Philadelphia : Blakiston, son &C° ; 1890
38 Paré
A. Œuvres Lyon : Jean Grégoire
; 1664
39 Tissot
C.-J. Gymnastique médicinale et
chirurgicale, ou essai sur l'utilité du mouvement, ou des
différents exercices du corps, et du repos dans la cure des
maladies Paris : Bastien ; 1780 TDM 
40 Lardry
J-M. Gymnastique médicinale et
chirurgicale, ou essai sur l'utilité du mouvement, ou des
différents exercices du corps, et du repos dans la cure des
maladies par Clément
Joseph Tissot (1747-1826)
41 Londe
Ch. Gymnastique médicale ou L'exercice
appliqué aux organes de l'homme Paris : Croullebois ; 1821
TDM 
42 ibid.
43
Thooris
A. Gymnastique et massage médicaux
Paris : G. Doin & Cie ; 1951 TDM 
44
Lagrange
F. Les mouvements méthodiques et
la mécanothérapie Paris : Félix Alcan ; 1899
TDM 
Page 19
ant
des méthodes mécaniques pour faire fonctionner articulations
et muscles en produisant des mouvements répétés.
Il
existe presque une définition du massage
par auteur. Il serait possible de les multiplier, sans que cela
soit d’un grand intérêt, donc seules les plus significatives
ont été retenues.
« Le
massage le plus utilisé, c’est à dire celui
des membres, n’est autre chose qu’une compression
méthodique et intermittente, produite par des frictions
manuelles d’abord douces, puis énergiques, enfin très
puissantes opérées de bas en haut … ».
« Le
massage
thérapeutique n’est en somme que le massage
hygiénique modifié selon la nature
des maladies qui se présentent et le but que l’on veut atteindre. ».
Et
enfin celle provenant de la thèse d’Estradère,
« le massage est l’art de pétrir le corps
avec les doigts, de le frictionner avec la main ou un instrument
spécial et de faire exécuter aux articulations les
mouvements qui leurs sont propres ; le tout dans un but hygiénique
ou thérapeutique. »
Cette
dernière définition, datant de 1863, présente
le massage
manuel, le massage
instrumental et les mobilisations
qui sont inclues dans le protocole de massage et se trouvent
à la fin du soin de manière à profiter du réchauffement
des muscles. Lent et doux, ce mouvement respecte le jeu articulaire
et se doit d’être indolore. Ainsi, il se rapproche d'une réalité
technique dénommée, de nos jours, « massage-mobilisation ».
45 Bell
J. Mechanotherapy, Man and Machines Physiotherapy 1994 ; 80(2) :
61-6
46 Phélippeaux
M.V.A. Etude pratique sur les frictions
et le massage ou guide du médecin masseur Paris : L’Abeille
médicale ; 1870 TDM  [Note du CFDRM l'édition originale
date de 1869]
[Note du CFDRM l'édition originale
date de 1869]
47 Gautier
J. Du massage ou manipulation appliqué
à la thérapeutique et à l'hygiène Le
Mans : Monnoyer ; 1880 TDM 
48 Estradère J. Du massage,
son historique, ses manipulations, ses effets thérapeutiques.
Paris Adrien Delahaye; 1863 TDM 
Page 20
Pour
Dujardin-Beaumetz,
« l’histoire du massage se confond par bien des points
avec celle de la gymnastique »
et pour Kleen
« il est impossible de séparer l’histoire du massage
de celle de la gymnastique ». Mais, quelle place tient
la gymnastique et le massage en Europe ?
Bien
que de 1815 à 1870 l’unité allemande soit en devenir,
pour simplifier l’exposé, le détail
des différents états Allemands ne sera pas abordé afin d'évoquer
uniquement l’Allemagne.
Le
mouvement gymnique allemand est né à la fin du XVIIIème siècle,
inspiré par les idées de Rousseau.
Les guerres napoléoniennes
font naître un sentiment pangermanique, ainsi le mouvement
gymnique devient un instrument de mobilisation
et de formation capital pour la naissance de cette nouvelle Allemagne
unie.
Friedrich
Hoffmann (1660-1742) est le premier représentant
de ce mouvement
préparant l’arrivée de la gymnastique et du massage.
Médecin particulier de Frédéric-Guillaume de
Brandebourg  , il devient celui
de son fils, le futur Fréderic Ier de Prusse , il devient celui
de son fils, le futur Fréderic Ier de Prusse  . Il le charge de
rédiger les statuts de la nouvelle Faculté de Médecine
de l’Université de Halle. Il enseignait que l’activité
musculaire était le fait du tonus des nerfs. Il reconnaît
les avantages incomparables du mouvement, des exercices corporels
actifs ou passifs et la manière de les utiliser pour conserver
la santé. Il recommandait également les frictions.
Certains de ses écrits ont un temps été attribués
à Gutsmuths. . Il le charge de
rédiger les statuts de la nouvelle Faculté de Médecine
de l’Université de Halle. Il enseignait que l’activité
musculaire était le fait du tonus des nerfs. Il reconnaît
les avantages incomparables du mouvement, des exercices corporels
actifs ou passifs et la manière de les utiliser pour conserver
la santé. Il recommandait également les frictions.
Certains de ses écrits ont un temps été attribués
à Gutsmuths.
49 Dujardin-Beaumetz
G. De la massothérapie Nice-Médical
1887 ; 3 : 33-41
50 Kleen
E. Handbook of massage Philadelphia :
Blakiston ; 1892
51 Busch F. General orthopaedics,
gymnastics and massage in Von Ziemssen’s handbook of general therapeutics
vol.5 New-York : William Wood & Co ; 1886
Page 21
Johann
Bernhard Basedow  (1724-1790) est d’abord professeur de théologie au
Danemark. Ses idées novatrices,
inspirées de Rousseau, lui attirent des persécutions
qui lui font abandonner l’enseignement pour la pédagogie.
La formule « instruire en s’amusant » résume
sa méthode.
Il fonde à Dessau
(1724-1790) est d’abord professeur de théologie au
Danemark. Ses idées novatrices,
inspirées de Rousseau, lui attirent des persécutions
qui lui font abandonner l’enseignement pour la pédagogie.
La formule « instruire en s’amusant » résume
sa méthode.
Il fonde à Dessau  sous le titre de Philanthropinion
sous le titre de Philanthropinion  une école-modèle où
il devait appliquer ses principes mais sa grossièreté
et son intempérance l’oblige à la quitter et à
se consacrer uniquement à ses écrits. L’un de ses
collaborateurs, Christian-Gotthilf Salzmann
une école-modèle où
il devait appliquer ses principes mais sa grossièreté
et son intempérance l’oblige à la quitter et à
se consacrer uniquement à ses écrits. L’un de ses
collaborateurs, Christian-Gotthilf Salzmann  fonda la maison d'éducation philanthropique de Schnepfenthal
fonda la maison d'éducation philanthropique de Schnepfenthal
 près de Gotha
près de Gotha  où enseigna Gutsmuths.
où enseigna Gutsmuths.
Johann
Christoph Friedrich Gutsmuths (1759-1839), enseignant
et pédagogue, publie Gymnastik für die Jugend en 1793,
premier livre d’enseignement de la gymnastique. Le titre complet
de cet ouvrage est « La gymnastique pour la jeunesse :
manuel pratique d'exercices fortifiants et récréatifs
à l'usage des écoles ». Il est inspiré,
lui aussi, des préceptes de Jean-Jacques Rousseau. Il reprend
les exercices de l’Antiquité grecque. Une traduction anglaise
sera publiée en 1800.
Johann Peter Frank  (1745-1821), connu pour avoir
été le médecin de Beethoven, était avant
tout un médecin hygiéniste, pionnier dans le domaine
de la médecine sociale et de la santé publique. Dès
le début de sa carrière, il commence à travailler
sur un volumineux traité de médecine : « System einer vollständigen medicinischen
Polizey » (Un
système complet de politique médicale).
Cette œuvre l'occupe toute sa vie. Elle sera publiée en neuf
volumes de 1779 à 1829. C'est le premier traité complet
concernant tous les aspects de la santé et de l'hygiène
publique. Il s’intéresse à l'hygiène des bâtiments
publics, à la lumière dans les quartiers, à
l'organisation des parcs dans les villes, à l'organisation
des sports et de la gymnastique dans les écoles, aux pauses dans le temps de travail, à l'approvisionnement
en eau, à l'assainissement, à la sécurité
alimentaire, à la santé scolaire, à l'hygiène
sexuelle, à la protection maternelle et infantile, aux règles
de comportement vis-à-vis du public allant de la conduite
des enseignants à celle des prostituées. Sa méthode
de compilation de données statistiques des hôpitaux
ont permis à l'obstétricien hongrois Ignaz
Semmelweis
(1745-1821), connu pour avoir
été le médecin de Beethoven, était avant
tout un médecin hygiéniste, pionnier dans le domaine
de la médecine sociale et de la santé publique. Dès
le début de sa carrière, il commence à travailler
sur un volumineux traité de médecine : « System einer vollständigen medicinischen
Polizey » (Un
système complet de politique médicale).
Cette œuvre l'occupe toute sa vie. Elle sera publiée en neuf
volumes de 1779 à 1829. C'est le premier traité complet
concernant tous les aspects de la santé et de l'hygiène
publique. Il s’intéresse à l'hygiène des bâtiments
publics, à la lumière dans les quartiers, à
l'organisation des parcs dans les villes, à l'organisation
des sports et de la gymnastique dans les écoles, aux pauses dans le temps de travail, à l'approvisionnement
en eau, à l'assainissement, à la sécurité
alimentaire, à la santé scolaire, à l'hygiène
sexuelle, à la protection maternelle et infantile, aux règles
de comportement vis-à-vis du public allant de la conduite
des enseignants à celle des prostituées. Sa méthode
de compilation de données statistiques des hôpitaux
ont permis à l'obstétricien hongrois Ignaz
Semmelweis  de démontrer la relation entre
l'infection puerpérale et le manque d'hygiène des
sages-femmes.
de démontrer la relation entre
l'infection puerpérale et le manque d'hygiène des
sages-femmes.
52 Dumas J.L. Histoire de la pensée. Renaissance
et Siècle des Lumières Paris : Tallandier ; 1990
53 Frank J.P. System einer vollständigen medicinischen
Polizey Mannheim : Schwan ; 1784
Page 22
Friedrich Ludwig Jahn  (1778-1852) est non seulement un éducateur,
mais aussi le promoteur de la gymnastique. Il codifie les règles,
améliore les appareils ou en invente d’autres comme les barres
parallèles. Il promeut également le nationalisme germanique.
Sa gymnastique, le « Turnen », agit sur
le plan physique mais aussi au niveau du sentiment national. Elle a été conçue après
la défaite d’Iéna contre Napoléon. Elle avait
pour objectif de préparer la revanche en restaurant la virilité
du peuple Allemand et le sentiment national dans le but de créer
un État-nation allemand. L'objectif de Jahn est de former
des hommes forts, courageux, disciplinés pour le redressement
de l'Allemagne et la revanche contre l'occupation française.
Le Turnen représente la virilité, l'éducation
collective, développe la solidarité et le sentiment
national. Son logo, la Turnerkreuz comportait une croix stylisée avec 4 F
pour « Frisch, fromm,
fröhlich, frei »
c'est-à-dire : « frais, pieux, fier, libre »
[Fig.1].
(1778-1852) est non seulement un éducateur,
mais aussi le promoteur de la gymnastique. Il codifie les règles,
améliore les appareils ou en invente d’autres comme les barres
parallèles. Il promeut également le nationalisme germanique.
Sa gymnastique, le « Turnen », agit sur
le plan physique mais aussi au niveau du sentiment national. Elle a été conçue après
la défaite d’Iéna contre Napoléon. Elle avait
pour objectif de préparer la revanche en restaurant la virilité
du peuple Allemand et le sentiment national dans le but de créer
un État-nation allemand. L'objectif de Jahn est de former
des hommes forts, courageux, disciplinés pour le redressement
de l'Allemagne et la revanche contre l'occupation française.
Le Turnen représente la virilité, l'éducation
collective, développe la solidarité et le sentiment
national. Son logo, la Turnerkreuz comportait une croix stylisée avec 4 F
pour « Frisch, fromm,
fröhlich, frei »
c'est-à-dire : « frais, pieux, fier, libre »
[Fig.1].
Figure 1 :
La Turnerkreuz 
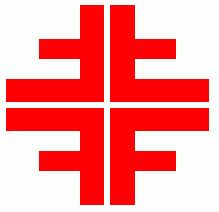
En 1813 et 1814, Jahn et ses élèves
se battent courageusement contre les troupes de Napoléon
pour la libération du pays. Face à cet exemple, les
« Sociétés » ou « Cercles
de Gymnastique » (Turnverein) se développent dans toute l'Allemagne.
À partir de 1860, le mouvement se développe
avec vigueur ; 6000 gymnastes participent au festival de 1861
à Berlin ; 20000 à celui de Leipzig en 1863.
En 1864, le nombre des adhérents est déjà de
170 000 ; il atteint 550 000 en 1896.
Johann
Heinrich Pestalozzi  (1746-1827), citoyen suisse, peut être associé
aux pédagogues allemands. Lui aussi s’inspire des principes
de Rousseau, il voue sa vie à l'éducation des enfants
pauvres. Il fonde plusieurs écoles qui servent de modèles
dans toute l'Europe. Ses méthodes d'éducation, concrètes
et directes, fondées sur le déve-
(1746-1827), citoyen suisse, peut être associé
aux pédagogues allemands. Lui aussi s’inspire des principes
de Rousseau, il voue sa vie à l'éducation des enfants
pauvres. Il fonde plusieurs écoles qui servent de modèles
dans toute l'Europe. Ses méthodes d'éducation, concrètes
et directes, fondées sur le déve-
54 Busch
F. General orthopaedics, gymnastics and massage in Von Ziemssen’s
handbook of general therapeutics vol.5 New-York : William Wood &
Co ; 1886
Page 23
loppement
progressif de toutes les facultés, sont exposées dans
ses ouvrages. Ses principes éducatifs sont fondés
sur la présentation de l'aspect concret avant d'introduire
les concepts abstraits ; de commencer par l'environnement proche
avant de s'occuper du distant ; de faire précéder
d'exercices simples les exercices compliqués et enfin de
procéder graduellement et lentement. Tous ces pédagogues
ont fait progresser l’exercice physique en ce début du XIXème
siècle.
En
1836, le Docteur Lorinser  [1796–1853], avec une optique scientifique et médicale,
publie un livre
promouvant le retour de la gymnastique
dans les écoles.
C’est également à cette période qu’Adolf Spiess
[1796–1853], avec une optique scientifique et médicale,
publie un livre
promouvant le retour de la gymnastique
dans les écoles.
C’est également à cette période qu’Adolf Spiess
 (1810-1858) professait en Suisse
et en Allemagne.
Spiess, par rapport à Jahn, enseignait des mouvements plus
doux et réguliers. L’élève n’était pas
poussé au maximum de ses possibilités, ce n’était
plus une préparation au combat contre un ennemi puissant.
Régularité, précision du geste
et un port érigé importaient plus que la force. Avec
Spiess, se développent également les gymnases fermés,
la régularité et la précision n’étaient
pas perturbées par les aléas météorologiques.
Spiess proposa un programme pour les garçons et les filles
de tous les âges
.
Cette succession de médecins, de pédagogues, de professeurs
a développé une gymnastique nationale partout et pour
tous.
Le terme de heilgymnastick (gymnastique médicale) apparaît
dans les années 1840 sous la plume de Hugo
Rothstein (1810-1858) professait en Suisse
et en Allemagne.
Spiess, par rapport à Jahn, enseignait des mouvements plus
doux et réguliers. L’élève n’était pas
poussé au maximum de ses possibilités, ce n’était
plus une préparation au combat contre un ennemi puissant.
Régularité, précision du geste
et un port érigé importaient plus que la force. Avec
Spiess, se développent également les gymnases fermés,
la régularité et la précision n’étaient
pas perturbées par les aléas météorologiques.
Spiess proposa un programme pour les garçons et les filles
de tous les âges
.
Cette succession de médecins, de pédagogues, de professeurs
a développé une gymnastique nationale partout et pour
tous.
Le terme de heilgymnastick (gymnastique médicale) apparaît
dans les années 1840 sous la plume de Hugo
Rothstein
 [1810-1865]. Albert
Neumann
[1803-1870], médecin s’occupant de gymnastique
médicale et Moritz
Eulenburg [1810-1865]. Albert
Neumann
[1803-1870], médecin s’occupant de gymnastique
médicale et Moritz
Eulenburg
 [1811–1887], directeur de l’institut de gymnastique
suédoise de Berlin présente la gymnastique de Ling [1811–1887], directeur de l’institut de gymnastique
suédoise de Berlin présente la gymnastique de Ling
 [1811–1887] mais sans présenter le massage. [1811–1887] mais sans présenter le massage.
55 Lorinser
K.I. Zum Schutz der Gesundheit in den Schulen Berlin : Ludwig Hold
; 1836
56 Busch
F. General orthopaedics, gymnastics and massage in Von Ziemssen’s
handbook of general therapeutics vol.5 New-York : William Wood &
Co ; 1886
57 Ibid
58 Spiess
A. Turnbuch für Schulen als Anleitung fiir den Turnunterricht
durch die Lehrer der Schulen 2vol. Bale : Schweighaufer’sche Verlagsbuchhandlung
; 1847
59 Spiess
A. Die Lehre der Turnkunst 4 vol. Bale : Schweighaufer’sche Verlagsbuchhandlung
; 1874
60 Busch
F. General orthopaedics, gymnastics and massage in Von Ziemssen’s
handbook of general therapeutics vol.5 New-York : William Wood &
Co ; 1886
61 Quin
G. Approche
comparée des pratiques médicales de « massage
» et de « gymnastique » à la fin du XIXème siècle
et au début du XXème siècle (Angleterre, France, Allemagne, Suisse)
Histoire des sciences médicales 2014 ; 48(2) : 215-24
62 Neumann
A.C. Die Heil-gymnastick oder die Kunst
die Leibesübungen, angewandt zur Heilung von Krankheiten Berlin
: P.Jeanrenaud ; 1852
63 Eulenburg
M. Die Schwedische Halgymnastik, Versuch
einer wissenschaftlichen Begründung derselben Berlin : A. Hirschwald
; 1853
Page 24
La
première guerre
mondiale, l’hyperinflation jusqu’en 1924, le chômage ne sont
guère propices à la gymnastique et au massage.
Les réformes de la « Grande coalition »
de Stresemann  [Gustav
1878-1929] ont permis au pays de se redresser. La montée
du nationalisme et du fascisme fera renaître les activités
sportives comme enrôlement social. [Gustav
1878-1929] ont permis au pays de se redresser. La montée
du nationalisme et du fascisme fera renaître les activités
sportives comme enrôlement social.
En
1741, Nicolas
Andry de Boisregard
 [1658-1742],
crée le néologisme « orthopédie »,
qui progressivement tendra à regrouper toutes les activités
de redressement des difformités corporelles. Comme le titre
de son ouvrage, l’indique ses recommandations pratiques sont surtout
pédagogiques, liées à la transformation d’habitudes
et d’attitudes corporelles. Il ne propose pas encore une gymnastique
rationnelle, mais participe à l’amorce d’un mouvement portant
une attention nouvelle au physique de l’Homme.
[1658-1742],
crée le néologisme « orthopédie »,
qui progressivement tendra à regrouper toutes les activités
de redressement des difformités corporelles. Comme le titre
de son ouvrage, l’indique ses recommandations pratiques sont surtout
pédagogiques, liées à la transformation d’habitudes
et d’attitudes corporelles. Il ne propose pas encore une gymnastique
rationnelle, mais participe à l’amorce d’un mouvement portant
une attention nouvelle au physique de l’Homme.
Vandermonde
 (1727-1762) a une approche singulière tendant vers
l’eugénisme.
C’est à Desessartz
(1727-1762) a une approche singulière tendant vers
l’eugénisme.
C’est à Desessartz  [Gustav 1729-1811], avec
son « Traité de l'éducation corporelle
des enfants en bas âge » et à Verdier
[Gustav 1729-1811], avec
son « Traité de l'éducation corporelle
des enfants en bas âge » et à Verdier  (1735-1820) avec son « Discours sur l’éducation
nationale, physique et morale des deux sexes »
que l’on doit une approche médicale c’est à dire à
la fois hygiéniste et thérapeutique des exercices
du corps .
Desessartz aurait inspiré Jean-Jacques Rousseau pour son
« Emile ». Un sujet helvète, Ballexserd
(1726-1774) qui aurait plagié Rousseau dans sa « Dissertation sur l'éducation
physique des enfans (sic) »
peut leurs être associé, tout comme Clément
Joseph Tissot
(1735-1820) avec son « Discours sur l’éducation
nationale, physique et morale des deux sexes »
que l’on doit une approche médicale c’est à dire à
la fois hygiéniste et thérapeutique des exercices
du corps .
Desessartz aurait inspiré Jean-Jacques Rousseau pour son
« Emile ». Un sujet helvète, Ballexserd
(1726-1774) qui aurait plagié Rousseau dans sa « Dissertation sur l'éducation
physique des enfans (sic) »
peut leurs être associé, tout comme Clément
Joseph Tissot  (1747-1826) avec son « Essai
sur l’utilité des mouvements ou des différents exercices (1747-1826) avec son « Essai
sur l’utilité des mouvements ou des différents exercices
64 Andry
de Boisregard N. L'Orthopédie ou
l'Art de prévenir et de corriger dans les enfans les difformités
du corps. Le tout par des moyens à la portée des Pères
& des Mères, & de toutes les personnes qui ont des
enfans à élever. Bruxelles : Georges Fricx ; 1743
TDM  [1ère éd. 1741] [1ère éd. 1741]
65 Quin
G. Genèse et structure d'un inter-champ
orthopédique (première moitié du XIXème siècle)
: Contribution à l'histoire de l'institutionnalisation d'un
champ scientifique. Revue d'histoire des sciences 2011 ; 64(2) :
323-47
66 Vandermonde
Ch.-A. Essai sur la manière de perfectionner l'espèce
humaine Paris : Vincent ;1756
67 Desessartz
J.Ch. Traité de l'éducation corporelle des enfants
en bas âge Paris : J. Th. Hérissant ; 1760
68 Verdier
J. Discours sur l’éducation nationale, physique et morale
des deux sexes Paris : chez l’auteur ; 1772
69 Quin,
G. Genèse et structure d'un inter-champ orthopédique
(première moitié du XIXème siècle) : Contribution à l'histoire de
l'institutionnalisation d'un champ scientifique. Revue d'histoire
des sciences
2011 ; 64(2) : 323-47
70 Ballexserd
J. Dissertation sur l'éducation physique des enfans depuis
leur naissance jusqu'à l'âge de puberté Paris
: Vallat-La-Chapelle ; 1762
Page 25
du
corps » .
Les progrès de l’orthopédie au XVIIIème
siècle s’expriment à travers un plus large choix thérapeutique.
De nouvelles pratiques émergent, notamment les exercices
corporels. Ils ne
correspondent pas à de la véritable "gymnastique
orthopédique"
mais à des pratiques rationnelles.
Les principales innovations orthopédiques du XVIIIème
siècle restent cependant, malgré les critiques,
davantage dans le domaine technique avec le « lit mécanique
» ou le « lit à extension » ou encore le
corset redresseur.
Les
médecins intéressés par l’éducation
physique et la gymnastique,
dans la première moitié du XIXème
siècle, font figure de pionniers. Quin
les dénomme « médecins-orthopédistes »
pour les démarquer des orthopédistes non médecins
qui gravitent auprès d’eux. Claude
Jacques Mathieu Delpech  (1777-1832),
Sauveur Henri
Victor Bouvier (1799-1877),
Charles Pravaz
(1777-1832),
Sauveur Henri
Victor Bouvier (1799-1877),
Charles Pravaz
 (1791-1853), Vincent
Duval, Jules Guérin,
traitent pieds bots, luxations congénitales de hanche, affections
de la colonne vertébrale et notamment les scolioses. Ils
traitent en tant que chirurgien mais aussi dans les instituts d’orthopédie
qu’ils dirigent à Paris ou dans des villages de province,
. (1791-1853), Vincent
Duval, Jules Guérin,
traitent pieds bots, luxations congénitales de hanche, affections
de la colonne vertébrale et notamment les scolioses. Ils
traitent en tant que chirurgien mais aussi dans les instituts d’orthopédie
qu’ils dirigent à Paris ou dans des villages de province,
.
Depuis
la promulgation de la loi le 4 décembre 1794, par la Convention,
il n’y a que trois Facultés de Médecine (Paris, Montpellier
et Strasbourg) et une vingtaine d’Écoles de médecine
préparant les étudiants. Le 10 mars 1803 (19 ventôse
an XI) une nouvelle loi donne un système cohérent
à la médecine française. Pour obtenir un doctorat
en médecine ou en chirurgie, il faut étudier au moins
quatre années dans une école médicale et passer
une série d’examens ouvrant ensuite les portes de la pratique
sur l’ensemble du territoire français. Par contre, les Officiers
de santé devaient étudier au moins trois ans dans
une école médicale, ou bien servir un médecin
durant six an-
71 Tissot
C.-J. Gymnastique médicinale et
chirurgicale, ou essai sur l'utilité du mouvement, ou des
différents exercices du corps, et du repos dans la cure des
maladies Paris : Bastien ; 1780 TDM 
72 Ibid.
73 Londe
Ch. Bibliographie : Nouvelles preuves du danger des lits mécaniques
Archives générales de médecine 1828 ; 1(16),
646-8
74 Quin,
G. Genèse et structure d'un inter-champ orthopédique
(première moitié du XIXème siècle) : Contribution à l'histoire de
l'institutionnalisation d'un champ scientifique. Revue d'histoire
des sciences
2011 ; 64(2) : 323-47
75 Monet
J., Quin G. Sauveur-Henri-Victor Bouvier (1799–1877) : orthopédiste,
chirurgien et promoteur
de l’éducation
physique Gesnerus 2013 ; 70(1) : 53–67
76 Quin
G. Jules Guérin: brève biographie d’un acteur de l’institutionnalisation
de l’orthopédie (1830-1850) Gesnerus 2009 ; 66(2) : 237–55
77 Quin
G., Monet J. De Paris à Strasbourg : L’essor des établissements
orthopédiques et gymnastiques (première moitié
du XIXème
siècle) Histoire des Sciences médicales 2011 ; 45(4)
: 369-79
78 Desseaux
A. François
Humbert, orthopédiste
méconnu, initiateur du traitement curatif des “boiteux” Histoire
des sciences médicales 2015 ; 49(3/4) : 381-92
Page 26
nées,
ou encore servir dans un hôpital pendant cinq ans.
L’officiât de Santé sera supprimé en 1892. Cependant,
à cette époque, il n’y a pas de Ministère de
la Santé ni d’Ordre des Médecins. Les seuls organismes
nationaux sont l’Académie de Médecine, créée
sous la Restauration en 1820 et le Conseil supérieur de l’Hygiène.
Les hôpitaux sont autonomes et n’acquièrent une fonction
thérapeutique que pendant cette période. Ainsi la
Santé dépend d’organismes différents. Le Ministère
de l’Intérieur gère la défense contre les épidémies,
le Ministère du Commerce lutte contre les falsifications
alimentaires ou les intoxications. La médecine sort difficilement
du statut de métier au service de la noblesse et de la bourgeoisie
aisée.
L’État devient prégnant sur la médecine et
la chirurgie.
Le
massage est aux mains des « rebouteurs »,
« rebouteux »,
« rhabilleurs »,
« souffleur
d'entorses, » [Fig.2]
dans les campagnes ou les villes, aux mains des « garçons
de bains » dans les bains
publics ou les villes thermales,
aux mains des gymnastes
dans les gymnases publics ou hospitaliers, aux mains de « garçons
de salle » dans les hôpitaux
.
Figure 2 : Rebouteux breton
massant une
cheville « foulée » [Le masseur de Pont-Scorit
 ] ] 
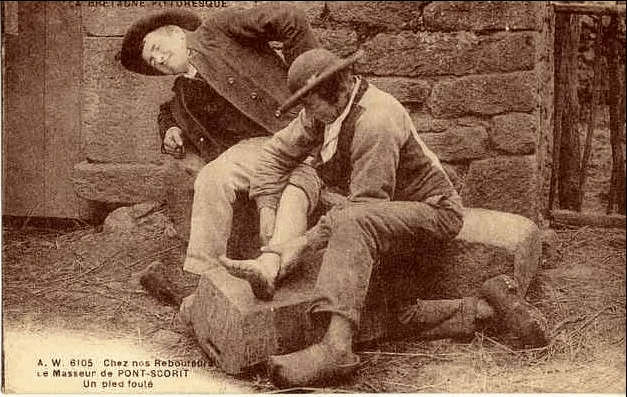
79 Quin
G. Le mouvement peut-il guérir
? Les usages médicaux de la gymnastique au XIXème siècle
Lausanne : Editions BHMS ; 2019
80 Defrance
J., Brier P., El Boujjoufi T. Transformations des relations entre
médecine et activités Gesnerus 2013 ; 70/1 : 86–110
81 Petit
L. Le massage par le médecin, physiologie,
manuel opératoire, indications Paris : Alexandre Coccoz ;
1885 TDM 
82 Lardry
J-M. Etude de l’ouvrage intitulé
« Du massage, son historique, ses manipulations, ses effets
thérapeutiques TDM 
» du Dr Jean Dominique
Joachim Estradère Kinesither Rev 2016 ; 16(171) : 88-91
Page 27
« Le
rebouteur est né, a vécu et continue à vivre
de par la faute du médecin » écrit Léon
Petit,
« l’étudiant manque d’enseignement, le médecin
ne sais pas pratiquer si, malgré tout, il s’y essaie il n’a
pas de résultat et abandonne en faisant appel à des
mains auxiliaires ».
Pour Murrell au début du siècle le « vrai
massage était
pratiqué en France » mais les professeurs étaient peu
enclins à dispenser leur savoir.
Même
si des actions communes avec la médecine apparaissent,
la gymnastique
peine à se faire reconnaître en France malgré
la place qu’elle a prise en Allemagne.
Des conflits apparaissent entre le Docteur Lachaise et Amorós
par exemple.
Don Francisco
Amorós y Ondeano, marquis de Sotelo, colonel espagnol
pro-napoléonien a fui l’Espagne après la défaite
de Victoria. Il dirige le gymnase normal civil et militaire à
Grenelle. Il travaille en collaboration avec les Docteurs Begin
et Verdier qui lui confient des jeunes filles avec des problèmes
orthopédiques. En raison du non-respect
des consignes médicales, le Docteur Lachaise refuse une compétence médicale au
colonel Amoros
en s'opposant à titre personnel aux redressements
de la colonne vertébrale à l'aide de machines orthopédiques.
À
l’inverse, en 1847, très précisément le 12
juillet, s’est déroulée la première séance
d’exercices de gymnastique dans un hôpital, « d’emblée,
on crée un cours pour les garçons (20 scrofuleux)
et un autre pour les filles (15 scrofuleuses) ».
C’est Napoléon
Laisné (1810-1896) qui est le premier « gymnasiarque
hospitalier » selon l’expression de l’époque.
En 1831, comme sous-officier, il dirige le gymnase de son régiment
à Metz. En 1835, il est aux côtés d’Amorós.
En 1840, il professe à l’institution des jeunes aveugles.
En 1842, il crée le gymnase du lycée de Versailles
et y enseigne.
83 Ibid
84 Murrell
W. Massotherapeutics or Massage as a mode
of treatment Philadelphia : Blakiston, son & C° ; 1890
85 Defrance
J., Brier P., El Boujjoufi T. Transformations des relations entre
médecine et activités Gesnerus 2013 ; 70/1 : 86–110
86 Quin
G. Genèse et structure d'un inter-champ
orthopédique (première moitié du XIXème siècle)
: Contribution à l'histoire de l'institutionnalisation d'un
champ scientifique. Revue d'histoire des sciences 2011 ; 64(2) :
323-47
87 Quin
G. A Professor of Gymnastics in Hospital. Napoléon Laisné
(1810-1896) introduce Gymnastics at the « Hôpital des
Enfants malades » Staps 2009 ; 86(4) :79-91
88 Lardry
J-M. Étude de l’ouvrage «
Application de la gymnastique à la guérison de quelques
maladies avec des observations sur l’enseignement actuel de la gymnastique
» de Napoléon-Alexandre
Laisné. Kinesither Rev 2016 ;16(174)
: 63-6
Page 28
En
1846, ce sera la création d’un gymnase pour chaque sexe à
l’institution de Sourds-Muets. En 1847, il sera choisi par l’administration
hospitalière pour assurer les nouveaux enseignements de gymnastique
créés à l’Hôpital des Enfants Malades.
Laisné
séduit les médecins et l’Assistance publique qui multiplient
les sites dispensant un enseignement de gymnastique. En 1849, ce
sera à l’Hôpital de la Salpêtrière, un
second gymnase verra le jour en 1853, puis en 1854 aux Hospices
de Bicêtre, enfin en 1861 à l’Hospice des Enfants-assistés.
En
1847, l’année où Laisné débute sa gymnastique
hospitalière, Carl
August Georgii [1808-1881]
publie « Kinesitherapie ou Traitement des maladies par
le mouvement TDM  [1845 pour l'édition Originale suédoise]».
Il est le représentant officiel de Hjalmar
Ling, fils de Pehr
Henrik Ling fondateur de la méthode éponyme.
Les critiques du chirurgien François
Malgaigne lui font quitter Paris
pour Londres. Il y publie un travail original
différent de l'ouvrage publié
en France. [1845 pour l'édition Originale suédoise]».
Il est le représentant officiel de Hjalmar
Ling, fils de Pehr
Henrik Ling fondateur de la méthode éponyme.
Les critiques du chirurgien François
Malgaigne lui font quitter Paris
pour Londres. Il y publie un travail original
différent de l'ouvrage publié
en France.
Les
années suivantes paraissent des publications majeures concernant
le massage
la thèse d’Estradère,
l’ouvrage de Laisné sur le massage
et celui de Phélippeaux.
Qu’Estradère ou Phélippeaux, médecins, publient
sur le massage ne peut pas nous étonner. Le massage
peut, par contre, être étranger à un gymnasiarque
comme Napoléon Laisné. Il n’en est rien, comme le
prouve, par exemple, les 70 occurrences de ce mot dans son « Application
de la gymnastique à la guérison de quelques maladies… ».
La lecture des travaux de Laisné, nous montre que sous le
vocable de « gymnastique » se cachent aussi
des exercices et des massages. Il va contribuer à
légitimer le massage par l’emploi raisonné
qu’il fait de celui-ci
et par sa publication de 1868.
89 Georgii
A. Kinésithérapie ou Traitement
des maladies par le mouvement selon la méthode de Ling Paris
: Germer Baillière ; 1847 TDM 
90 Georgii
A. A few words on kinesipathy or swedish medical gymnastics. The
application of active and passive movements to the cure of diseases
according to the method of P.H. Ling London : Hippolyte Bailliere
; 1850
91 Estradère
J. Du massage, son historique, ses manipulations, ses effets thérapeutiques
Paris : Adrien Delahaye ; 1863
92 Laisné
N. Du massage, des frictions et manipulations
appliquées à la guérison de quelques maladies
Paris : Victor Masson et fils ; 1868 ***
* 
93 Phélippeaux
M.V.A. Etude pratique sur les frictions
et le massage ou guide du médecin masseur Paris : l’Abeille
Médicale ; 1869 TDM  [Note du CFDRM l'édition originale
date de 1869] [Note du CFDRM l'édition originale
date de 1869]
94 Lainé
N. Application de la gymnastique à la guérison de
quelques maladies avec des observations sur l’enseignement actuel
de la gymnastique Paris : Louis Leclerc ; 1865 TDM 
95 Quin
G. Le mouvement peut-il guérir ? Les usages médicaux
de la gymnastique au XIXème siècle Lausanne : BHSM ; 2019
96 Laisné
N. Du massage, des frictions et manipulations appliquées
à la guérison de quelques maladies Paris : Victor
Masson et fils ; 1868
Page 29
Par
exemple, Murrell
de Londres, dans son traité aux nombreuses éditions,
signale que, pour lui, le meilleur massage
de l’abdomen est celui proposé par Laisné.
Le
Professeur Dujardin-Beaumetz
(1833-1895) tente d’imposer, en France,
le terme « massothérapie
» pour lier le massage à la médecine.
La
science commence également à avoir des appareils pour
enregistrer le geste
et ses conséquences sur l’organisme. Ainsi, l’apparition
des chronophotographies ou le sphygmographe de Marey (1830-1904),
des dynamomètres d’un usage facile,
l’arthro-dynamomètre de Jules
Amar [1879-1935],
qui permet de mesurer non seulement les amplitudes articulaires
mais aussi la force musculaire en fonction de l’angulation articulaire.
Il permet donc de faire une courbe tension-longueur du muscle.
Les
écoles de massage apparaissent sous la tutelle médicale
dans le cadre de la loi du 30 septembre 1892,
telle l’École Française d’Orthopédie et de
Massage (EFOM)
créée par le Docteur Archambaud,
toujours présente de nos jours à Paris. Cet établissement
a été créé en 1889 selon nos sources
[Fig.3],
en 1895 pour Quin
et Monet
et en 1899 pour Remondière.
En 1906, le docteur Fabre
ouvre la première école pour masseurs
aveugles [École
des masseurs et masseuses aveugles]. Les masseurs
médicaux voient leur nombre augmenter et leur
statut légal reconnu en 1937. Une partie des soldats
de la Grande Guerre, devenus aveugles, se reconvertissent en masseur,
avec la création d’un diplôme spécifique en
1927.
97 Murrell
W. Massotherapeutics or Massage as a mode
of treatment Philadelphia : Blakiston, son & C° ; 1890
98 Monet J. La naissance
de la kinésithérapie Paris : Glyphe ; 2009 **** TDM 
99 Petitdant
B. Origines, histoire, évolutions
de la mesure de la force de préhension et des dynamomètres
médicaux Kinesither Rev 2017 ; 17(181) : 40-58
100 Petitdant
B. Le goniomètre médical au fil du temps Kinesither
Rev 2016 ; 16(179) : 48-61
101 Amar
J. Principes de rééducation
fonctionnelle Académie des sciences séance du 19 avril
1915 CR hebdo Sciences 1915 ; 160 : 559-62
102 Hoerni
B La loi du 30 septembre 1892 Histoire des Sciences médicales
1998 ; 1(32) : 63-7
103 Quin
G. Approche comparée des pratiques médicales de »massage
» et de « gymnastique » à la fin du XIXème siècle
et au début du XXème siècle (Angleterre, France, Allemagne, Suisse)
Histoire des sciences médicales 2014 ; 48(2) : 215-24
104 Monet
J. Emergence de la Kinésithérapie en France à
la fin du XIXème et au début du XXème siècle Thèse Doctorat Sociologie, Université
Paris I Panthéon-Sorbonne Juin 2003
105 Remondiere
R. L'institution de la kinésithérapie
en France (1840-1946), Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques
12 | 1994, mis en ligne le 27 février 2009, consulté
le 10 décembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/ccrh/2753 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ccrh.2753
106 Ibid
Page 30
Figure
3 : Médaille commémorative du centenaire
de l’EFOM 

Il
faut remarquer que l’EFOM se revendique de l’orthopédie et
non de la gymnastique suédoise. Les cours sont d’abord ouverts
aux médecins et aux étudiants en médecine,
une formation secondaire s’ouvre pour les masseurs.
Bourneville
indique clairement le rôle de chacun « les masseurs
et masseuses
doivent borner leur rôle à exécuter fidèlement
les prescriptions médicales, et se garder de prendre aucune
espèce d’initiative. … Un massage hors de propos peut
déterminer des accidents mortels. » Dans les hôpitaux,
le massage est mis en œuvre par les infirmières [Fig.4].
107 Bourneville Dr Manuel pratique de la garde-malade et de l’infirmière
Paris : Progrès médical ; 1889 TDM 
Page 31
Figure 4 : Diplôme d’Infirmière-Masseuse de l’EFOM de 1932 © Collection de l’auteur 
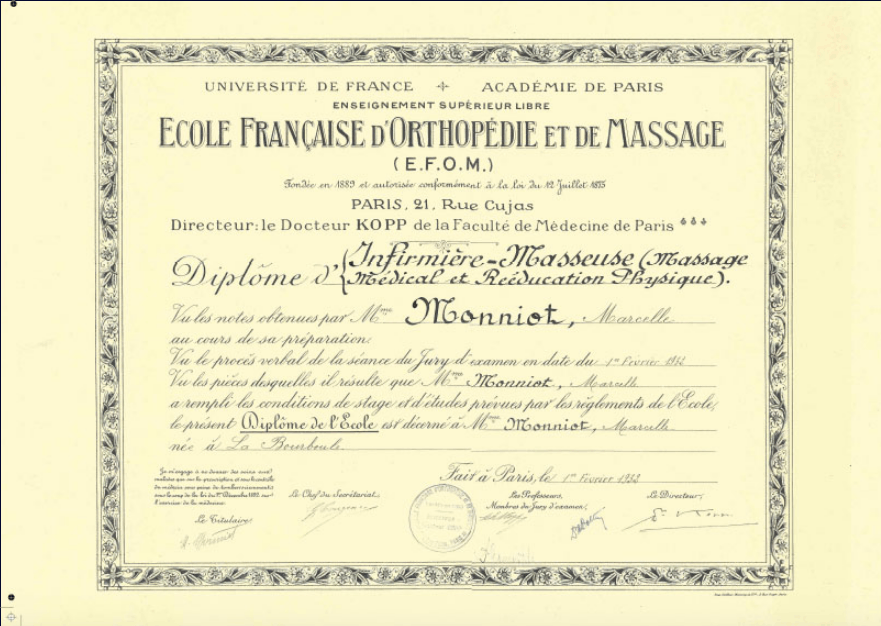
La
littérature sur le massage s’enrichit de nombreuses
publications, souvent rééditées jusqu’à
l’entre-deux-guerres, telles celles de Just
Lucas-Championnière [Fils],
Georges Berne,
Gustav Norström.
Quant à Georges
de Frumerie [le CFDRM dispose
du prénom de Gustave]
,
il multiplie les publications, car il enseigne aux infirmières
et aux médecins et publie ses cours.
108 Lucas-Championnière
J. Traitement des fractures par le massage
et la mobilisation Paris : Rueff et Cie ; 1895 TDM 
109 Berne
G. Le massage manuel théorique
et pratique Paris : Rueff et Cie ; 1894 TDM 
110 Norström
G. Formulaire du massage Paris : JB Baillière
; 1895 TDM 
111 de
Frumerie
G. La pratique du massage. Cours à
l’usage des infirmiers et infirmières Vigot : Paris ; 1901
TDM 
112 de
Frumerie G. Cours de massage accessoire des soins d’accouchements
à donner aux femmes enceintes et parturientes aux nourrices
et nourrissons Vigot : Paris ; 1904 TDM 
113 de
Frumerie G. Le massage pour tous Indications et technique du massage
général Vigot : Paris ; 1917 2ème éd. TDM 
114 de
Frumerie G. Traitement manuel des déviations pathologiques
du rachis Vigot : Paris : 1924 TDM 
115 de
Frumerie G. La pratique du massage. Manuel à l’usage des
étudiants en médecine, des infirmiers et infirmières,
des candidats au diplôme de l’état de masseur et de
masseuse Vigot : Paris ; 1941 TDM 
Page 32
En
1900, des médecins fondent la Société
de Kinésithérapie (SDK) et en 1912 le Syndicat
des médecins-masseurs.
La Revue de Cinésie et d’Électrothérapie publie
les comptes rendus des séances de la Société.
Toutes les facettes de cette nouvelle spécialité médicale
qu’est la massothérapie
sont représentées par les instances dirigeantes et
les membres fondateurs. Le Dr Just
Luca Championnière [le fils], promoteur
du massage
dans les fractures, en est le Président,
le Dr Fernand
Lagrange, promoteur de la gymnastique suédoise
et de la mécanothérapie,
le Vice-président, le Dr Horace
Stapfer, promoteur de la kinésithérapie
gynécologique, le Trésorier et enfin le Dr Mesnard,
promoteur de la gymnastique
orthopédique, le Secrétaire
[Fig.5].
Figure
5 : Schématisation des pôles
d’intérêts de la SDK à sa création et
leurs animateurs d’après Monet 
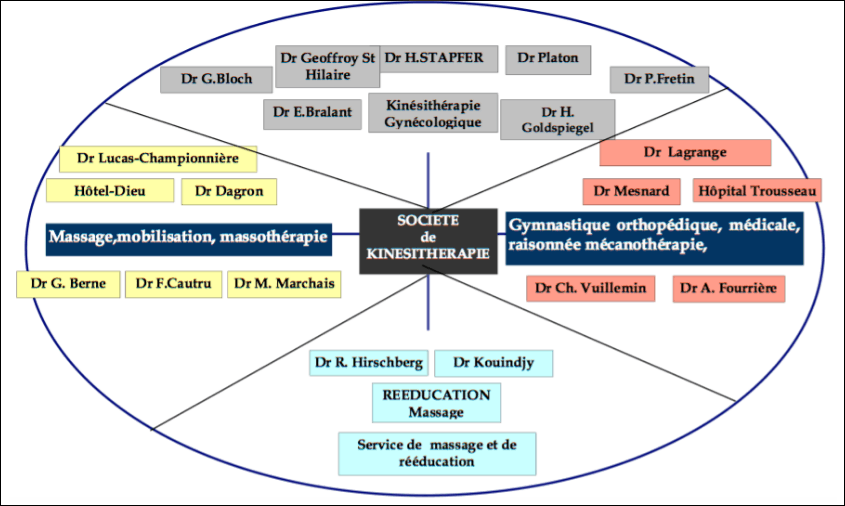
Le
Président d’Honneur est le Pr Etienne-Jules
Marey [1830-1904]
, membre de l’Institut, Professeur au Collège de France,
Président de l’Académie de Médecine en cette
année 1900. Ses travaux sur le mouvement et la locomotion,
ses titres, apportent une forme
116 Remondiere
R. L'institution de la kinésithérapie
en France (1840-1946), Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques
12 | 1994, mis en ligne le 27 février 2009, consulté
le 10 décembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/ccrh/2753 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ccrh.2753
117 Monet
J. Emergence de la Kinésithérapie
en France à la fin du XIXème et au début du XXème siècle, Thèse Doctorat Sociologie, Université
Paris I Panthéon-Sorbonne Juin 2003 TDM 
Page 33
de
reconnaissance à cette Société prônant
l’utilisation du mouvement et d’exercices justifiés scientifiquement.
La
Grande Guerre
par ses millions de blessées, de « gueules cassées »
donne un élan extraordinaire au massage,
à la rééducation
et à la réadaptation118, mais ce n’est qu’un catalyseur.
En effet c’est la longue évolution, décrite en amont,
qui a permis d’en arriver là.
Le
Royaume Uni est une terre de sports,
la gymnastique médicale ou scolaire n’y a jamais pris une
grande place.
En
1794, John Pugh
[1794-1830] publie un traité
où il consacre plusieurs chapitres aux méfaits de
l’inactivité, à la nécessité et à
l’importance de l’exercice. En 1808, Barcklay
signale des traitements musculaires par percussions.
John
Grosvenor (1742-1823), chirurgien à Oxford, traite
les articulations enraidies par des frictions.
Le docteur Gower
décrit ses inventions dans un petit livre. Il évoque
les frictions ou shampooing, lors de la description
du Pulsator instrument de massage destiné aux
percussions. Il y décrit également le Sudatorium,
une enceinte individuelle pour bain de vapeur
en décubitus, l’Illuminator sorte de lanterne magique,
ancêtre du laryngoscope et le Valetudinarian, siège
pour soutenir à l’horizontale un membre inférieur
fracturé. Il a fait évoluer ce même siège
en siège obstétrical ou en un lit avec option dite
garde–robe pour les soins d’hygiène. Gibney
consacre, une
118 Remondière R. La mécanothérapie au
temps de la Grande Guerre Revue historique des armées [En
ligne], 274 | 2014, mis en ligne le 18 juillet 2014, consulté
le 11 décembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/rha/7969
119 Busch
F. General orthopaedics, gymnastics and massage in Von Ziemssen’s
handbook of general therapeutics vol.5 New-York : William Wood &
Co ; 1886
120 Pugh
J. A physiological, theoric and practical
treatise on the utility of the science of muscular action for restoring
the power of the limbs London : C. Dilly ; 1794
121 Barcklay
J. The muscular motion of the human body
Edinburgh : W. Laing and A. Constable ; 1808 TDM
122 Cleoburey
W. A full account of the system of friction,
as adopted and pursued with the greatest success in cases of contracted
joints and lameness, from various causes Oxford : Munday and Slatter
; 1825
123 Gibney
J. A treatise on the properties and medical
application of the vapour bath: in its different varieties and their
effects : in various species of diseased action London : Thomas
and George Underwood ; 1829 TDM
Page 34
partie
des chapitres 6 et 7 de son traité, à la description
du shampooing
et aux avantages des frictions et des percussions.
Nous
sommes sous le règne de la Reine Victoria. Cette période
est riche, les débuts de l’émancipation de la femme,
les progrès de l'hygiène, mais aussi la surpopulation
des villes, le problème irlandais, le libéralisme
politique et économique, les guerres
outremer, le colonialisme.
Dans
les années 1880, le massage intéresse la médecine.
Des masseurs
et masseuses
étrangers enseignent des rudiments aux infirmières.
Le nombre de masseuses augmentent, certaines sans aucune
qualification, avec des débouchés devenus rares. La
fin du siècle est marquée, à partir de 1894,
par un scandale. Il débuta par le signalement dans le British
Medical Journal
(BMJ) d’établissements de prostitution
dissimulés en salons
de massage. Le titre accrocheur du BMJ, attire l’attention
de la presse grand public, l’affaire remonte jusqu’à la Chambre
des Communes. En réaction, des professionnelles créent
la Society of Trained Masseuses (STM). Elle gère l’enseignement,
les examens, la délivrance du diplôme. En 1900, en
acquérant les statuts d’organisation professionnelle, la
STM devient l’Incorporated Society of Trained Masseuses (ISTM).
Plus tard, l’Institute of Massage and Remedial Gymnastics rejoint
l’ISTM. En 1920, le Roi George V octroie une charte royale et l’ISTM
devient Chartered Society of Massage and Remedial Gymnasts. Elle
est connue, depuis 1944, sous le nom de Chartered Society of Physiotherapy.
Parallèlement,
l'« Institut
suédois » a été
fondé en 1904 par le Dr Mary
Coghill-Hawkes. C’est la première
école de ce type en Grande-Bretagne donnant une formation
semblable aux écoles de Stockholm. L'Institut délivre
ses propres certificats et présente les étudiants
pour les examens de l’ISTM.
Au
Royaume Uni également, la Grande
Guerre donne une forte expansion au massage et
à la rééducation.
L’Almeric
Paget Massage Corps (APMC), corps
de 50 masseuses
financé par le riche député Almeric Paget,
a été rapidement mis en place. Les
124 Anonyme
Immoral « massage » establishment Br Med J 1894 ; 2:
88
125 Nicholls
D.A., Cheek J. Physiotherapy and the shadow of prostitution: the
Society of Trained Masseuses and the scandals of 1894 Soc Science
Med 2006; 62 : 2336-48
Page 35
membres de l’APMC devaient avoir le certificat
de formation délivré par l’ISTM. Le conseil de l’ISTM
a encouragé ses membres à rejoindre l’APMC. De septembre
à novembre 1914, les 50 masseuses ont travaillé dans des hôpitaux militaires
en Grande-Bretagne. Le flot des victimes grossissant, le War Office
demande aux Paget de financer une clinique de massages et de consultations externes à Londres.
En 1915, ce sont près de 200 patients par jour qui sont traités.
Pendant l’été 1915, 150 masseuses travaillaient pour l’APMC dans 110 hôpitaux
et institutions militaires. Financé maintenant par le War Office,
en décembre 1916, l’APMC devient Almeric
Paget’s Military Massage Corps (APMMC).
À
cette date également, des hommes devenus aveugles au front,
titulaires du certificat de l’ISTM sont embauchés. En 1917, l’APMMC est présent également
en France et en Italie. En janvier
1919, l’APMMC fut dissout et ses membres invités à
rejoindre son remplaçant, le Military
Massage Service .
Les
massage sisters, les infirmières-masseuses,
les masseurs
et masseuses qualifiés se rencontrent couramment dans
les années 1920 dans les hôpitaux grands et petits
et dans les maisons de convalescence. En 1907,
Goldstone
a analysé les questions posées lors des examens de
l’ISTM. Dix des douze questions portent sur
le massage
et en 1908, huit sur neuf. A la fin des années 1930, seul
un tiers des questions porte sur le massage. Pour Goldstone,
le massage
était à son apogée pendant la Grande
Guerre et immédiatement
après. Puis l’électrothérapie, l’hydrothérapie, les machines, les appareils à rayons violets
sont devenus bien plus populaires sans pourtant supplanter complètement
le massage.
Ces techniques à la mode furent elles-mêmes détrônées,
d’autres sont apparues mais le massage est toujours là.
Au
XIXème et au début du XXème
siècle, la Suède est la référence de
toute l’Europe en gymnastique, avec Pehr
Henrik Ling (1776-1839) comme figure de proue. Il est
originaire de la province de Smaland, au Sud de la Suède.
Il devient orphelin de père peu de temps après sa
naissance, puis quelque temps plus tard sa mère décède.
Il
126 http://www.csp.org.uk/frontline/article/foreign-fields-physiotherapy-during-first-world-war
 consulté le
15 décembre 2020 [Note
CFDRM la page n'est plus accessible le 14 Mars 2022] consulté le
15 décembre 2020 [Note
CFDRM la page n'est plus accessible le 14 Mars 2022]
127 http://www.scarletfinders.co.uk/180.html
 consulté le
15 décembre 2020 consulté le
15 décembre 2020
128 Goldstone
A.L. Massage as an orthodox medical treatment past and future Complementary
Ther Nursing Midwifery 2000 ; 6 : 169-71
Page 36
est
soumis à un tuteur sévère. Il étudie
ensuite à Wexio en Gothie méridionale où son
assiduité et ses capacités sont remarquées.
De sa sortie de l’école, jusqu’à ses examens de théologie
en Småland en décembre 1797 il voyagea. Son périple
reste peu précis, voire inconnu. Il devint précepteur
dans plusieurs familles. En 1800, il étudie à Copenhague,
l’année suivante il est volontaire sur un bateau danois lors
d’une bataille navale contre l’Amiral Nelson. Il se déplace
en Europe malgré son dénuement et revient en Suède
avec une bonne connaissance des langues des pays visités.
Lors d’un nouveau séjour à Stockholm, il se passionne
pour l’escrime et y excelle. L’escrime améliore un rhumatisme
dont il souffre au niveau du bras. Il en déduit qu’un exercice
systématisé peut avoir un effet bénéfique
pour rétablir la santé, la force ou la beauté.
Contrairement à ses prédécesseurs, il ne cherche
pas à copier les Anciens (quoiqu’on lui prête de s’être
inspiré du Kung-Fu
chinois [Note CFDRM Notice du Cong-Fou des Bonzes Tao-sée de 1779 pour le tome IV.  du
Révérent Père Amiot.]) mais réforme la gymnastique. Il est influencé par les travaux de Franz
Nachtegall (1777-1847), le père
de la gymnastique danoise, lui-même influencé par Johann
Christoph Friedrich Gutsmuths. Influence à laquelle
s’ajoutent les travaux de Saltzman et de Friedrich Ludwig Jahn . du
Révérent Père Amiot.]) mais réforme la gymnastique. Il est influencé par les travaux de Franz
Nachtegall (1777-1847), le père
de la gymnastique danoise, lui-même influencé par Johann
Christoph Friedrich Gutsmuths. Influence à laquelle
s’ajoutent les travaux de Saltzman et de Friedrich Ludwig Jahn .
La
gymnastique pédagogique, la gymnastique militaire, la gymnastique
médicale et la gymnastique esthétique
sont les 4 branches de la gymnastique reconnue par Pehr
Henrik Ling [Fig.6].
Pour Ling, la gymnastique n’est donc pas uniquement pour les bien-portants
mais également pour aider les malades à recouvrer
la santé.
Figure
6 : Portrait de Pehr Henrik Ling


129 Pfister
G. Cultural confrontation : German Turnen, swedish gymnastics and
english sports- european diversity in physical activities from a
historical perspective Culture, Sport, Society 2003 ; 6(1) : 61-91
Page 37
Le
point qui lui importait avant tout, était l’exécution
intelligente et précise des mouvements. Pour tous les mouvements
passifs ou actifs, une stricte observance de leur
direction, de leur rythme, de leur force doit être de mise.
Il imagine les mouvements
actifs, résultat de l’activité contractile
du sujet et passifs, résultat d’une activité extérieure
sur tout ou partie du corps.
Après
quelques déboires, le roi de Suède
lui accorde un établissement à Stockholm dénommé
Institut de Gymnastique. Ling explique les mouvements du corps par
la physiologie. Cette gymnastique rationnelle s’applique surtout
à une meilleure connaissance des exercices militaires. Ling
commence en 1834 un ouvrage, Gymnastikens Allmänna Grunder.
Il sera publié à titre posthume, en 1840, par ses
élèves. Son héritage direct n’est que partiel,
peu concis et parfois difficile à comprendre.
Pour de Genst
c’est « un mélange curieux et caractéristique
de l’époque : imagination, empirisme, technique, science
et surtout amour de la vérité ».
Ses
élèves, associés à son fils Hjalmar,
développeront la gymnastique médicale pour le traitement
de nombreuses affections chroniques et la gymnastique éducative
pour lutter contre les effets pernicieux de l’oisiveté.
En
1864, un cours fut créé pour des professeurs féminins
sous l’impulsion de Santesson (1825-1892) [Berndt
Peter Anton Santesson] et d’Hildur
Ling [1825 - 1884],
la fille de Pehr Henrik Ling.
La gymnastique jusqu’alors exclusivement masculine s’ouvre, avec
quelques difficultés, aux filles et aux jeunes femmes.
L’institut
a essaimé dans toute l’Europe.
Pfister
s’interroge sur le succès et l’attractivité des exercices
répétitifs en groupes de la gymnastique suédoise.
Est-ce un désir profond des participants ou le pouvoir de
l’autorité sur des élèves ou des militaires ?
Elle l’explique par la situation politique à la suite des
guerres napoléoniennes. La Suède a rejoint la 3ème
coalition
130 Georgii C. Kinésithérapie
ou Traitement des maladies par le mouvement selon la méthode
de Ling Paris : Germer Baillière ; 1847 TDM 
131 Pfister
G. Cultural confrontation: German Turnen, swedish gymnastics and
english sports - european diversity in physical activities from
a historical perspective Culture, Sport, Society 2003 ; 6(1) : 61-91
132 de
Genst H. Histoire de l'éducation physique, tome II. Temps
modernes et grands courants contemporains Bruxelles : A. de Boeck
; 1949
133 Westberg
J. Adjusting swedish gymnastics to the female nature: discrepancies
in the gendering of girls’ physical education in the mid-nineteenth
century Espacio, Tiempo y Educatión 2018 ; 5(1) : 261-79
134 Pfister
G. Cultural confrontation: German Turnen, swedish gymnastics and
english sports - european diversity in physical activities from
a historical perspective Culture, Sport, Society 2003 ; 6(1) : 61-91
Page 38
contre
la France qui s’est terminée par la victoire d’Austerlitz.
En 1808, les concessions faites à la Russie par la France,
place la Suède en conflit avec la Russie
et le Danemark.
Ne pouvant combattre sur deux fronts, elle abandonne la Finlande.
La Suède est aux côtés des Alliés contre
Napoléon en 1813, ce qui lui vaut, en 1814 avec le traité
de Kiel, de pouvoir annexer la Finlande perdue aux débuts
des conquêtes napoléoniennes. La gymnastique suédoise
prépare les jeunes hommes à se battre pour leur pays.
Un
conflit entre la gymnastique suédoise et les Turnen
allemands (cf.3.1.1.), est connu sous le nom de Barrenstreit
qui peut se traduire par « le différent des barres ».
En effet les barres parallèles sont l’un des éléments
du différent. De grands noms s’investissent tel le physiologiste
Emil Du Bois-Reymond (1818-1898) [Note
CFDRM Emil Heinrich] ou Rudolf Virchow (1821-1902) l’un des
pères de l’anatomie pathologique, pour la défense
des barres parallèles et des Turnen en général,
mais leurs arguments sont rejetés par Pehr
Henrik Ling
A
travers toute l’Europe, des gymnasiarques
comme Jahn, Nachtegall
ou Amoros
vont développer des systèmes de pratiques d’exercice
corporel à l’échelle de leur pays respectif au cours
de la première moitié du XIXème
siècle. Ces systèmes « nationaux »
d’éducation physique doivent être pensés et
articulés avec l’émergence d’une modernité
médicale.
Dans son ouvrage, Georgii écrit précisément « Ling
entend par mouvements passifs tout mouvement communiqué,
tel que : pressions, frictions, percussions, froissements (massage),
tremblements, soulèvements, balancements, ligatures, mouvements ou attitudes propres à produire des
congestions sanguines, passagères et artificielles dans un
organe quelconque, etc. » Ainsi Georgii montre donc une évolution dans la
gymnastique suédoise, courant menée par Ling lui-même
d’après Georgii et par les utilisateurs de chaque pays.
Arvid
Kellgren, qui a été étudiant
de l’Institut Ling de 1877 à 1879 [Note
CFDRM l'Institut
royal central de gymnastique à Stockholm],
indique, lui aussi, que le massage fait partie du système de Ling. Il lance dès
la préface quelques piques contre Mezger. Il règle également des comptes envers
les auteurs étrangers
135 Ibid.
136 Georgii
C. Kinésithérapie ou Traitement
des maladies par le mouvement selon la méthode de Ling Paris
: Germer Baillière ; 1847 TDM  (p.47) (p.47)
137 Kellgren
A. Technique du traitement manuel suédois
( gymnastique médicale suédoise) Paris : Maloine ;
1895 TDM 
Page 39
ayant publié sur le système Ling. Il trouve
leurs comptes rendus et les illustrations de leurs ouvrages « incorrects
dans la plupart des cas ». Il a une explication simple,
ces auteurs ont dû rester peu de temps à l’Institut.
Par ailleurs, l’hiver suédois les a conduits à y aller,
en été, quand l’Institut est fermé.
Gustav
Zander (1835-1920)
[Fig.7]
naquit à Stockholm en 1835. A cette époque, la gymnastique
de Ling est en vogue.
Figure 7 :
Portait de Gustav Zander 

Pour
Ling, nous l’avons vu, l’exercice doit toujours être dosé
et localisé. Pour tous les mouvements passifs ou actifs,
une stricte observance de leur direction, de leur rythme, de leur
force doit être de mise. Doser l’exercice c’est mesurer son
intensité pour avoir un effet utile. Le localiser c’est limiter
son effet à une région précise. Seule, la main
en est capable. Le médecin prescrit ces exercices. La résistance
est appliquée
Page 40
par
des assistants. Cette résistance manuelle est fonction de
la force de l’assistant, de son état physique et sa motivation.
Pour éviter les variations liées à ces assistants,
Zander
pense qu’une machine pourra appliquer une résistance identique
indéfiniment pour les appareils actifs ou fournir un mouvement
adapté à une thérapie physique pour les appareils
passifs
.
Il
met en œuvre sa « méthode médico-mécanique »
dans son « institut médico-mécanique »
en 1865. Il est nommé professeur agrégé de
gymnastique médicale à l’École de médecine
de Stockholm en 1880. En 1892, il est élu membre de l’Académie
royale des Sciences de Suède.
Il est décédé, à Stockholm, le 17 juin
1920.
Les
préconisations pour une séance de mécanothérapie
sont les suivantes. Le malade y vient sans hâte et se repose
dix minutes au moins « avant de commencer les exercices
afin qu’il ne soit ni essoufflé, ni échauffé
».
Les exercices se feront à distance des repas mais jamais
à jeun. En général, les exercices passifs précédent
les exercices actifs. Entre les exercices s’intercalent des exercices
de respiration tout comme en fin de séance. Au fil de la
séance, la progression n’est possible qu’en s’assurant par
l’interrogatoire et la prise de pouls du bon état du patient.
A New-York, dans l’Institut Zander de Wischnewetzky,
les patients sont pris en charge par 3 médecins. Deux hommes
et sept femmes dénommés « instructeurs »
les aident à utiliser les appareils. Ces instructeurs sont
secondés par douze femmes et douze hommes qui adaptent les
appareils en fonction des prescriptions.
En
1911, à l’apogée du développement des Instituts
de mécanothérapie Zander, 300 étaient dénombrés
de par le monde. Zander a été pressenti pour le prix
Nobel mais il n’a pas été décerné en
1916 à cause de la Grande
Guerre.
138 Göranssons
Mekaniska Verkstadt : La gymnastique médico-mécanique
de Zander, ses principes, ses applications suivis de quelques indications
sur la création d’établissements gymniques d’après
cette méthode – Stockholm : Imprimerie royale, Norstedt
139 Zander G. : Notice sur
la gymnastique de Zander et l’établissement de gymnastique
médicale mécanique suédoise à Stockholm.
Paris : Imprimerie A. Reiff ; 1879 TDM 
140 Guyenot
P.. : La mécanothérapie
à l’institut Zander d’Aix les Bains. Aix les bains :
Imprimerie Gérente ; 1904 TDM  TDM TDM  [Note du CFDRM livret dans lequel il aborde
le massage] [Note du CFDRM livret dans lequel il aborde
le massage]
141 Régnier
L.R. La Mécanothérapie,
application du mouvement à la cure des maladies, J.P. Baillière
;1901 ParisTDM 
142 Wischnewetzky
L. The mechanico-therapeutic institute. Contributions to mechanico-therapeutics
and orthopedics Vol 1, N°1, New-York, Mechanico-therapeutic
and orthopedic Zander, 1891
143 Hansson
N., Ottosson A. Nobel price for physical therapy ? Rise,fall and
revival of medico-mechanical institutes Phys Ther 2015 ; 95(8) :
1184-94
Page 41
Pehr Henrik Ling est souvent, à tort, crédité
de l’invention du massage
suédois. Cette confusion
historique courante est toujours présente de nos jours. Les
ouvrages consacrés au massage au cours du XIXème siècle
donnent Ling comme pionnier de la gymnastique et du massage
suédois. Par exemple, Axel V. Grafstrom
le qualifiait de « père de la mécanothérapie ».
Nellie
Elizabeth Macafee [1873-1954]
ne tarit pas d’éloges sur l’ensemble du « système
Ling ». Il faut attendre les travaux de Patricia Benjamin
en 1986, à travers son analyse des travaux de Ling, elle
s’aperçoit que le Français n’est pas utilisé
pour dénommer les manœuvres.
L’utilisation des mots français « effleurage »,
« pétrissage »,
« tapotement »,
« friction »,
toujours universellement admis par les masseurs,
a été introduite par Johann
Georg Mezger [Fig.8].
Latson, dès 1904, écrivait que le mouvement
de renouveau scientifique du massage s’était installé simultanément
en France, en Hollande et en Allemagne. Donc, en Suède, comme l’écrit Arvid
Kellgren,
les manipulations du massage ne sont qu’une petite part des
techniques passives du système de Ling.
En Suède, le terme « massage suédois »
n'est pas employé. Le massage dit
suédois a été codifié, à partir
de 1868, par le médecin néerlandais Johann Georg Mezger
(1838-1909).
Comme
Ling, Mezger pratiquait la gymnastique, régulièrement,
à la Gymnastics Institution du Westermarkt à Amsterdam.
La Gymnastics Institution est réputée pour ses avancées
médicales dans le traitement de la scoliose et d'autres malformations
144 Grafstrom
A. V. A Text Book of Mechano-Therapy (Massage And Medical Gymnastics)
New-York : O.M.Foegri & Co ; 1898
145 Mcafee
N.E. Massage : An Elementary Textbook
For Nurses Pittsburgh : Reed & Witting Co ; 1917
146 Calvert
R.N. The history of massage An illustrated survey from around the
world Healing Arts Press : Rochester ; 2002
147 Latson
W.R. Common disorders with rational methods of treatment the Health
Culture Company New-York 1904
148 Kellgren
A. The technic of Ling’s system of manual
treatment Edinburg & London : Y.J. Pentland ; 1890
Page 42
squelettiques.
Mezger
était réputé pour son talent de gymnaste et
pour sa connaissance de la physiologie. Le Docteur Justus Lodewijk
Dusseau (1824-1887) l’encourage à étudier la médecine.
Il suit ce conseil en intégrant l'Université de Leiden.
En 1868, il passe son examen de doctorat et rédige une thèse
de 47 pages intitulée "De Behandeling van distorio pedis
met fricties" (Traitement de l’entorse de cheville par frictions).
Elle servira de base thérapeutique au massage dit
suédois. Elle contient de longues citations en Français
de la Gymnastique médicale et chirurgicale de Tissot
ou de la communication de Girard
[1770-1852] à la séance
de l’Académie de Médecine du 9 novembre 1858.
Figure 8 :
Portrait de Johann Georg Mezger 

149 Terlouw
T. Roots of physical medicine, physical therapy, and mechanotherapy
in the Nederlands in the 19th century : a disputed area within the
healcare domain J Man Manipul Ther 2007 ; (15)2 : 23-41
150 Tissot
C.-J. Gymnastique médicinale et
chirurgicale, ou essai sur l'utilité du mouvement, ou des
différents exercices du corps, et du repos dans la cure des
maladies Paris : Bastien ; 1780 TDM 
Page 43
Mezger
se sert de ses connaissances médicales pour mettre au point,
avec les techniques françaises de massage, un système
de cinq manœuvres thérapeutiques, encore utilisées
aujourd'hui, pour traiter les patients.
Normalement,
les entorses de cheville guérissent
spontanément au repos, mais parfois arrivent des complications
comme les causalgies (appelées maintenant
syndrome douloureux régional complexe). Le repos est aussi
préconisé pour ces complications, mais Mezger s’oppose
au traitement passif. Il devient assistant du professeur de médecine
Jan van Geuns (1808-1880). L'approche active de Mezger est mise
en doute par ses collègues, mais il attire l'attention de
la presse et du grand public.
En 1870, Mezger fonde une clinique à l'hôtel
Amstel à Amsterdam [Fig.9]. Cet hôtel trop grand et trop coûteux
voit ainsi ses problèmes financiers soulagés par cette
création.
Figure
9 : Plaque commémorative apposée sur un mur
de la piscine de l’hôtel Amstel 
© foto BMBeeld 2017
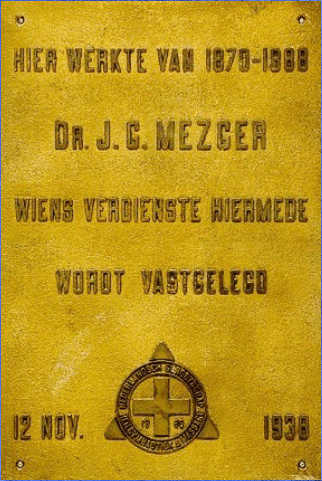
En effet, la clinique de Mezger attire les familles
royales, princières et des patients fortunés de toute
l'Europe. Mezger ne va pas consulter le patient, fut-il roi, c’est
le patient qui vient à lui. Une seule exception est faite
pour le Pape. Parfois, les revenus de l’hôtel de luxe doivent
attendre. En effet, Mezger défend aussi le principe
d’une priorité pour les agriculteurs afin de leur permettre
de retourner au travail rapide-
Page 44
ment. Ainsi, il traite les pauvres de la région
gratuitement par contre l'élite doit payer et se déplacer
à Amsterdam.
Des ouvrages chinois ont été traduits
en Français en particulier par le Père Amiot (1718-1793), auteur avec d’autres jésuites
missionnaires à Pékin
d’un ensemble de 15 volumes. Le tome 4 traite du Cong-Fou (ou Kung-Fu ou Kong-Fu) à la fois massage et gymnastique. Cet ouvrage aurait inspiré
Ling. Le Français depuis le
XVIIIème siècle
est la langue internationale. Mezger devait le parler compte tenu
des longues citations françaises de sa thèse et ce
devait être le moyen de converser avec ses patients venus
de toute l’Europe.
Par rapport à Ling, le statut de médecin
de Mezger, ses succès thérapeutiques (en particulier
la blessure de la hanche de Gustav V de Suède) lui permettent de s’imposer pour promouvoir le
massage
d’un point de vue médical et scientifique.
Ainsi, le massage dit suédois serait donc la synthèse de techniques manuelles
avec une terminologie française, utilisées et codifiées
par un médecin hollandais.
151 Amiot
J. Mémoires concernant l’histoire,
les sciences, les arts, les mœurs et les usages des Chinois Tome
4 Paris : Nyon ; 1779 
Page 45
Un
pléonasme pourrait se voir en ajoutant « manuel »
à massage. Il n’en est rien puisque « massage »
n’est pas, étymologiquement, lié à « main ».
C’est au pire une redondance, quoique l’existence du Massage
podal n’en fait seulement qu’une précision
sur le mode d’action.
Figure 10 : Massage
podal d’après une édition
de 1595 du Canon d’Avicenne,  [source
et propriété du CFDRM] [source
et propriété du CFDRM] 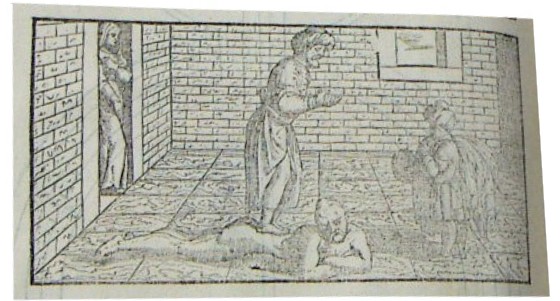
Déjà
représenté dans le Canon d’Avicenne TDM  [Fig.10],
le massage podal est présenté, pour la période
explorée dans ce travail, dans un environnement d’établissement
de bains [Fig.11]
[Note CFDRM Tifflis,
Géorgie, Caucase].
[Fig.10],
le massage podal est présenté, pour la période
explorée dans ce travail, dans un environnement d’établissement
de bains [Fig.11]
[Note CFDRM Tifflis,
Géorgie, Caucase].
152 Abu
‘Ali al-Husayn ibn ‘Abd Allah ibn Sina dit Avicenne Avicennæ
Arabum Médicorum Principis Canon Medicinæ, d’après
la traduction latine de Gérard de Crémone Venise :
Juntas ; 1595
Page 46
Figure 11 : Carte postale ancienne de Géorgie
montrant un massage
podal  [Note
CFDRM voir
Caucase : d'hommes
du 19ème siècle avec des photographies de
Dimitri
Ermakov (1846-1916) ] [Note
CFDRM voir
Caucase : d'hommes
du 19ème siècle avec des photographies de
Dimitri
Ermakov (1846-1916) ]
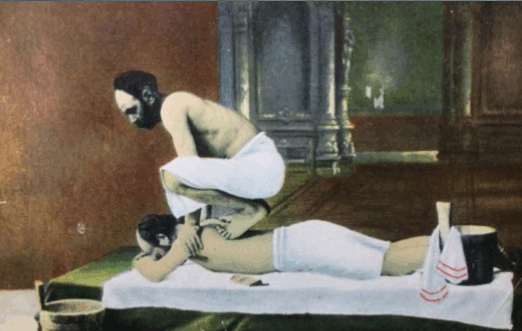
Marcireau nous indique
qu’il pouvait se pratiquer aussi dans un environnement plus fruste,
car à « l’époque coloniale, les porteurs
qui fournissaient une longue marche avec des fardeaux…, arrivés
à l’étape très fatigués, se piétinaient le dos entre
eux. » La revue Illustrated London News  du 6 août 1910 illustre ce propos avec une
gravure localisée en Ouganda du 6 août 1910 illustre ce propos avec une
gravure localisée en Ouganda  pour un traitement par massage podal pour douleur digestive [Fig.12]. pour un traitement par massage podal pour douleur digestive [Fig.12].
153 Marcireau
J. La médecine physique secrets
d’hier, techniques d’aujourd’hui Paris : Le courrier du Livre ;
1965 TDM 
Page 47
Figure 12 : Ce n’est pas un supplice mais un traitement par
massage podal
en Ouganda 
[Note CFDRM
Nous la retrouvons
publiée l'année suivante dans le Journal des Voyages - N°780,
Année : 1911 TDM  ] ]
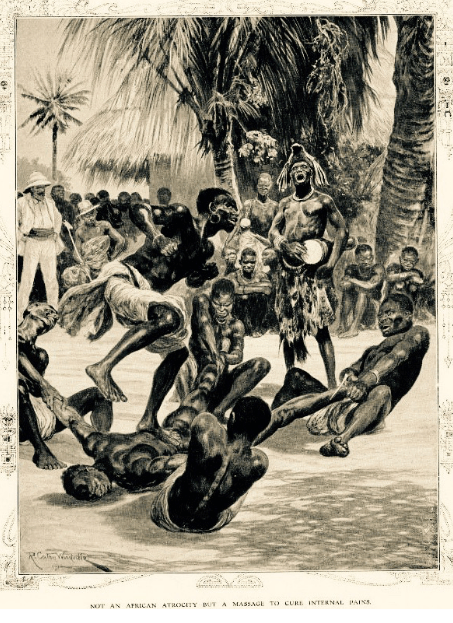
« Le
massage a ses règles et ses principes. Par eux, il
est devenu un agent puissant en thérapeutique et en hygiène »
Le massage dit suédois utilise des mouvements longs
et fluides, souvent en direction du cœur. Ainsi les 5 techniques
de base du massage dit suédois :
L'Effleurage
consiste en balayages
lents et glissés,
ils permettent au praticien d’identifier les tensions musculaires
et au patient de commencer à se détendre.
Le
Pétrissage
est constitué de pressions,
compressions,
malaxages
des muscles. Le pétrissage est utilisé pour
« chauffer » profondément les muscles
et améliorer la circulation. Il est considéré
comme débarrassant le muscle et les tissus nerveux des « toxines ».
154 Estradère
J. Du massage, son historique, ses manipulations,
ses effets thérapeutiques. Paris Adrien Delahaye ; 1863 TDM

Page 48
Les
frictions sont des frottements
en mouvements fermes, profonds et circulaires. Le but de cette technique
est de faire céder l'hypertonicité ou les "nœuds".
Les frictions s’appliquent sur
une ou toutes les parties du corps,
avec plus ou moins de force, plus ou moins de rapidité. Les frictions sont dites sèches ou humides, en fonction de l’utilisation
ou non d’un corps gras ou d’un principe médicamenteux, comme
huiles, liniments, onguents, baumes, pommade, etc.
Après
avoir travaillé profondément les muscles, il faut
les soulager avec des mouvements
plus légers. Les deux dernières techniques se composent
de tapotements (percussions)
et de vibrations.
Les
Tapotements sont des mouvements de percussions à
mains ouvertes, ou fermées ou pressions alternatives
légères. Le tapotement permet de relâcher
le muscle après un travail profond.
Les
Vibrations consistent à « secouer »,
ou faire onduler,
vibrer des muscles spécifiques.
Les Vibrations stimulent la circulation sanguine et détendent
le patient.
Estradère
a proposé un tableau (Tab.I) qui montre l’articulation des
techniques de base avec des techniques détaillées
plus finement. Un langage imagé, des subtilités dans
le détail des manœuvres
sont apparues. Ces variantes des techniques de base ont progressivement
disparu au fil du temps.
La pratique de ce massage se fait avec ou sans huile, crème ou lotion.
Estradère étant l’auteur de ce tableau,
les descriptions des manœuvres y apparaissant lui sont empruntées
« L'onction est
toujours humide, elle a pour but d'étaler avec douceur un
principe médicamenteux sur une ou plusieurs parties du corps.
L'onction ne fait pas, à
155 Estradère
J. Du massage, son historique, ses manipulations,
ses effets thérapeutiques. Paris Adrien Delahaye ; 1863 TDM

Page 49
proprement parler, partie des manœuvres
classées parmi les frictions, puisque celles-ci réveillent l'idée
d'un frottement ; mais …elle est souvent prélude
de la friction … »
Tableau
I : Les manœuvres de massage d’après Estradère
[Note CFDRM page 65 Article III]
-
156 Ibid
Page 50
Estradère
emprunte à Oribase,
médecin grec du IVème siècle, le
critère visuel d’une friction
douce à modérée. Il ne faut
pas que la peau dépasse une « rougeur fleurie ».
Les
passes
vont du visage aux extrémités. Il s’agit de « l’application
de la pulpe des doigts des deux mains à la partie médiane
du front pour… les faire glisser
doucement, légèrement de chaque côté
du front, en descendant sur les tempes, les paupières, les
joues, sur les parties latérales
du cou, les épaules et la racine du bras jusqu’aux extrémités
des doigts ; puis, abandonnant brusquement les parties touchées
on réapplique les doigts sur le front … ». L’on
redescend soit jusqu’aux doigts comme précédemment
ou bien le long de la paroi antérieure du tronc, de chaque
côté, jusqu’aux pieds.
Les
frôlements sont « des mouvements lents de va-et-vient
allant de la périphérie au centre et du centre vers
la périphérie ; ils sont faits avec la pulpe
des doigts de l’une ou des deux mains, accompagnées d’une
pression modérée. »
Les
attouchements se confondent avec les frictions
douces.
Les
frictions
moyennes ou rudes sont constituées de pressions
plus ou moins fortes et plus ou moins prolongées. Elles sont
dites rectilignes si la main se déplace en ligne droite.
Elles sont anguleuses si la main ne reproduit pas la direction du
premier va-et-vient. Si la main se déplace, entre les deux
extrémités de la zone à masser, en parcourant
un demi ou les trois quarts d’un cercle, les frictions
sont dites en spirale. Elles sont courbes excentriques puis concentriques,
si en partant du centre de la zone à masser, la main
décrit des circonférences de plus en plus grandes
jusqu’à la périphérie puis des cercles de plus
en plus petits jusqu’au point de départ.
Page 51
5.1.4 Les pressions
douces
Les
pressions se font, soit avec l’extrémité des
doigts, soit avec la paume entière. En fonction de l’intensité
de la force mise en œuvre, elles sont douces à modérées
ou fortes. Pour Estradère,
agacements et chatouillements
ont été employés plus dans un but lascif que
pour un massage
hygiénique ou thérapeutique. Il réserve
les titillations à l’appareil génito-urinaire.
Le
taxis
est une manœuvre de pression méthodique destinée
à refouler les hernies pour les réduire.
Elles
se subdivisent en pétrissage,
malaxation, froissement, pincement, foulage et
sciage.
Le
pétrissage consiste à appliquer, sur les masses
charnues, les mains aux doigts joints ou écartés et
à les faire ramper comme une chenille avec une pression
plus ou moins forte.
La
malaxation diffère du pétrissage au
moment de l’étape préparatoire. La main est, d’abord,
posée à plat avec plus ou moins de force, les doigts
se fléchissent secondairement pour pratiquer le pétrissage.
Le
froissement est un pétrissage superficiel qui
n’intéresse que le tissu cutané et sous-cutané.
Le
pincements
est une pression pollici-digitale
à deux ou trois doigts
qui ne doit pas être trop forte pour ne pas entraîner
de déchirure tissulaire.
Pour
le foulage les deux mains opposées roulent le segment de
membre du centre vers la périphérie et inversement
en se déplaçant le long du segment de membre.
Le
sciage est une pression avec le bord ulnaire
de la main pratiquant un va-et-vient analogue au mouvement d’une
scie.
157 Ibid
Page 52
Elles
consistent à frapper
la zone choisie, subitement, de façon intermittente, avec
une force déterminée. Elles s’exercent avec la main
ou des instruments divers. La force des percussions
va toujours croissante de douce au début elle peut devenir
graduellement forte en fonction de l’accoutumance du patient.
Elles se subdivisent en hachures, claquements, vibrations
pointées ou profondes et les percussions à
proprement parler.
Les
hachures se pratiquent uniquement avec une main ou les deux
alternativement. La main frappe avec le bord ulnaire et le
5ème doigt. Les doigts peuvent être réunis
ou écartés.
Pour
les claquements le masseur utilise la paume de la
main, doigts étendus modérément ce qui donne
à la main une forme de cuillère. Comme les hachures
les mains peuvent percuter
la peau en alternance.
Les
vibrations pointées ou pointillages se font avec le
bout des doigts réunis en cercle plus ou moins grand.
Les
vibrations profondes se font poing fermé en frappant
avec le bord ulnaire ou la face dorsale des phalanges.
Les
percussions à proprement parler ne sont qu’instrumentales.
L’instrument le plus couramment utilisé est la palette (cf.
6.3.1.6.). Celles-ci
frappent avec une rapidité et une intensité
plus ou moins importantes. La brosse
(cf. 6.3.1.2.), le
gant (cf. 6.3.1.3.), la roulette (cf. 6.3.1.5.) ou le
faisceau de branches (cf. 6.3.1.7.) peuvent
remplacer la palette. L’utilisation de ce faisceau de branches est
la base de la flagellation.
Quarante-cinq
ans plus tard, en 1908, [Note CFDRM
4eme ed. mais dans la 1ère de 1894 le tableau existe déjà
page 59, voir
tableau des mouvements] Berne
propose, lui aussi, un tableau des manœuvres de massage.
Malheureusement il ne les explicite pas toutes. Comme évoqué
précédemment certaines ont disparu.
Pour
Berne, l’effleurage consiste à promener la face palmaire
de la main sur la peau en va-et-vient dans un seul sens, c’est à
dire dans le sens centripète, avec une lé-
158 Berne
G. Le massage manuel théorique
et pratique, Paris : Rueff et Cie ; 1894
TDM 
Page 53
gère
pression pour une action superficielle. Plus l’action devra
être profonde, plus la pression sera forte.
Le
pétrissage est
pratiqué avec la face palmaire des mains et la pulpe des
doigts. Elles exercent des pressions
alternatives sur les parties molles, jamais sur des régions
pourvues d’artères, de veines, de nerfs et de ganglions.
Tableau
II : Les manœuvres de massage d’après Berne
Effleurages |
Frôlements
|
|
Onctions |
Pétrissages |
Pincements |
|
Malaxations |
Pressions |
douces |
rectilignes |
elliptiques |
spiroïdes |
fortes |
Froissements |
Foulages |
Percussions |
à plat |
|
à poings fermés |
douces |
fortes |
|
|
|
Massage vibratoire
|
|
|
Les pincements sont une variété de pétrissage. Ils s’exercent avec la pulpe des doigts. Ils peuvent
être faibles ou forts et intéressent une zone bien
délimitée.
Page 54
Les malaxations sont une autre variété de pétrissage. Elles se pratiquent avec la paume et concernent une
région plus étendue que les pincements.
Les pressions se pratiquent, soit avec la pulpe des doigts, soit avec
la paume. Elles peuvent être douces ou fortes. Elles peuvent
être rectilignes, elliptiques, ou spiroïdes et sont destinées
aux lésions superficielles ou récentes. Pour les lésions
anciennes ou profondes les pressions seront fortes et pourront aller jusqu’au « froissement », voire au « foulage » si elles sont très anciennes ou très
profondes. Le talon de la main, le poing, le pouce, la pointe de
l’index peuvent être utilisés pour ces différents
types de pressions.
Berne présente les percussions uniquement sous la forme d’un tableau. Cette présentation
diffère peu de celle d’Estradère.
Les manœuvres décrites à 45 ans d’intervalle diffèrent
très peu et vont surtout vers une simplification. Les cinq
techniques de base du massage
dit
suédois (effleurage, pétrissage, friction, tapotement ou percussion et vibration) sont préservées.
Page 55
Tous les auteurs s’accordent pour reconnaître que
rien ne remplacera la main, que la main douée d’un sens du toucher exercé est le meilleur et le plus simple des instruments, le seul capable de s’adapter à toutes les parties
du corps, le seul capable de doser la force exercée. « Les
doigts, le poing, le tranchant de la main, l’avant-bras et le bras
agissent de mille manières différentes que l’on peut
encore multiplier à l’infini à l’aide d’un second
facteur : la gradation de la force, savamment dosée… »
Parfois très simples, parfois élaborés
voire complexes, il existe pendant la période considérée
une multitude d’inventions destinés à suppléer
la main, « inventions faites beaucoup plus pour soulager
le praticien que pour venir en aide au malade ». Ces instruments permettent de rendre certaines manœuvres
moins pénibles pour le masseur et (peut-être) plus efficaces pour le patient. Certains ont été spécialement conçus
pour permettre aux patients eux-mêmes de se masser.
Au départ simple prolongement de la main, afin
de faciliter ou améliorer l’efficacité du geste, ces instruments se sont complexifiés au fil du temps. En partant
des manœuvres de massage, des classifications de ces instruments ont été
parfois tentées. Dans ce travail une classification originale
est proposée, en partant, cette fois, des caractéristiques
des instruments. Ainsi :
159 Petit
L. Le massage
par le médecin, physiologie, manuel opératoire, indications, Paris : Alexandre Coccoz ; 1885 TDM 
160
Schreiber J. Traité
pratique de massage et de gymnastique médicale, Paris : Octave Doin ; 1884 TDM ***
* 
161 Laisné
N. Du massage,
des frictions et manipulations appliquées à la guérison
de quelques maladies, Paris : Victor Masson
et fils ; 1868 ***
* 
Page 56
Les instruments simples regroupent
des objets du quotidien ou empruntés à la nature
ou de conception très simple, devenant instrument particulier
dans la main du masseur.
Les instruments élaborés mettent en jeu des mécanismes plus ou moins
complexes dans leur fonctionnement. Ils utilisent des matériaux
nécessitant une élaboration industrielle.
Les instruments de massage induisant une électrisation
simultanée se subdivisent
en deux catégories :
les instruments dont la conception met en jeu un mécanisme
permettant de créer un courant ou un champ électromagnétique
lors de leur déplacement,
les instruments reliés à une pile dont
le courant est transmis au patient ou servant à créer un champ électromagnétique.
Les instruments de massage
vibratoire
se subdivisent en
instruments manuels actionnés ou non par une
manivelle,
instruments à ressort,
instruments fonctionnant avec un fluide sous pression,
instruments de massage vibratoire électriques portatifs ou non.
Les instruments dédiés à un organe ou une pathologie, leur conception
peut les placer dans l’une ou l’autre des catégories
précédentes mais ils ont une destination spécifique.
Les machines à masser :
mues par le courant électrique ou une machine à
vapeur, la taille de ces appareils interdit toute utilisation
manuelle, seuls des réglages sont possibles pour une
adaptation au patient.
Page 57
Des auteurs comme Brousses décrivent également le massage
électrique. Il s’agit d’un massage
manuel mais avec le port par le masseur de bracelets métalliques
ouverts recouverts de peau de chamois et resserrés par un
lacet. Ils sont reliés, par des câbles électriques
d’au moins trois mètres de long, à un appareil produisant
du courant faradique. La peau de chamois des bracelets et les mains
du masseur doivent être imbibées d’une solution salée.
Lorsque les deux mains sont en contact avec le patient, le courant s’établit, la peau du patient frissonne, les muscles sous-jacents entrent en contraction. Le
masseur perçoit
les mêmes impressions, les muscles de ses avant-bras se contractent.
L’intensité du courant varie en fonction de la surface des
mains en contact avec la peau. Ainsi, plus la surface est petite,
plus le courant est intense. Pour Brousses, « ce procédé … ne saurait avoir
que la valeur du massage simple, suivi ou précédé d’électrisation
faradique » et « il s’agit plutôt là
d’une petite mise en scène qui impressionne … le malade ».
Le massage électrique
ne sera donc pas retenu dans les techniques de massage instrumental.
Les massages
associés à la balnéothérapie, l’hydrothérapie, la crénothérapie nécessitent également une multitude de
tuyauteries souples ou rigides, des réservoirs, des mélangeurs,
de la robinetterie, des manomètres, des buses, des pommes
de douche [Fig.13].
Figure 13 : Carte postale
ancienne montrant l’installation nécessaire pour amener l’eau
thermale d’Aix
les Bains dans la salle de douche-massage 
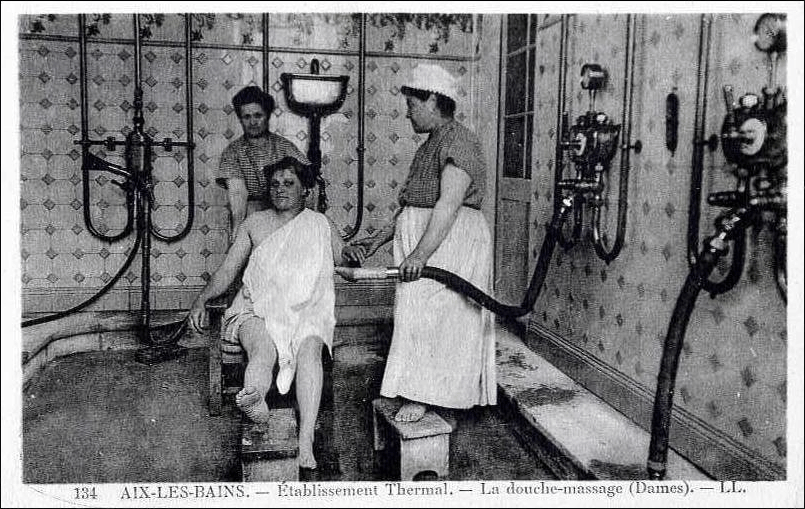
162 J.
Brousses Manuel technique de massage,
Paris : Masson & Cie ; 1920 [Note
CFDRM probablement la 5eme
édition, la 1ère 1896 TDM ***
*  ] ]
163 Ibid.
Page 58
Ces appareils ne sont pas, pour autant, des instruments
de massage, ils
ne font qu’amener, au patient, l’eau à la température choisie et à
sécuriser l’installation. Cela reste un massage simple avec irrigation de la peau. Le massage
sous eau, quelle que soit son origine,
sera donc exclu du massage instrumental [Fig.14].
Figure 14 : Carte postale
ancienne montrant bien qu’en hydrothérapie, balnéothérapie ou crénothérapie, le massage
reste un massage
standard 
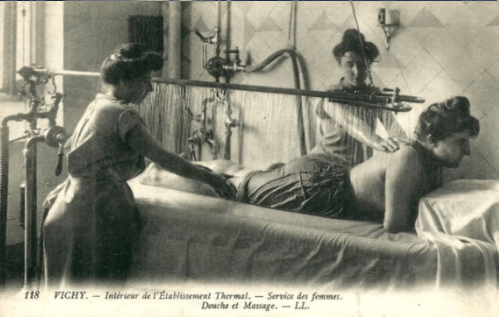
Ce sont donc des instruments du quotidien ou empruntés
à la nature et façonnés pour un usage particulier.
Cecil, Deville ou Estradère citent et décrivent les plus simples comme des
brosses, des gants, le strigile ou raclette, des éponges, la roulette, la palette ou férule ou tapette ou battoir.
En Angleterre, au tout début de la période considérée,
l’Admiral
Henry Ravelden, dit Admiral Henry, est
un personnage incontournable. En 1786, il regagne le Kent
164 Cecil
T. Massage sèche London : Simpkin, Marshall & Co ; 1888
165 Deville
E. Considérations sur le massage
et son application dans l'entorse Thèse Médecine Strasbourg
: Silbermann ; 1864 TDM 
166 Estradère
J. Du massage, son historique, ses manipulations, ses effets thérapeutiques
Paris : Adrien Delahaye ; 1863
Page 59
après la défaite anglaise lors de la guerre d’Indépendance des États
Unis. Dès 1787, il commence ses
automassages. Autodidacte, il en est l’inventeur, l’expérimentateur
et le bénéficiaire. Pour lui, tous les maux viennent
d’un déficit de vascularisation et les vaisseaux, les nerfs,
les tendons doivent conserver leur mobilité.
Pour cela, il a utilisé tout d’abord des instruments
de bois, mais ils entraînaient des excoriations cutanées.
Il les remplaça par des instruments en os, comme des côtes de bovins ou d’ovins. Il prenait la précaution de les faire bouillir
pour les dégraisser au maximum, puis il les façonnait
à la lime. Il utilisait également un flacon de verre comme rouleau pour les cuisses et des instruments façonnés avec des manches
de brosse
à dents pour la bouche [Fig.15].
Figure
15 : Les instruments de l’Admiral
Henry 
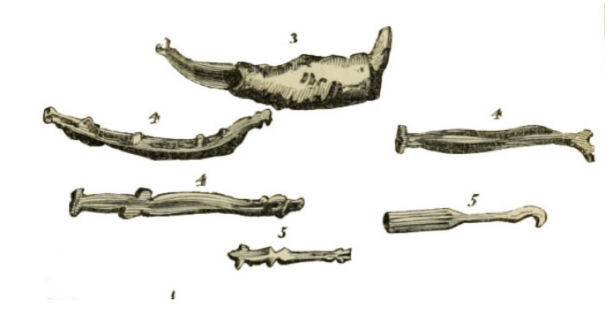
(3) battoir lesté de plomb à sa partie centrale et
recouvert de cuir, (4) instruments en os, les tubérosités naturelles sont conservées, d’autres façonnées
à la lime et servent à crocheter les tendons, (5)
petits instruments en os pour la bouche.
En 1810, il complète sa panoplie avec une cuillère en bois et un marteau de fer, recouvert de liège et de cuir [Fig.16].
167 Johnson
W. The anatriptic art : a history of the art termed anatripsis by
Hippocrates, tripsis by Galen, frictio by Celsus, manipulation by
Beveridge, and medical rubbing in ordinary language, from the earliest
times to the present day : followed by an account of its virtues
in the cure of disease and maintenance of health, with illustrative
cases London : Simpkin, Marshall, & Co ; 1866
Page 60
Figure 16 : Les instruments
de l’Admiral Henry, le marteau de fer dont la tête est recouverte
de liège et emballée dans un morceau de cuir et la
cuillère de bois pour battre la plante
des pieds et les talons, 

Il soigna ainsi, ses rhumatismes
des genoux, ses crises de goutte des doigts,
une cataracte de l’œil gauche et divers maux allant des engelures jusqu’à
ce que l’on dénomme, maintenant, sarcopénie. Il vécut
jusqu’à plus de 100 ans et pouvait, à plus de 90 ans,
marcher 25 miles (plus de 40km) par jour.
Les brosse
de massage sont des brosses ordinaires avec des poils de dureté différente
(chiendent, crins) pour réaliser des frictions plus ou moins fortes.
Les gants sont en réalité des moufles. Ce sont des sacs de tissu munis d’un cordon pour les fixer au poignet, avec un compartiment
pour les quatre doigts longs et un pour le pouce. La face palmaire
est recouverte d’un tissu de poils de chameau ou de peau de chamois. Le tissu en poils de chameau remplace la brosse en plus
doux. Par contre, la peau de chamois et la main se moulent sur le
galbe cutané afin d’effectuer une friction plus douce et plus uniforme. Pour les frictions
sèches ou humides, existent encore le gant de crin avec un tricotage simple
ou double et le gant de laine [Fig.17].
168 Ibid.
169 Cecil
T. Massage sèche London : Simpkin : Marshall & Co ; 1888
Page 61
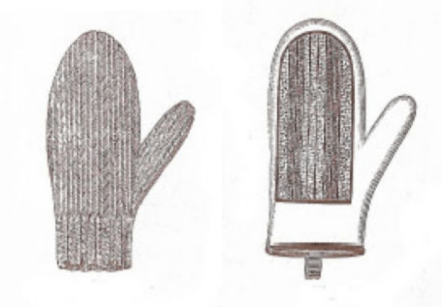
Figure 17 : gants
de crin double tricotage, à gauche
et gant de laine à droite 
Gant et brosse sont parfois combinés avec ce « gant-brosse » du catalogue Natton [Fig.18] proposé avec ou sans pouce en flanelle ou en
toile. La flanelle est utilisée pour les massages avec les liniments
et les onguents, la laine avec l’alcool ou l’eau
de Cologne, le crin pour les frictions sèches.

Figure 18 : Gant brosse
sans pouce du catalogue Natton 
170
Natton Instruments et appareils de l’art médical Paris :
Imp Grandremy ; circa 1900
Page 62
Le strigile ou strigil n’a cessé d’être utilisé
depuis l’Antiquité. En effet, Coulon en possédait trois, provenant de fouilles dans
le Cambrésis et datés de l’époque romaine.
L’illustration [Fig.19] provient du livre de Guillaume
Du Choul (1496?-1555). Il est composé de deux parties, un manche et
une languette courbe creusée en rigole pour former un canal
pour l’écoulement de la sueur. Les masseurs du XIXème siècle utilisent un instrument identique en bois
dur. Le surnom de raclette est facile à deviner compte tenu de sa forme.
Il sert à racler les desquamations de l’épiderme.
S’ils n’utilisent pas le strigile, les masseurs se servent d’éponges ou de tissu en raclant la
peau avec le bord ulnaire de la main.
Figure 19 : Le strigile
illustrant le livre de G.
du Choul 
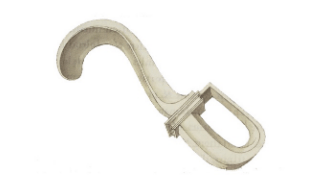
Le Docteur Flashar propose deux rouleaux un grand et un petit [Fig.20], plus rudimentaires que la roulette d’Estradère.
Figure 20 : Les rouleaux
de Flashar, à gauche le grand, à droite le petit 
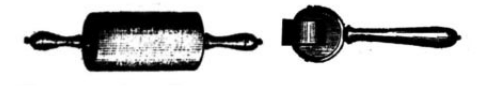
Pour Estradère, c’est un appareil composé de quatre à
huit roues, en général en bois de buis, alignées
sur un axe, chaque roue fait 1cm de large, pour 4 à 5cm de
171 Coulon
H. De l'usage des strigiles dans l'antiquité. Mémoire
lu le 18 avril 1895, au Congrès des Sociétés
Savantes à la Sorbonne Cambrai : Régnier ; 1895
172 Du
Choul G. Des bains et de la palestre, Manuscrit rédigé
entre 1546 et 1547 au plus tard [1ère
ed. 1555 TDM  ] ]
173 Flashar Dr Apparate zur Massage Centralblatt für Chirurgie
1886 ; 43 :745-7
Page 63
diamètre. Il est muni d’une poignée tenue
par le masseur pour réaliser des va
et vient plus ou moins rapidement,
avec une pression
plus ou moins importante. L’appareil du Dr Achille Barthélémy
Boyer, médecin parisien, breveté au Royaume
Uni, est l’instrument le plus ressemblant
à cette description. Il s’agit pourtant d’une évolution
puisque les roues sont plus nombreuses et montées sur un
axe flexible. Le catalogue Drapier le recommande pour les personnes sensibles et les enfants
[Fig.21].
Figure 21 : La roulette du Dr Boyer, à gauche les illustrations de son
brevet montrant l’intérêt d’un axe flexible pour s’adapter
aux galbes corporels, à droite, illustration du catalogue
Drapier 
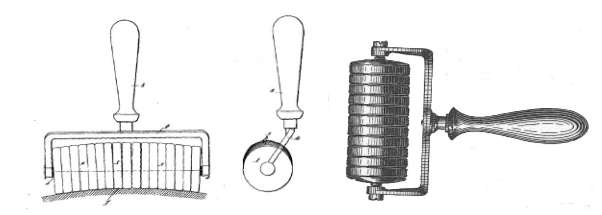
Cet instrument nous montre l’importance de croiser les
sources. En effet pour le catalogue Drapier, il s’agit du « rouleau-masseur à axe flexible du Dr Barthélemy ».
Le brevet nous indique que Barthélemy est le prénom
du Dr Boyer. Il a été vice-président de la
Société Française d’Homéopathie à plusieurs reprises à la fin du XIXème et au début
du XXème
siècle. A-t-il choisi un pseudonyme pour ses activités
commerciales ? La Maison Drapier a-t-elle commis une erreur
en omettant le patronyme ? Il semble cependant difficile de
répondre à ces questions.
174 Estradère
J. Du massage, son historique, ses manipulations, ses effets thérapeutiques.
Paris Adrien Delahaye ; 1863
175 Boyer
A.B. Improvements in or relating to massage apparatus or roller.
Patent N°21123, date of application 22nd Oct., 1901, accepter
23rd Nov,1901 His Majesty’s stationery office : Malcomson &
C° Ltd ; 1901
176 Drapier
Catalogue bandages herniaires, ceintures, bas pour varices, accessoires
Paris : 1911
Page 64
Dans « le Panckoucke », l’article consacré à cet instrument indique
que c’est une spatule en forme de raquette en bois blanc léger. C’est un appareil de 10cm
de long, sur 6 à 7cm de large servant à exercer des
percussions sur les parties charnues, pour Estradère. Elle peut être recouverte de peau ou de satin de velours fin. Il nous décrit également un instrument
dérivé ayant le même usage. Il est constitué
d’une vessie de mouton gonflée
d’air et liée à un manche. L’ensemble constitue une
sorte de fléau avec lequel se pratiquent les percussions. Bourdier, cité par Estradère, propose des palettes en forme de mailloche de grosse-caisse, constituée d’un manche terminé
par une boule de la taille d’une pomme rembourrée de laine
ou de crin. Reveil précise qu’un battoir est tenu dans chaque main et que l’on frappe alternativement
avec l’une puis l’autre. Pour Reibmayr ni spatule, ni mailloche, le battoir est une barre aplatie monoxyle [Fig.22].
Figure
22 : Battoir musculaire de bois monoxyle

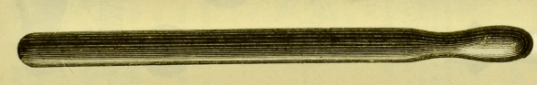
En Europe du Nord et en Russie surtout, les branches de bouleau sont les meilleurs instruments
pour pratiquer la flagellation. Pour Deville, « l’instinct des peuples a modifié
le massage pour l’adapter à chaque climat. » et il faut « une vigoureuse
excitation de la peau pour activer la circulation périphérique et résister au froid ».
Le faisceau de branches ne doit pas être trop volumineux pour
être saisi à pleine main. Les branches les plus utilisées
sont le bouleau, que certains assouplissent en les immer-
177 Une
société de Médecins et de chirurgiens Dictionnaire
des sciences médicales Article « Palette » Tome
39 Paris : C.L.F. Panckoucke ; 1819
178 Estradère
J. Du massage, son historique, ses manipulations,
ses effets thérapeutiques. Paris Adrien Delahaye ; 1863 TDM
 [Note CFDRM en fait il s'agit de la (p.61) mais il semble que
la 1ère mention provienne de l'article sur la Percussion,
publié dans le Dictionnaire
des sciences médicales
: Volume 19 [Note CFDRM en fait il s'agit de la (p.61) mais il semble que
la 1ère mention provienne de l'article sur la Percussion,
publié dans le Dictionnaire
des sciences médicales
: Volume 19  de 1819 'OVA-PEA' (Alard), en 1819 par Percy et
Laurent repris in extenso
par Dally dans sa Cinésiologie de 1857 TDM
de 1819 'OVA-PEA' (Alard), en 1819 par Percy et
Laurent repris in extenso
par Dally dans sa Cinésiologie de 1857 TDM  pages
531/539 (intégral)
: p. 537]
pages
531/539 (intégral)
: p. 537]
179 Ibid.
180 Reveil
O. Formulaire raisonné des médicaments
nouveaux Paris : J.B. Baillière ; 1864 TDM 
181 Reibmayr A. Die Technik der Massage Leipzig & Wien : Franz
Deuticke ; 1892
182 Deville
E. Considérations sur le massage
et son application dans l'entorse Thèse Médecine Strasbourg
: Silbermann ; 1864 TDM  [Note CFDRM c'est en
fait la page 13] [Note CFDRM c'est en
fait la page 13]
Page 65
geant quelques heures dans l’eau. À la fois un
battoir et un strigile, les branches frappent et raclent la peau. Deville rattache la flagellation à l’Europe du Nord, elle avait pourtant fait l’objet
au moins d’une publication médicale en France
.
Ce ne sont pas des instruments de massage mais ils sont le plus souvent indissociables du massage. Ces corps gras sont
utilisés pour le massage
hygiénique ou thérapeutique.
Le corps gras n’est pas indispensable pour le massage
hygiénique mais facilite le glissement de la main sur la peau.
Pour le massage
thérapeutique, le masseur devra utiliser les onguents, pommades, huiles, baumes prescrits par le médecin.
Huile ou corps
gras sont des possibilités pour
Rizet, mais seul importe le sens du massage. Napoléon Laisné ne recommande que l’huile comme corps
gras. Il ne l’utilise que dans le cas
des entorses qui conduisent à une grande répétition
de manœuvres localisées.
Là non plus, il ne s’agit pas d’instruments de
massage, mais cette installation est capitale pour le confort
du patient et du masseur. Berne ne voit « aucune utilité à posséder
autre chose que des
chaises longues d’une longueur et d’une
largeur suffisantes … munies de coussins pouvant se superposer afin de … pouvoir servir d’appui…
et des coussins de longueur et largeur variées, de consistance
différente, depuis la balle d’avoine jusqu’au
coussin de sable … ». Par contre, le Pr. Zabludovski [Note CFDRM Zabludowski J. Isidor,
(1851-1906)] de Berlin,
183 Estradère
J. Du massage, son historique, ses manipulations, ses effets thérapeutiques.
Paris Adrien Delahaye ; 1863
184 Meibomius
J.H. De l’utilité de la flagellation
dans la médecine et dans les plaisirs du mariage et des fonctions
des lombes et des reins Paris : Mercier ; 1795 de 1795 TDM 
185 Klein
B. D’un usage curieux en médecine. Réflexions sur
« De l’utilité de la flagellation de J.H. Meibom »
Paris : Classiques Garnier ; 2016,
186 Ibid.
187 Rizet
F. De la manière de pratiquer le
massage dans l'entorse Arras : A.Courtin ; 1864
188 Laisné
N. Du massage, des frictions et manipulations
appliquées à la guérison de quelques maladies
Paris : Victor Masson et fils ; 1868 ***
* 
189 Berne
G. Le massage, manuel théorique
et pratique Paris : J.-B. Baillière et fils ; 1922 6eme ed. [Note CFDRM TDM 1ère
Ed 1894 [Note CFDRM TDM 1ère
Ed 1894  ] ]
190 Eiger
J. Zabludovski’s technik der massage Leipzig : Georg Thieme ; 1911
Page 66
utilise un lit
de massage à tiroirs incorporés
(Massagebett) [Fig.23] et un tabouret haut (Massagebock) [Fig.24] servant, par exemple, à soutenir le membre supérieur
en abduction lorsque le patient est assis.
Figure
23 : Le Massagebett du Pr Zablukovski


Figure 24 : Le Massagebock et
un exemple d’utilisation 
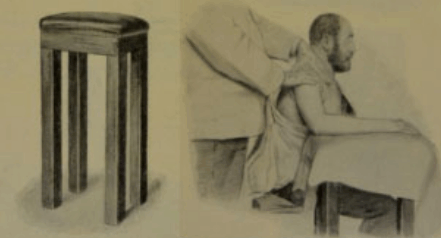
Weber a préféré, pour son « masso-lit », [Fig.25] des jambières articulées et un dossier
non seulement articulé mais aussi excavé pour la tête.
191 Weber
A.S. Traité de la massothérapie
Masson : Paris ; 1891 TDM ***
* 
Page 67
Figure 25 : Le « Masso-lit »
du Dr Weber 
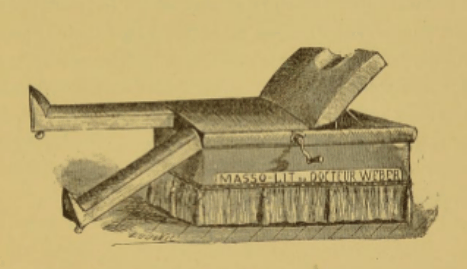
Le Docteur Krafft , directeur d’une école de garde-malades à
Lausanne, devenue une école d’infirmières, décrit
également une table à têtière articulée
et un support articulé, unique des membres inférieurs
[Fig.26]. Une autre illustration donne les côtes de l’armature.
La table est à 40cm du sol. Le masseur doit travailler assis.
Figure
26 : La table
de massage du Docteur Krafft 
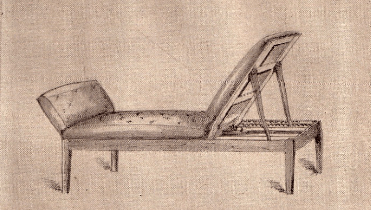
Ils correspondent à des instruments plus complexes
que les premiers dans leur conception et leur fonctionnement. Ils
utilisent des matériaux nécessitant un procédé
industriel comme le caoutchouc. Grâce à la mise en
jeu des mécanismes plus ou moins sophistiqués lors
de leur maniement, ils apportent de l’aide au masseur pour une ou plusieurs manœuvres.
192 Krafft
Ch. Le massage des contusions et des entorses
fraîches Lausanne : George Bridel & Cie ; 1895
TDM  [livre
et PDF] [livre
et PDF]
Page 68
La lanière [Fig.27] peut remplacer le gant pour la friction sèche ou humide. Il existe la
lanière brosse ou lanière de crin disponible en plusieurs
longueurs. Sa conception la destine surtout à l’automassage.
Figure 27 : Lanière
de massage d’après le catalogue Drapier 
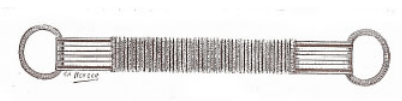
Klemm, directeur d’un établissement de gymnastique à
Riga, a inventé de nombreux appareils pour une utilisation
par le patient seul. L’un porte le nom de « battoir dorsal » (cité par Petit). Klemm le destine à remplacer les effleurages. Une contradiction semble exister entre cet instrument
et la technique d’effleurage. En effet, le battoir suggère un ustensile manœuvré
avec une certaine force. A l’inverse, l’effleurage se caractérise par une manœuvre douce. Il doit
s’agir d’une erreur de traduction de la part de Petit lors de la
transposition et l’adaptation des deux livres d’Albert Reibmayr
,
publiés à Vienne en 1883 et 1884. Le retour
à la publication princeps et le croisement des informations
montrent que la terminologie utilisée par Reibmayr est Rückenreiber
[Fig.28], littéralement « frotteur de dos », un instrument pouvant suppléer
les effleurages.
193 Petit
L. Le massage par le médecin, physiologie,
manuel opératoire, indications Paris : Alexandre Coccoz ;
1885 TDM 
194 Reibmayr
A. Die Massage und ihre Verwethung in
den verschiedenen Disciplinen der praktischen Medizin Wien : Toeplitz
et Deuticke ; 1883
195 Reibmayr
A. - Die Technik der Massage Wien : Toeplitz et Deuticke ; 1884
Page 69
Figure 28 : Le Rückenreiber
ou lanière de massage 
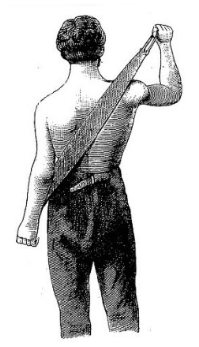
Déjà étudié dans les instruments
simples, les battoirs
sont, cependant, repris ici car ils se complexifient. Reibmayr, en plus du battoir de bois déjà évoqué (cf.
6.3.1.6.),
propose un battoir
de caoutchouc de 2cm d’épaisseur [Fig.29].
Figure
29 : Battoir musculaire de caoutchouc

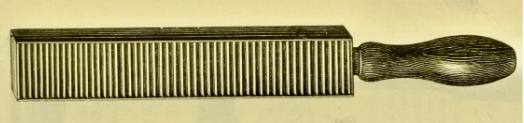
Il existe des variantes par la forme et la taille pour
les battoirs comme le marteau de Klemm, le marteau de massage, le percuteur de Klemm, le marteau à pommeau et le doigtier à percussion du Docteur Krügkula.
196 Reibmayr
A. Die Technik der Massage, Leipzig &
Wien : Franz Deuticke ; 1892
Page 70
Klemm propose, selon la traduction de Petit, un marteau [Fig.29]. Surnommé également « petit
poing », à cause de sa forme en poing. Instrument de caoutchouc avec un manche en bois, il s’adapte aux saillies osseuses. Il est utilisé pour frapper les attaches tendineuses, les corps musculaires ou la
peau directement ou avec l’utilisation d’une mince feuille d’ivoire pour protéger les tissus. Berne dénomme cet instrument « ballon percuteur » [Fig.30].
Figure 30 : Le marteau de Klemm 
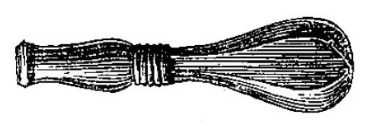
Le plus rudimentaire a été retrouvé
dans la publication de Flashar [Fig.31] qui propose une utilisation par deux, un dans chaque
main, sans donner de détail sur leur conception.
Figure
31 : Le marteau de Flashar, fabriqué
par Rudolf Détert à Berlin 
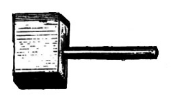
Reibmayr montre deux types de marteau
de massage (Massirhämmer) dans la
5ème édition de son ouvrage. La tête de ces
marteaux est de bois, de plomb ou de fer recouvert de caoutchouc ou constitué d’une boule en caoutchouc [Fig.32].
197 Petit
L. Le massage par le médecin, physiologie,
manuel opératoire, indications Paris : Alexandre Coccoz ;
1885 TDM 
198 Berne
G. Le massage, manuel théorique
et pratique Paris : J.-B. Baillière et fils ; 1922 6eme ed. [Note CFDRM TDM 1ère
Ed 1894 [Note CFDRM TDM 1ère
Ed 1894  ] ]
199 Flashar
Dr Apparate zur Massage Centralblatt für Chirurgie 1886 ; 43
:745-7
200 Reibmayr
A. Die Technik der Massage Leipzig &
Wien : Franz Deuticke ; 1892
Page 71
Figure 32 : En haut, la
boule du marteau est en caoutchouc, en bas, la tête est faite
d’un matériau dur recouvert de caoutchouc
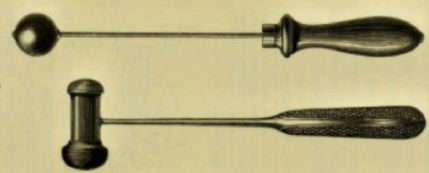
Drapier donne les noms éloquents de « frappeurs » ou
« réveille-muscle » [Fig.33] à l’instrument équivalent qu’il commercialise.
Il est constitué d’un manche de bois, d’une tige de baleine
et d’une boule de caoutchouc. Le terme « baleine »
désigne soit directement le fanon de la baleine soit de la
« baleine » artificielle, un caoutchouc durci
remplaçant le fanon..
Figure 33 : Le réveille-muscle
ou frappeur du
catalogue Drapier de 1911 
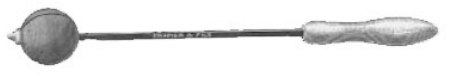
Pour remplacer les tapotements avec le bord ulnaire de la main ou des doigts, Klemm a également imaginé un « percuteur musculaire » [Fig.34] permettant au patient, dans le cas de l’auto-traitement, de pouvoir atteindre
toutes les régions de son corps [Fig.35]. Il s’agit de trois tubes de caoutchouc vulcanisé, creux, de 20 à 30cm de long,
réunis ensemble à une extrémité par
un manche de caoutchouc. Il en existe de trois longueurs différentes.
Chacune de ces longueurs offre trois degrés d’épaisseur . Pour Berne , cet instrument est le « battoir dorsal de
Klemm ».
201 Drapier
Catalogue bandages herniaires, ceintures, bas pour varices, accessoires
Paris : 1911
202 Larousse
P. Grand dictionnaire universel du XIXème siècle tome2 Paris ; Larousse : 1867
203 Schreiber
J., Traité
pratique de massage et de gymnastique médicale, Paris : Doin ; 1884 EO. Doin, 1884 Paris.
TDM ***
* 
204 Bum
A. Mechanotherapie (Massage und Gymnastik) Wien : Urban & Schwarzenberg
; 1893
205 Berne
G. Le massage, manuel théorique
et pratique Paris : J.-B. Baillière et fils ; 1922 6eme ed. [Note CFDRM TDM 1ère
Ed 1894 [Note CFDRM TDM 1ère
Ed 1894  ] ]
Page 72
Figure
34 : Le percuteur de Klemm 
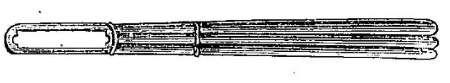
Figure 35 : Patient utilisant
le percuteur de Klemm 
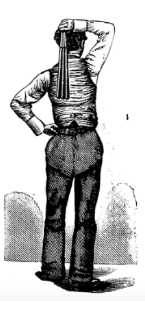
Inspiré des instruments de l’Admiral
Henry (cf 6.3.1.1), ce marteau en bois
de buis arrondi peut être utilisé pour frotter et pour frapper [Fig.36]. La surface A est faite pour frotter de larges régions très douloureuses comme
dans le cas d’un lumbago ou d’une sciatique. Les
extrémités B sont faites pour frapper ou pour frotter des petites zones comme le creux
poplité ou la paume des mains. La concavité C de la poignée
sert à frotter
les orteils ou les doigts, par contre, la convexité D permet de toucher
les zones non atteintes par les extrémités B comme
les oreilles ou les espaces
interdigitaux. Cette convexité
est utilisée pour toute région très sensible
afin de débuter un massage avec une pression très douce.
206 Reece
and Co The catalogue of drugs, or medicine chest companion London
: The Medical Hall, ; 1846
Page 73
Figure 36 : Les quatre
régions du « pommelling hammer » 
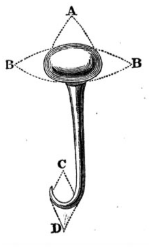
Charles
Gower, membre du Collège Royal de Médecine de
Londres, a décrit un instrument, destiné à réaliser
des percussions,
dénommé Pulsator [Fig.37]. Il s’agit d’un cylindre de liège de 2 pouces
(5cm) de haut, d’un diamètre correspondant à deux
demi anneaux articulés entre eux et vissés dans un
manche d’acajou. Le cylindre de liège est fixé par le collier pour éviter de
le percer au risque de lui faire perdre ses qualités élastiques.
L’ensemble est léger puisqu’il ne dépasse pas 2,5
onces (70 g environ).
Figure
37 : Le Pulsator du Docteur Gower
 [page 20 [page 20  ] ] 
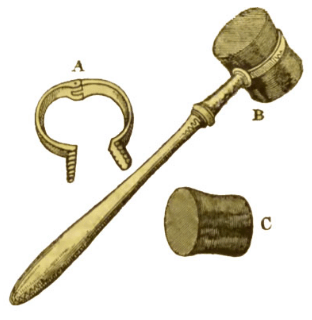
A : les deux demi colliers réunis par une
charnière, à l’opposé de laquelle se trouve
des demi-pas de vis mâles destinés à la fixation
dans le manche. B Le Pulsator prêt à l’emploi. C le
cylindre de liège.
207 Gower
Ch. Auxiliaries to medicine in four tracts,
London : Hatchard ; 1819 [ ] ]
Page 74
Cet instrument s’enfile au bout du doigt comme un dé
à coudre. Il est destiné aux petites surfaces nécessitant
une forme légère de percussion, les tapotements [Fig.38].
Figure
38 : Le doigtier du Docteur Krügkula 
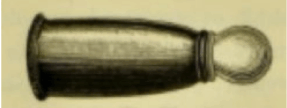
Il s’agit simplement d’une plaque rectangulaire concave
avec une poignée. Flashar le destine au massage
du cou et des extrémités
[Fig.39].
Figure
39 : Le croissant
de Flashar 

Estradère présente une évolution de la roulette où les roues de bois « sont remplacées
par des roues de caoutchouc, sorte de pessaire en forme de gimbelette ». Seul un lecteur aveyronnais pourrait, peut-être,
encore le comprendre, puisque la gimblette est une pâtisserie
régionale. Au XXIème siècle, c’est au « donut »
208 Flashar
Dr Apparate zur Massage Centralblatt für Chirurgie 1886 ; 43
:745-7
209 Estradère
J. Du massage, son historique, ses manipulations, ses effets thérapeutiques.
Paris : Adrien Delahaye ; 1863
Page 75
qu’il faut comparer les roues pour être compris
de tous. Estradère n’apprécie pas cette évolution
de l’appareil car les roues de caoutchouc s’écrasent sous la pression diminuant leur action par rapport aux roues en bois.
Par contre, cet instrument peut également servir pour percuter. Ce double emploi
le revalorise aux yeux d’Estradère. Cette double utilisation
montre bien la difficulté d’une classification en fonction
des manœuvres
suppléées.
6.2.5 La boule
de massage
Instrument inspiré de celui des masseurs japonais, « il est constitué d’une
boule remplie de plomb
enfermée dans une boule creuse et qui, quand on la conduit
avec la main, tourne dans tous les sens sur la peau … ». Cet instrument se retrouve sur le catalogue Drapier
sous plusieurs formes. Ainsi, cette boule peut être amovible
[Fig.40] ou non [Fig.41], elle peut être en bois, lisse, striée
ou cannelée ou lisse encore mais en métal et se présente
en deux tailles. Elle se rencontre dans des ouvrages généraux
sur le massage, des catalogues de matériel médical ou
des ouvrages de soins du visage
Figure 40 : Les différents
éléments d’une boule de massage démontable

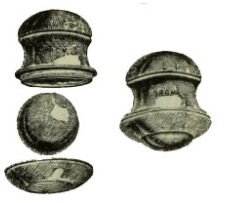
210 Bergman
Dr. Le Visage et les soins à lui donner. Le massage du visage
"Récamier" d'après le célèbre système
H.
Simons, L'art de rajeunir et d'embellir.
Paris : La parfumerie "Récamier" ; 1900
211 Drapier
Catalogue bandages herniaires, ceintures, bas pour varices, accessoires
Paris : 1911
212 Bilz
F.E. La nouvelle médication naturelle : traité et
aide-mémoire de médication et d'hygiène naturelles
Paris : F.E. Bilz ; 1899 TDM 
213 Petitdant
B. Des boules de massage. (article in press) Kinesither Rev (2021),
http://dx.doi.org/10.1016/j.kine.2021.02.006
Page 76
Figure 41 : Boule de bois
lisse non démontable © Collection de l’auteur 

La roulette évoquée dans les instruments simples (cf.
6.3.1.5) a évolué en « rouleau » avec de nombreuses combinaisons de formes
et de taille. Si la roue existe toujours sur certains instruments,
elle a été révisée par les fabricants.
Les roues sont devenues billes lisses ou cannelées ou rouleau
ondé ou strié [Fig.42].
Figure
42 : À gauche, rouleau ondé a une
branche sur poignée, 
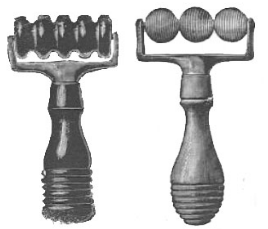
à droite, rouleau
à boules cannelées.
Ces
rouleaux sont parfois disposés parallèles avec une
poignée [Fig.43]
Page 77
Figure 43 : Rouleaux parallèles
à cylindres striés à gauche, à boules
cannelées à droite 
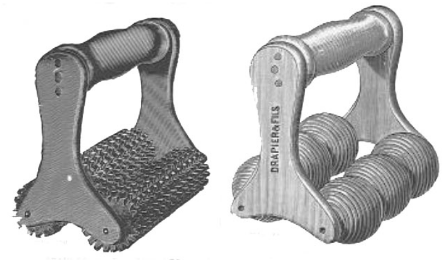
Au fil du temps, le rouleau de Flashar (cf. 6.3.1.5.)
a été copié, révisé. Vers 1900,
le catalogue Natton présente une évolution de celui-ci à
travers un rouleau-masseur à cannelures unies roulant d’une seule pièce
[Fig.44]. Il s’est aussi enrichi d’un revêtement de caoutchouc couvert de picots ou de ventouses ou de stries, etc [Fig.45]. Les plus répandus dans toute l’Europe, dans
les années 1920 portent la marque Allemande Punkt Roller [Fig.46].
Figure 44 : Rouleau à
cannelures du catalogue Natton 
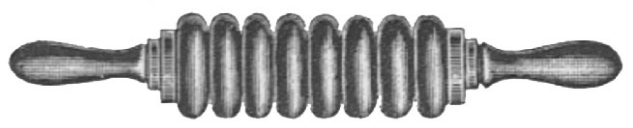
214 Natton
Instruments et appareils de l’art médical Paris : Imprimerie
Grandremy ; circa 1900
Page 78
Figure
45 : Un exemple de rouleau caoutchouc de la gamme Punkt-Roller © Collection de l’auteur 

Figure
46 : L’estampille de Punkt Roller


A la même époque, apparaît sur le marché,
le Radio-Masseur, strié longitudinalement et chauffant [Fig.47].
Page 79
Figure 47 : Publicité
pour le Radio-Masseur, rouleau chauffant parue
dans la revue L’Illustration du 3 novembre 1928 
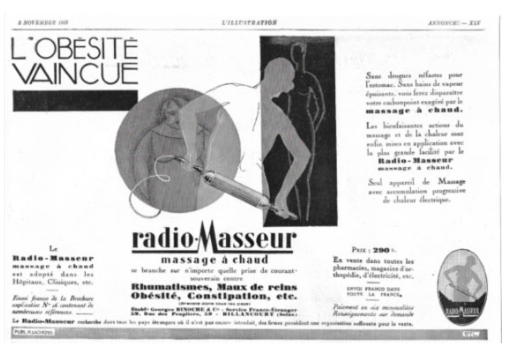
Reibmayr signale le rouleau de Mager constitué de deux
rangées de disques de bois à bords mousses, alternés
l’un par rapport à l’autre et celui de Heinrich aux roues
recouvertes de caoutchouc et montées sur ressorts [Fig.48].
Figure 48 : À gauche,
rouleau de Mager, à droite, rouleau d’Heinrich 
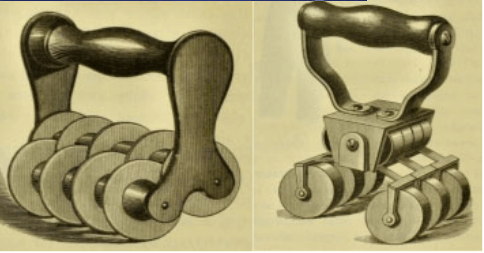
Leonard
Russel Lacy utilisera aussi le caoutchouc
dans la conception de ses appareils. Il dépose un brevet
en 1933 pour un instrument à rouleaux, hérissé
de cy-
215 Reibmayr
A. Die Technik der Massage Leipzig &
Wien : Franz Deuticke ; 1892
Page 80
lindres creux, assurant lors de la rotation un ventousage
de la peau [Fig.49]. Sa société Neu-Vita va permettre de le
commercialiser.
Figure 49 : Le rouleau
de L.R. Lacy commercialisé par Neu-Vita 
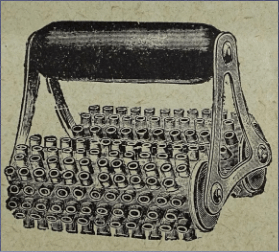
En fonction de nouvelles créations des fabricants,
des instruments voisins apparaissent. Ils déclinent une gamme
d’appareils en combinant différents éléments
de base. Ainsi, la lanière de massage s’associe, par exemple, aux boules
de massage. La parfumerie Récamier propose en 1900 un « automasseur élastique à boules ». La monture
est dite en « caoutchouc garni » c’est à
dire constituée de tendeurs. Il rend les mêmes services
que les appareils construits pour la gymnastique. Il permet d’associer
massage et renforcement musculaire [Fig.50].
216 Lacy
L.R. An improved massaging device Patent N° 393557, Application
date, March 25th.1933 – accepted June 8th.1933. His Majesty’s stationery
office, Love & Malcomson Ltd 1933
217 Bergman
Dr Le visage et les soins à lui donner : le massage du visage
"Récamier" Paris : Parfumerie Récamier ;
1900 [Note CFDRM d'après
le célèbre système Heinrich Simons, L'art de
rajeunir et d'embellir. Paris : La parfumerie "Récamier"
; 1900 38 p.]
Page 81
Figure 50 : Lanière
à boules de la Parfumerie Récamier 

Dans le même esprit, dans les années 1920,
un fabricant ou un simple revendeur inconnu du Royaume Uni propose
cette lanière à boules lisses, bordée de deux
tendeurs [Fig.51]. Sa particularité se trouve au niveau des poignées
amovibles. Elles peuvent devenir des instruments de massage à
boules. D’après le décor daté de la boite,
cette lanière serait des années 1920. Cependant elle
correspond exactement au brevet déposé en 1900 par
George W. Milkman.
Figure 51 : lanière à boules à poignées amovibles servant
elles-mêmes de masseurs
à boules lisses © Collection
de l’auteur

218 Petitdant
B. Massage et renforcement musculaire
dans les années 1920 : une lanière à boules
lisses couplée à un tendeur de musculation Kinesither
Rev 2019 ;20(219) : 33-35
219 Milkman
G.W. Combination massage roller and exerciser Patent N°681331,
application filed May 2, 1900, patented August 27, 1901. United
States Patent Office
Page 82
Le catalogue Drapier et Fils de 1911 montre également deux types de lanière
à boules unies, l’une de 20 boules à poignées
métalliques, l’autre de 26 boules à poignées
bois [Fig.52].
Figure 52 : Lanière
à boules du catalogue Drapier 
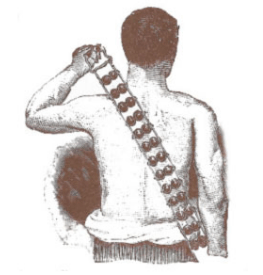
Le célèbre catalogue de la Manufacture d’armes
et cycles de St Etienne dans son édition de 1924 fait figurer un « extenseur-masseur
à câbles caoutchouc » [Fig.53
A]. La particularité de cet appareil
se trouve dans son « crispateur » formé
de doubles poignées [Fig.53
B]. Le « crispateur »
est un appareil servant au renforcement des muscles intrinsèques
et extrinsèques de la main. Deux tendeurs bordent les rangs
de boules et un montage particulier autour de la poignée
sans boule permet le travail musculaire de la main. Là encore
massage et renforcement musculaire s’associent.
Figure 53 : A L’extenseur-masseur
à câbles caoutchouc dont les poignées servent
de crispateur.
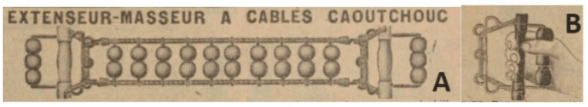
Figure
53 B : gros plan d’un crispateur montrant
la disposition du tendeur de caoutchouc
220 Drapier
Catalogue bandages herniaires, ceintures, bas pour varices, accessoires
Paris : Imprimerie Chantenay ; 1911
221 Catalogue
Manufacture d’Armes et Cycles de St Etienne 1924 p. 193 Paris :
Imprimerie Pigelet ; 1924
Page 83
Les boules
de massage se multiplient sur un même instrument. Ces instruments
se démocratisent. Ces deux appareils le montrent. Le Roléo
[Fig.54] fabriqué en Allemagne, se présente comme un fer à repasser muni
de 14 billes de hêtre montées sur tiges de fer. A l’inverse
on trouve cette boite d’acajou de forme ovale, à poignée
avec ses sept billes d’acier démontables chacune dans un
réceptacle de laiton [Fig.55]. Le Science Museum Group date le Roléo entre 1880 et 1920. Or il porte
la mention Rd N° 575214. « Rd » suivi
d’un nombre est l’acronyme de « Registred designs ». L’aspect visuel de l’objet est protégé.
Ce numéro, identique sur tous les Roléo, a été
attribué en 1911. Le Roléo a pu exister en Allemagne
avant 1911, mais son aspect a été protégé
au Royaume Uni à partir de cette année-là.
Figure 54 : Le Roléo, instrument à boules des plus
simples © Collection de l’auteur 

L’instrument en acajou ne porte aucune marque, il peut
cependant être rapproché du brevet déposé
par Libbie S. Fritze en 1900. Fritze prévoyait une boite profonde pour
y stocker des piles à relier aux billes. La boite est profonde
mais rien ne relie les billes. Le coût de l’ensemble a pu
faire abandonner les piles pour une commercialisation.
222 https://collection.sciencemuseumgroup.org.uk/objects/co140167/massager-germany-1880-1920-massager
223 https://www.bl.uk/business-and-ip-centre/articles/what-are-registered-designs
224 Fritze L.S. Massage
instrument, Patent N°676604, application filed March 19, 1900,
patented June 18, 1901. United States Patent
Office
Page 84
Figure 55 : Luxueux instrument
à boules en boîtier d’acajou © Collection de l’auteur


En conservant le même principe d’instrument à
boules, mais en profitant des progrès réalisés
par les installations électriques domestiques, le Thermoroller
Protos Siemens [Fig.56] ajoute la thermothérapie au massage.
Branché sur une prise murale pendant environ 2mn, l’instrument
chauffe. La chaleur est restituée lors du massage. Lors de la réalisation de ses gestes techniques, le masseur n’est pas gêné par le câble électrique
[Fig.57].
Figure
56 : Le Thermoroller Protos Siemens
ouvert pour être branché, 
© Collection de l’auteur

Page 85
Figure
57 : À gauche, le Thermoroller
fermé pour être utilisé, à droite, gros
plan de la tête à boules
© Collection de l’auteur

Cet instrument [Fig.58] montre toute la difficulté de classifier les
appareils en fonction des manœuvres de massage.
En effet, il associe des pressions
glissées et des tapotements. Cinq roues métalliques à gorge recevant
un anneau de caoutchouc de section circulaire assurent les pressions glissées. Les roues sont solidaires les unes des autres et maintenues à
distance constante par de petites tiges diamétralement opposées.
Entre deux roues contiguës, les petites tiges sont séparées
d’une trentaine de degrés. Entre les roues se trouvent des
lamelles métalliques suffisamment souples pour être
abaissées par les tiges. Ces lamelles sont solidaires des
petits marteaux. Lors de la rotation des roues, la tige rencontre une
lamelle, l’abaisse, et entraîne le marteau. Sa table de caoutchouc vient frapper la peau [Fig.59]. Lorsque la lamelle a passé la tige, le marteau
revient à sa place, un autre le remplace. Après un
demi-tour de roue le même marteau est abaissé. Le déplacement
des marteaux peut être dosé par une molette à
l’arrière de l’appareil.
225 Petitdant
B. L’appareil de massage de P. Semerak, pressions glissées
et percussions Kinesither Rev 2019;19(214):36–39
Page 86
Figure 58 : L’appareil
de Semerak © Collection de l’auteur 

Figure 59 : L’appareil
de Semerak, face inférieure, de gauche à droite :
les roues caoutchoutées, les tables des marteaux, un élément
de carrosserie de l’appareil et le bouton de réglage
© Collection de l’auteur

Cet appareil a été protégé
par deux Deutsches Reichsgebrauchsmuster, les D.R.G.M. 92193 &
93335, numéros délivrés au cours de l’année
1887. Il s’agit d’un simple enregistrement valable trois ans, renouvelable
une fois et non d’un véritable brevet. Josef Semerak, instructeur
de massage (Massage instructor), domicilié à Nie
 Voir la fiche du CFRM. Voir la fiche du CFRM.
Page 87
derlössnitz près de Dresde, dépose
également, en 1898, un brevet au Royaume Uni et en 1899 aux USA.
Heinrich Fleissner, d’Augsburg, a demandé un brevet
en octobre 1937 en Allemagne puis exactement un an plus tard au Royaume Uni. Tout d’abord, destiné au massage
du cuir chevelu par sa forme, cet
instrument a vu son utilisation évoluer, s’étendre
jusqu’à couvrir l’ensemble du corps comme le montre le mode
d’emploi l’accompagnant [Fig.60].
Un ressort est tendu dans une portion d’ellipse faite
d’un matériau type ébonite. Elle se prolonge par une
poignée lui donnant cette forme de peigne. Ce ressort est amovible pour être lavé
ou changé.
Figure 60 : L’Élastoma
© Collection de l’auteur 

6.3 Les instruments de massage induisant une électrisation
simultanée
Certains de ces instruments possèdent un mécanisme
permettant de créer un courant
faradique ou un champ électromagnétique
lors de leur déplacement, d’autres sont reliés à
une pile.
226 Semerak
J. Improvements in massage and beating apparatus for the human body.
Patent 16362. Date of application, 27th July, 1898 – Accepted 8th
Oct., 1898. Printed for Her Majesty’s Stationery Office, Malcomson
& C° Ltd, 1898
227 Semerak
J. Massage apparatus Patent N° 634590 dated October 10, 1899
United States Patent Office
228 Fleissner
H. Massage apparatus Patent N° 520160 Convention Date in Germany
: Oct. 13, 1937, Application date in United Kingdom : Oct. 13, 1938,
Completed specification accepted April 16, 1940. Leamington Spa
His Majesty’s stationary office 1940
Page 88
Cet instrument est composé d’un cylindre métallique
recouvert de cuir verni, d’un électro-aimant et d’un aimant
fixe servant de poignée. La rotation de l’électro-aimant
se fait au niveau des pôles de cet aimant fixe. Poussé
par le masseur, le rouleau tourne, entraînant la rotation de l’électro-aimant
en face des pôles de l’aimant, créant des courants
électromagnétiques transmis
au corps du patient par le cylindre et une électrode placée
en un point quelconque du patient [Fig.61].
Figure 61 : Le rouleau de Butler : (d,e) cylindre métallique
recouvert de cuir vernis, (c) électro-aimant, (a, b) aimant
fixe, (f) rouage de transmission de mouvement, (g) borne du câble
de l’électrode (m,n).
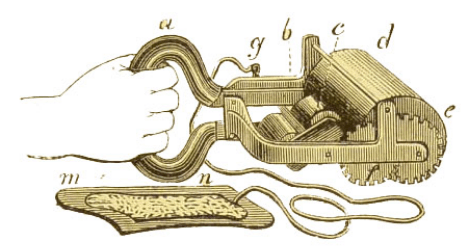
Cet instrument est une invention de Julius Piesen, citoyen
tchécoslovaque résidant à Prague. Il dépose
un brevet le 3 septembre 1928 au Royaume uni, concernant un appareil associant massage et électrothérapie. L'Élektroller [Fig.62] est constitué d'un tube cylindrique surmonté
d’une demi-sphère et fermé en bas par une platine
en matériau type bakélite pour isoler le tube. Le
support des roues est vissé à cette platine, il se
prolonge par 2 triangles latéraux supportant l’axe.
229 Piesen
J. Improvements in or relating to massage apparatus Application
date Sept. 3, 1928. N°296676, complete accepted Jan. 31, 1929.
His Majesty stationery office Love & Malcomson 1929.
Page 89
Figure 62 : L’Elektroller © Collection de l’auteur 

Les deux roues métalliques sont rainurées.
La rainure est garnie d'une bande caoutchoutée à
picots. La joue interne de l’une d’elle porte une couronne dentée
qui entraîne un engrenage vertical, solidaire d’un axe sortant
au centre de la platine [Fig.63].
Figure 63 : La couronne
solidaire de la roue entraîne l’engrenage à l’extrémité
de l’axe
© Collection de l’auteur 
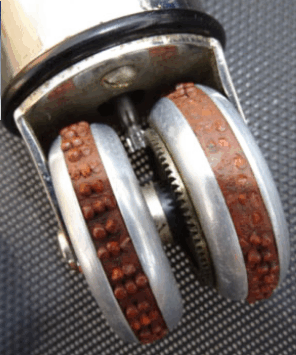
Page 90
Le massage
est généré en roulant l’appareil sur la peau.
La production du courant se fait simultanément par un rotor
et un aimant interne. Ce courant est transmis à la peau par
la partie métallique des roues produisant une stimulation
électrique.
D’après le brevet [Fig.64], la couronne dentée de la roue droite par l’intermédiaire
de l’engrenage solidaire de l’axe entraîne un rotor [Fig.64 n°22] à l’intérieur d’un aimant en
fer à cheval [Fig.64 n°18] dans le plan frontal et à concavité
interne en coupe horizontale, épousant le contour du tube.
Un rotor  tournant dans un
stator tournant dans un
stator  fixe, sont les constituants
d’un moteur électrique. En haut de l’axe, au-dessus de l’aimant
se trouvent différents disques dont un disque à cames
(cam disc) (Fig. 64 n°24) pour donner les impulsions. Ces impulsions
sont transmises à la peau par les parties périphériques
métalliques des deux roues . fixe, sont les constituants
d’un moteur électrique. En haut de l’axe, au-dessus de l’aimant
se trouvent différents disques dont un disque à cames
(cam disc) (Fig. 64 n°24) pour donner les impulsions. Ces impulsions
sont transmises à la peau par les parties périphériques
métalliques des deux roues .
Figure 64 : Les différents
éléments cachés à l’intérieur
de la poignée cylindrique de l’appareil 
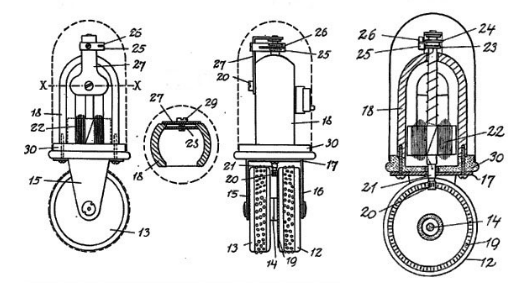
6.3.1.3 Le Vigorator
Compte tenu de son aspect, cet instrument est souvent
daté des années 1950 à 1970. Or un courrier
accompagnant notre Vigorator et indiquant le numéro de cet appareil est daté
de 1927. Cet instrument de massage est produit par la société Vigorest
30 Ibid.
231 Martin
JP. L'Elektroller Clystère 2011;2:2–3 www.clystere.com
232 Petitdant
B. L'Élektroller, massage et électrothérapie
Kinesither Rev 2018;18(197):56–58
Page 91
[Fig.65]. Le déplacement du rouleau sur la peau génère
un courant comme le fait une dynamo, sans utilisation de pile, de
prise secteur ou d'accumulateur. Le manche est en métal strié
rejoignant un corps rectangulaire doté d'un variateur d'intensité
électrique. Le cylindre, également de métal,
est recouvert d'un fourreau de caoutchouc gaufré.
Figure 65 :
Le Vigorator © Collection de l’auteur

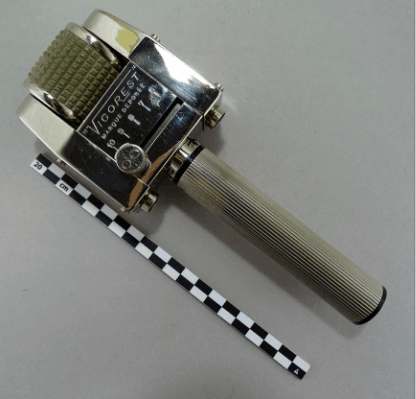
Benjamin Seacombe a fait une demande de brevet le 1er juin 1909 pour une machine magnéto-électrique
de massage (magneto-electric
massaging machine). Le brevet français porte le N°416422.
La firme Thompson & Capper y figure comme co-inventeur et co-demandeur.
Cet instrument est muni aussi d’une roulette au large crantage pour être confortable en roulant
sur la peau du patient [Fig.66]. Dans la partie arrondie opposée se trouve un
aimant permanent en forme de fer à cheval. Entre les deux,
une cascade d’engrenages fait tourner un bobinage entre les branches
de
233 Seacombe
B. Magneto-electric massaging machine Patent N° 12844, date
of application, 1st June, 1909 – Complete specification left, 1st
Dec., 1909 – accepted 10 Mar., 1910. His Majesty stationery office,
Love & Malcomson, Ltd 1910
Page 92
l’aimant produisant un courant électrique transmis
à la peau du patient par la surface métallique de
la roulette.
Figure 66 : Le Zodiac, Illustration d’une publicité publiée
dans la revue La Culture Physique N°220 du 1er mars 1914, revue
qui assurait la vente du « Zodiac » 
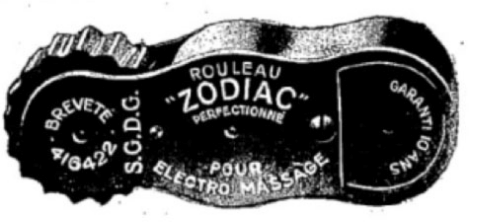
Edwin Thompson en 1924 fait des demandes de brevet pour un perfectionnement de cet instrument. Cette évolution
consiste en une plaque conductrice en contact avec la peau, munie
d’une poignée isolée, reliée par un conducteur
souple et une fiche à la carcasse de cet instrument magnéto-électrique.
6.3.2 Les instruments reliés à une pile
6.3.2.1 Le
cylindre de Stein
Cet instrument est constitué d’un cylindre de charbon
de 3cm de diamètre sur 10 de haut recouvert de cuir verni
relié au pôle positif d’une pile. Le pôle négatif
est relié à une électrode placée en
un point quelconque du patient. Il doit être roulé
rapidement [Fig.67].
234 Thompson
E. Improvements relating to magneto-electric machines for massaging
treatment Patent N° 223148, date of application : April 3, 1924
– Complete accepted : Oct. 16. 1924 –. His Majesty stationery office,
Love & Malcomson, Ltd 1924
235 Thompson
E. Perfectionnement aux appareils magnéto-électriques
pour le massage Brevet N° 579865 demandé le 7 avril 1924,
délivré le 14 août 1924, publié le 25
octobre 1924. Office national de la propriété industrielle.
Imprimerie nationale.
Page 93
Figure 67 : Le cylindre de Stein 
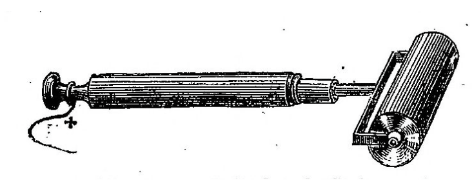
Le régénérateur organique électromagnétique
« SANITAS » du Dr Pion est alimenté par une pile de 4,5 V créant
un courant entre ses deux électrodes. Une poignée
permet de faire rouler l'appareil directement sur le corps du patient
grâce à des rouleaux jouant le rôle d’électrodes
cylindriques, tournantes [Fig.68]. De plus, le boîtier délivre à mi-distance
des électrodes un champ magnétique alternatif se fermant
sur la région balayée par l’appareil [Fig.69].
Figure 68 : [Fig.68]Le régénérateur organique électromagnétique
« SANITAS » du Dr Pion 
© Collection de l’auteur

236 Petitdant
B. Le régénérateur organique électromagnétique
« SANITAS » du Docteur Pion Clystère www.clystere.com
2020 ; 70 : 30-37
Page 94
Figure
69 : Vue inférieure, entre
les deux électrodes annelées servant à rouler
sur la peau se trouvent les aimants © Collection de l’auteur


Le XIXème siècle a vu la recherche d’un usage thérapeutique
de tous les agents physiques. Les vibrations en font partie. Massage
vibratoire, médecine vibratoire, trémulothérapie, vibrothérapie, sismothérapie sont des synonymes. Le néologisme « sismothérapie »
a été créé par Louis
de Lacroix de Lavalette pour sa thèse
soutenue en 1899, intitulée La Sismothérapie ou l'utilisation
du mouvement vibratoire en médecine générale
et particulièrement en thérapeutique gynécologique. Ce terme a ultérieurement été repris
à d’autres fins avant l’apparition de celui d’électro-convulsivo-thérapie,
plus connue sous le nom d’électrochocs.
La vibrothérapie consiste à imprimer, soit
à tout l’organisme, soit à une partie limitée
du corps, des vibrations rapides, régulières de faible
amplitude pendant un temps restreint. La vibration est une manœuvre classique de massage exécutée avec la pulpe d’un ou plusieurs
doigts. Si elles sont instrumentales, ces vibrations sont transmises
au corps par l’intermédiaire d’accessoires de formes variées,
les concus-
237 de
Louis
de Lacroix de Lavalette La Sismothérapie
ou l'utilisation du mouvement vibratoire en médecine générale
et particulièrement en thérapeutique gynécologique
Thèse Médecine Paris 1899 TDM 
238 Henri
Hartmann (1860-1952) Gynécologie
opératoire Paris : Steinheil ; 1911 TDM 
Page 95
seurs. Hartmann, Labadie écrivent concuteurs. Par contre, pour Kouindjy, Régnier, Marfort par exemple et divers catalogues il s’agit de concusseurs.
Le concuteur est une pièce de l’obus permettant de percuter
l’amorce et déclencher l’explosion. Même si en vibrothérapie
la peau est percutée, il nous semble plus opportun d’utiliser le terme concusseur.
Ces appareils sont très nombreux, certains ne nous
sont connus que par un encart publicitaire, pas toujours de bonne
qualité graphique, dans la presse écrite de l’époque.
Il y a pléthore d’appareils, car comme le note Brousses, « le massages
vibratoires a pris une place encombrante
dans la massothérapie ». La vibrothérapie est devenue, à elle seule, une méthode.
En effet « d’habiles metteurs en scène, auréolés
d’une indécente réclame et de la naïveté
populaire » l’ont réinventée et « à
l’aide d’instruments à noms barbares » l’emploient « à soulager l’humanité
beaucoup moins de ses maux que de sa bourse ».
Dans cette catégorie, prennent place les appareils
portatifs ne nécessitant aucun mécanisme particulier
pour produire des vibrations.
L’un des rares instruments entrant dans cette catégorie
est le « Vibrostat » de Stanislaus Sachs, du quartier de Charlottenburg de
Berlin, en Allemagne. Il dépose un premier brevet le 7 février 1919. Il récidive le 16 octobre
de la même année avec un deuxième brevet insistant sur la mise en œuvre de l’appareil. Enfin le
29 avril 1925,
239 Ibid.
240 Labadie-Lagrave F., Legueu
F. Traité médico-chirurgical de gynécologie
Paris : Félix Alcan ; 1904 TDM 
241 Kouindjy
P. Précis de Kinésithérapie
: La mobilisation méthodique, la massothérapie, la
mécanothérapie, la rééducation,
l'éducation physique Paris : Maloine ; 1922 TDM  [Note CFDRM 2eme édition, la 1ère
date de 1916 TDM [Note CFDRM 2eme édition, la 1ère
date de 1916 TDM  ] ]
242 Régnier
L.R. Mécanothérapie : Application du mouvement
à la cure des maladies J.B. Baillière : Paris ; 1901 TDM 
243 Marfort J.E. Manuel pratique de
massage et de gymnastique médicale suédoise Paris : Vigot ; 1907 TDM  [Note CFDRM c'est
la 3ème, mais l'EO. est de 1898 TDM [Note CFDRM c'est
la 3ème, mais l'EO. est de 1898 TDM  ] ]
244 Brousses J. Manuel technique
de massage Paris : Masson & Cie ; 1920 TDM ***
*  [Note CFDRM l'édition que nous vous
proposons date de 1896 mais l'EO est de 1892] [Note CFDRM l'édition que nous vous
proposons date de 1896 mais l'EO est de 1892]
245 Ibid.
246 Ibid.
247 Ibid.
248 Petitdant B. Le Vibrostat,
appareil de massage vibratoire Clystère www.clystere.com 2018 ; 63 : 4-16
249 Deutsche Reich, Reichpatentamt,
Patenschrift N°328245 Vibrationsapparat, Patentiert im Deutschem
Reiche vom 7 Februar 1919
250 Deutsches Reich, Reichpatentamt,
Patenschrift N°337035 Vibrationsapparat, Patentiert im Deutschem Reiche vom 16
Oktober 1919
Page 96
il dépose le brevet N° DE432591. Ce dernier numéro figure sur des notices et est
gravé sur certains appareils.
Cet appareil se compose d’un socle en bois tourné,
peint en noir, en forme globalement de cône tronqué.
Sa base, destinée au massage de grandes zones planes, est recouverte de caoutchouc.
Il est percé à son sommet d’un trou pouvant recevoir
une grande tige métallique. Il est également percé
d’un autre trou traversant le cône perpendiculairement à
sa hauteur [Fig.70] Lui aussi sert à recevoir la grande tige métallique
pour le stockage dans le coffret et pour l’application sur la hanche
par exemple.
La grande tige est métallique et cylindrique. L’une
de ses extrémités est mousse et libre pour pénétrer dans le socle. Par
contre, l’autre porte une pièce en bois tourné, de
couleur noire, avec, globalement, la forme d’un diabolo plein. L’une
des bases de ce diabolo servant au massage est plane. L’autre est percée en son centre d’un
pas de vis femelle destiné à recevoir le pas de vis
du concusseur. Le concusseur est composé d’une bille de caoutchouc surmontant
un cylindre en caoutchouc également. Une tige filetée
est fixée au centre du cylindre pour se visser dans le diabolo.
Figure 70 : Le Vibrostat, vue d’ensemble © Collection de l’auteur


251 Deutsches
Reich, Reichpatentamt, Patenschrift N°432591 Vibrationsapparat,
Patentiert im Deutschem Reiche vom 29 April 1925
Page 97
La petite tige métallique porte à l’une
de ses extrémités une douille cylindrique métallique
de 2cm de diamètre et de long. Cette douille cylindrique
est percée, suivant son diamètre, de part en part,
pour y introduire la grande tige. Elle coulisse à frottement doux le long de la grande tige. Contre cette douille
se trouve un tube caoutchouté strié, puis deux billes
entre lesquelles se trouve une bague libre sur la tige. A l’autre
extrémité, la tige se termine par une autre bille.
Cette petite tige est l’élément pendulaire produisant
les vibrations en coulissant le long de la grande tige
Le mode de fonctionnement est l’objet essentiel du brevet
N° DE337035 [Fig.71] La petite tige ou pièce pendulaire est mobilisée
entre le pouce et l’index au niveau de la bague (u). En exerçant
une pression (p) sur
la pièce pendulaire, par l’intermédiaire de la bague
(u) la douille (l) va entrer en contact avec la grande tige (g)
au niveau des points m et n diamétralement opposés.
Puis va revenir rapidement en appui le long de la tige (g) aux points
r et s. Ainsi de suite la pièce pendulaire va descendre le
long de la tige (g) par saccades, provoquant des oscillations vibratoires
transmises à la zone corporelle en contact avec le socle
ou le diabolo ou le concusseur.
Figure 71 : Illustration
du brevet de Stanislas Sachs permettant de visualiser le fonctionnement

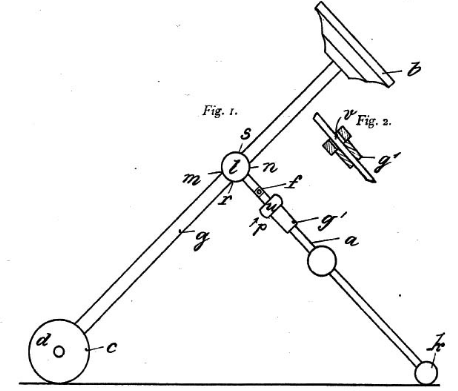
252 Deutsches Reich, Reichpatentamt, Patenschrift N°337035
Vibrationsapparat, Patentiert im Deutschem Reiche vom 16 Oktober
1919
Page 98
A l’inverse de la précédente, cette catégorie
est riche en instruments, tous apparus au début du XXème siècle.
La rotation d’une manivelle est transformée, par un système
d’engrenages, en mouvement de va-et-vient vertical, rectiligne, rapide du concusseur lui-même ou d’un plateau équipé de
concusseur. D’autres s’appuient sur un volant excentré produisant
des vibrations. L’effet est modulé par la vitesse de rotation
de la manivelle et la pression sur la peau. L’originalité de ces instruments
de massage
vibratoire à manivelle réside
dans le moyen de générer les vibrations.
Sous la dénomination de Pulsoconn existent plusieurs
appareils à la silhouette différente [Fig.72] ou portant des indications différentes 253, 254.
Figure 72 : Pulsoconn de
la première génération, fin du XIXème siècle
© JP Martin (www.clystère.com) 

L’année 1912 voit aussi le dépôt de
deux brevets en France demandés le même jour. Si le premier n’a
pas d’intérêt ici, le second correspond au brevet anglais
253 Martin
JP. Le Pulsoconn du Dr Macaura. Clystère 2013;19:14–8. www.clystère.com.
254 Petitdant
B. Le Docteur Macaura et son Pulsoconn, appareil de massage vibratoire
Kinesither Rev 2018;18(199):36–42
255 Macaura
GJ. Vibrateur à action oscillatoire pour massage et autres
applications. Brevet No 439099, demandé le 18 janvier 1912,
délivré le 29 mars 1912, publié le 5 juin 1912.
Office nationale de la propriété industrielle. Imprimerie
Nationale.
Page 99
N° 13932 de 1905 . Les industriels ont révisé les plans du
brevet anglais. En effet, les illustrations du brevet français
correspondent exactement à l’appareil commercialisé
[Fig.73].
Figure 73 : Le Pulsoconn
du docteur Macaura conforme au brevet français No 439100
et son concusseur caoutchouc en cloche. © Collection de l’auteur


La dénomination Veedee viendrait de la déclaration
de Jules César « Veni, vidi, vici ».
Le livret de l’appareil nous indique en effet, qu’à l’Ouest et dans le
Sud de l’Europe, aux Amériques et dans les pays du Commonwealth, cet instrument est
dénommé Veedee. Alors que dans les pays scandinaves,
en Allemagne, en Autriche, en Suisse et en Russie il est vendu sous le nom de « VENIVICI »
ce que confirme le catalogue d’Hermann Katsch .
256 Macaura
GJ. Appareil pulsateur pour massage et autres applications. Brevet
No 439100, demandé le 18 janvier 1912, délivré
le 29 mars 1912, publié le 5 juin 1912. Office nationale
de la propriété industrielle. Imprimerie Nationale.
257 Ibid.
258 Macaura
GJ. Improvements in and relating to vibrators for massage or like
treatments. Date of application 6th Jul 1905. Patent No. 13932 7th
Sept 1905. His Majesty's Stationery Office. Love & Malcomson
259 Garratt
J.E. The Veedee and how to use it London : Veedee Company ; sd
260 Katsch
H. Haupt- Preisliste Fabrik chirurgischer Instrumente, Orthopädisher
Maschinen Bandagenund Verbandstoffe Munschen 1906
Page 100
Figure
74 : Le Veedee et trois de ses concusseurs

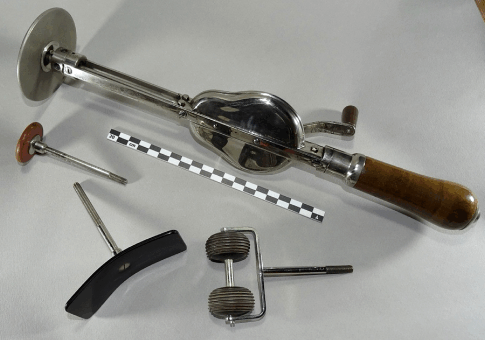
Le Veedee [Fig.74] possède une poignée servant à le
stabiliser et une manivelle pour actionner le mécanisme vibrant.
Pour le Veedee, le moyen de générer les vibrations se situe au niveau du disque distal. Il est percé d’un trou rectangulaire où
s’encastre un écrou carré [Fig.75] recevant vis et rondelle de fixation. Lorsque l’écrou
est en butée à une extrémité du rectangle,
le disque est centré et les vibrations sont faibles, A l’inverse,
plus il est rapproché de l’autre extrémité,
plus il est excentré et plus les vibrations sont fortes.
Le mode de graduation est défini par les déplacements
du bord de la rondelle sur des marques du disque. [Fig.76].
Figure 75 : [Fig.75] Gros plan du disque distal gradué du Veedee sans
sa fixation 
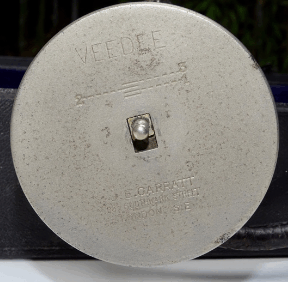
261 Petitdant
B. Le VEEDEE, appareil à main pour le massage vibratoire
Clystère (www.clystere.com) 2019 ; 69 :14-23
Page 101
Figure
76 : Gros plan du réglage
à l’aide du bord de la rondelle sur les graduations 
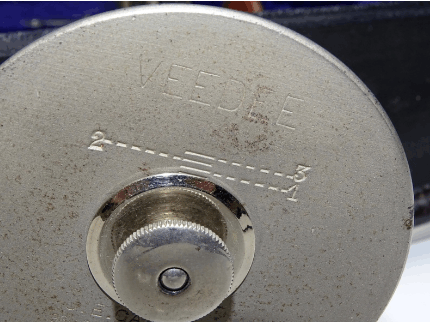
Les concusseurs se vissent immédiatement avant le disque dans
les trous prévus à cet effet [Fig.77].
Figure
77 : Les concusseurs se fixent dans
les emplacements prévus immédiatement avant le disque


Le Docteur Johansen est un inventeur prolifique, il a
déposé quarante brevets entre 1903 et 1917. Certains ne sont que des adaptions, des améliorations
de brevets précédents. Le même brevet peut se
rencontrer également dans plusieurs pays.
262 Petitdant
B. Docteur Johansen et les quarante brevets Clystère (www.clystere.com) 2020 ;71 :9-19
Page 102
Cependant plusieurs de ces instruments ont dépassé
le stade de prototype pour être commercialisés.
Protégé par deux brevets, en 1910, l’un
anglais N°19032 et l’autre américain N°1177415, ce
n’est qu’en France que cet instrument porte le nom de Manipulse
[Fig.78].
Figure
78 : Le Manipulse et un concusseur
de caoutchouc en cloche détérioré par le temps

© Collection de l’auteur

Le Manipulse répond probablement au Pulsoconn du
Docteur Macaura.
Johansen’s Danik Auto-vibrator, cette expression anglaise,
dite « cas possessif » n’était pas
comprise en France, un changement de nom pour le marché francophone
a été nécessaire. Cet instrument transmet ses
vibrations de deux manières indépendantes. Elles peuvent
se faire classiquement par un concusseur ou par les 2 masselottes
 convexes, mobiles
sur un pied de biche, entrant en contact sur la peau sous la forme
de tapotements. Plus les masselottes sont éloignées de
l’axe du Manipulse plus leurs vibrations sont importantes [Fig.79]. convexes, mobiles
sur un pied de biche, entrant en contact sur la peau sous la forme
de tapotements. Plus les masselottes sont éloignées de
l’axe du Manipulse plus leurs vibrations sont importantes [Fig.79].
Page 103
Figure 79 : L’extrémité
inférieure du Manipulse. Lorsque le concusseur vissé
au centre est retiré les masselottes coulissant sur leur
pied de biche entrent en contact avec la peau. © Collection
de l’auteur 

6.4.2.3.2 Dr Johansen’s auto-vibrator (vibrateur du Dr
Johansen) ou le New American vibrator
Là encore le « cas possessif »
a conduit à l’appellation New American vibrator en France.
Cet instrument de massage
vibratoire est protégé
par trois brevets. Un brevet danois et français, identiques, concernent la partie distale recevant les
concusseurs. Aucun mécanisme ne relie la manivelle et le
concusseur. Tout le système est enfermé dans le carter
central [Fig.80]. Les vibrations sont produites par le volant d’inertie. Il est constitué
de deux demis volants, dont l’un est mobile. Son déplacement
est utilisé pour régler l’intensité des vibrations.
En fonction du réglage, allant d’une opposition complète
à une superposition complète des demis volants, les
oscillations vont varier d’une amplitude faible à forte.
La position du concusseur donne des vibrations différentes.
Placé dans l’axe de l’appareil, il produit des frictions. A l’inverse, un
263 Johansen
J.C. Anordning til anbringelse af massagepelotter i vibratorer.
Danskt Patent N°10863. Patent udstedt den 12. Maj 1908, beskyttet
fra den 8 Juli 1907
264 Johansen
J.C. Dispositif de réglage pour les pelotes de massage dans
les instruments vibratoires. Brevet d’invention N° 392106, demandé
le 7 juillet 1908, délivré le 16 septembre 1908, publié
le 18 novembre 1908. Imprimerie Nationale
Page 104
positionnement perpendiculaire à l’axe, ce sont
des tapotements et évidement, une inclinaison intermédiaire
un mélange des deux [Fig.81].
Figure
80 : Le New American Vibrator, avec
trois concusseurs dont un installé à 45°. 
© Collection de l’auteur

Figure 81 : Le bouton de
réglage du New American Vibrator 
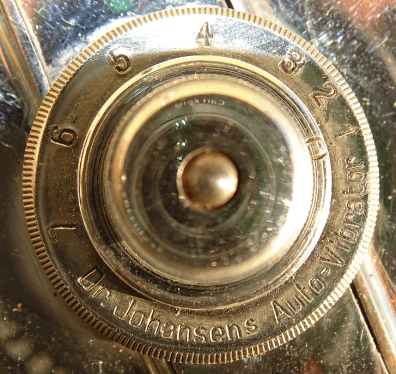
Le repère () est en regard de la graduation 1 engendrant
de faibles vibrations
265 Petitdant
B. Auto-vibrator du Docteur Johansen, New American Vibrator, deux
noms pour un même instrument de massage vibratoire Kinesither
Rev 2020 ;20(228) :33-6
Page 105
Marfort a fait construire un vibrateur « ne pesant
pas même 500g … de 18cm de long » et il « peut
donner 6000 vibrations par minute ». Ces vibrations sont
axiales et transversales. Le manche du vibrateur peut être
placé à différents endroits pour faciliter
la prise en main et lui donner la direction voulue. Cet instrument
n’a pas dû dépasser le stade de prototype [Fig.82].
Figure
82 : Le vibrateur de Marfort 
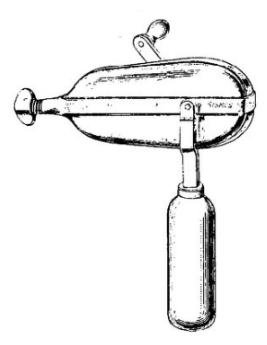
Le Professeur Zabludovski de l’Institut de Physiologie de Berlin utilise ce qu’il
dénomme Vibrationsapparate possédant une manivelle
à distance. Une roue à large bande de roulement, munie d’une
manivelle, est solidement fixée sur une table. Un cylindre
de petit diamètre entre en contact avec la bande de roulement.
Il entraîne le flexible actionnant la partie vibrante. Le
rapport entre la circonférence de la roue et du cylindre
permet une rotation suffisamment rapide. Il faut un masseur pour utiliser le vibro-masseur et un aide pour actionner le moteur. Les seuls réglages
possibles sont l’importance de la pression exercée par le
masseur ou la vitesse de rotation de la roue imprimée par
l’aide [Fig.83].
266 Marfort
J. E. Manuel pratique de massage et de
gymnastique médicale suédoise Paris : Vigot Frères
; 1907 TDM  [note CFDRM : c'est
la 3ème édition, sachant que la 1ère est
de 1898 [note CFDRM : c'est
la 3ème édition, sachant que la 1ère est
de 1898  ] ]
267 Eiger
J.
Zabludovski’s technik der massage Leipzig
: Georg Thieme ; 1911 [note CFDRM
: la 1ère édition française est de 1904,
Ed. G. Steinheil TDM  ] ]
Page 106
Figure
83 : Le Vibrationsapparate du Pr.
Zabludovski [note CFDRM : 1850/51-1906]
à moteur à main fixé sur table

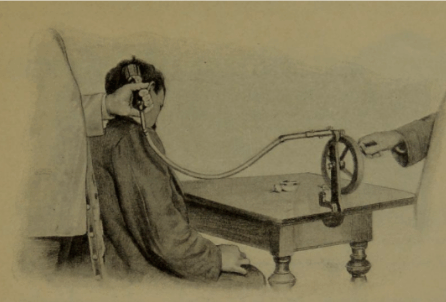
C’est en réaction aux appareils de Zander [note CFDRM : 1835-1920]
(cf. 6.3.6.1.) que le Docteur Ewer a créé
son Concussor. Contrairement aux appareils de Zander, il fonctionne
sans moteur et peut être utilisé par le médecin
sans aide. Il s’agit d’un tour de dentiste qui fonctionne par pédalage
[Fig.84]. Le porte-fraise devient un porte-concusseur. Les vibrations
sont obtenues en excentrant le système. La fréquence
des vibrations est fonction de la vitesse de pédalage de l’opérateur.
Il se retrouve dans le catalogue de Carl Wendschuch.
Figure 84 : Le « Concussor »
du Docteur Ewer 
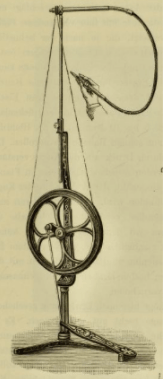
268 Wendschuch
C. Haupt Katalog Ausgabe Dresden : Lehmannsche Buchdruckrei ;1910
Page 107
Le premier Clock-work percuteur de Mortimer-Granville (cf 6.3.4.5.1) était un
instrument de massage
vibratoire à ressort d’horlogerie
d’où son nom. Son évolution l’a conduit à fonctionner
avec une batterie. Pour éviter des redondances, sa description
figure avec les instruments portatifs électriques.
Le principe de ces instruments est fondé sur un
ressort d’horlogerie. Une fois remonté, il actionne une cascade
d’engrenages entraînant le flexible. N’utilisant ni pile,
ni électricité, ni manivelle, ni air comprimé,
ni l’eau courante, L’Esthética doit être mû par
un ressort. Son fabricant promet 1000 vibrations à la minute
[Fig.85].
Figure 85 : Encart publicitaire
pour l’Esthética 

Même si des brevets d’instruments pneumatiques de
massage se retrouvent pour la période considérée,
à notre connaissance un seul est arrivé au stade de
la commercialisation en Europe. Ainsi, un seul instrument de massage vibratoire utili-
269 Mortimer-Granville
J. Nerve Vibration and excitation London : J. & A. Churchill
; 1883
270 Rodeck
C.G. Appareil de massage vibratoire à air comprimé
Brevet N° 463551 demandé le 11 octobre 1913, délivré
le 19 décembre 1913, publié le 26 février 1914.
Office national de la propriété industrielle. Imprimerie
nationale.
271 Sibrower
F.C. Appareil pneumatique pour massage vibratoire Brevet N°
782530 demandé le 22 août 1934, délivré
le 18 mars 1935, publié le 6 juin 1935. Office national de
la propriété industrielle. Imprimerie nationale.
272 Brichieri
Comombi L., Zappulli 0., Romanelli L. Dispositif pneumatique portatif
pour massage vibratoire Brevet N° 835726 demandé le 25
mars 1938, délivré le 3 octobre 1938, publié
le 29 décembre 1938. Office national de la propriété
industrielle. Imprimerie nationale.
Page 108
sant un gaz peut être présenté. Par
contre, un autre fluide sous pression a été bien plus
utilisé, l’eau.
Eduard Kaiser était à la fois Docteur en
médecine et Docteur en philosophie. Il ouvrit une librairie
à Berlin en 1875, devenu Institut für Mikroskopie (Institut
de microscopie) en 1877. Son objectif principal semble avoir été
la commercialisation de microscopes de divers fabricants, de lames
de microscope et d’appareils pour les projeter. Kaiser a vendu sa
boutique en 1879 à Charles Ponge. Il déménage
le magasin en conservant la dénomination Dr Eduard Kaiser’s
Institut für Mikroskopie comme l’atteste le Berliner Adressbuch. Ponge a revendu le commerce à Graziano Sartori
en 1894. Pharmacien et chimiste, il fait d’importantes modifications
en créant, par exemple, un rayon photographie. Il crée
une seconde boutique orientée vers la pharmacie, mais la
dénomination commerciale reste toujours inchangée.
Il s’intéresse au massage
vibratoire et dépose entre
1902 et 1904 quatre brevets. Le premier est anglais, le deuxième suisse tout deux protègent la même invention. Le
troisième et le quatrième sécurisent une évolution
du même instrument aux USA et en Autriche-Hongrie. Une démarche non surprenante, en effet, Sartori
résidait à Berlin mais était sujet de l'Empereur
d’Autriche-Hongrie.
273 Historical
makers of microscopes and microscope slides http://microscopist.net
consulté le 29 janvier 2021
274 Berliner
Adressbuch, https://digital.zlb.de consulté le 29 janvier
2021
275 Ibid.
276 Sartori
G. Device for mechanical skin treatment or massage, Patent N°8726,
date of application 27th Apr., 1901, accepted 9th Jan. 1902. Printed
for His Majesty Stationery Office, Malcomson & Co Ltd, 1902.
277 Sartori
G. Für Betrieb mittelst eines gasförmigen Druckmittels
eingerichtete Massiervorrichtung Patent N° 22732 26 Juli 1901.
Schweizerische Eidgenossenschaft
278 Sartori
G. Apparatus for massaging, Patent N°732897, application filed
August 14, 1902, patented July 7, 1903. United States Patent Office.
279 Sartori
G. Massiervorrichtung Österreichische patentschrift N°17826
Angemeldet am 16. Juli 1902 –
Beginn der
Patentdauer : 15 April 1904. Kais. Königl. Patentamdt Ausgegeben
am 10 OKtober 1904
Page 109
Figure
86 : Illustration d’une publicité
parue dans un journal allemand le 28 février 1903 
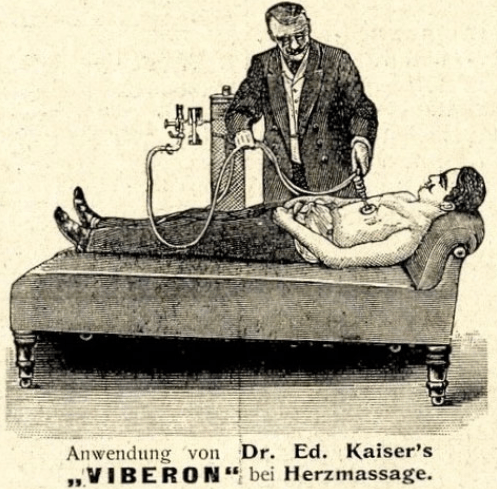
Le Dr Kaiser avait émigré, en 1884, aux
USA et avait été naturalisé en 1892. Le Viberon,
invention de Graziano Sartori, n’a conservé le nom du Dr
Ed. Kaiser que pour une bonne renommée commerciale. Des publicités
invitant à des séances de massage prouvent que cet appareil a bien été fabriqué.
Les brevets indiquent que le Viberon fonctionne à la vapeur ou avec de l’acide carbonique, élément
confirmé par la bouteille en arrière-plan du dessin
[Fig.86].
La pression de l’eau fait fonctionner l’instrument grâce
à un tuyau relié à un robinet d’eau courante.
Il nous est connu par des encarts publicitaires [Fig.87].
Page 110
Figure
87 : Publicité pour le Fageko
parue dans la revue Woche de mars 1921 
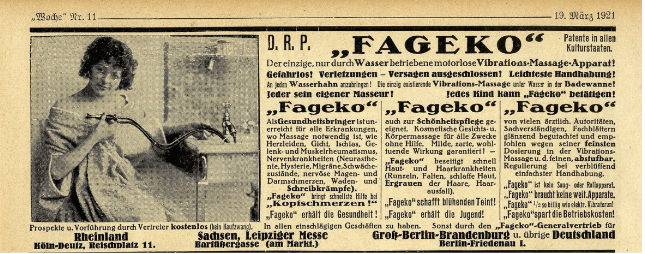
Utilisé en Allemagne par les médecins et les sportifs, le Taifun a
été présenté à la Foire de Leipzig
en 1928. Pour lui aussi, il suffisait d’un robinet d’eau courant
et d’une évacuation pour fonctionner [Fig.88].
Figure 88 : Le Taifun présenté
à la foire de Leipzig en 1928 
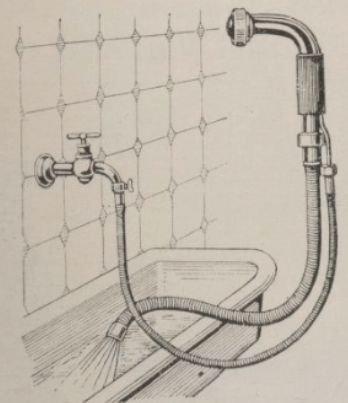
280 Coliez
G. La foire commerciale de Leipzig en 1928 Revue industrielle 1928
; 74 :601
Page 111
Sur le même principe, l’American Vibrator est proposé
en France. D’américain il n’avait que le nom. En effet, il
s’agit d’une invention d’Amable Duplaix, citoyen français.
Il avait fait une demande de brevet en décembre 1917. Il a, peut-être, choisi le nom commercial de cet
instrument en hommage à l’engagement militaire des USA depuis
avril 1917 [Fig.89].
Figure
89 : [Fig.89] Illustration du brevet d’Amable Duplaix. Le tuyau (11)
est branché au robinet d’eau courante qui remonte en périphérie
du tuyau central, soulève un diaphragme que comprime le ressort
(2) et s’évacue par le tuyau central (14). Les va et vient
du diaphragme, du ressort et du piston (1) génèrent
les vibrations.
A droite, les différents concusseurs adaptables 
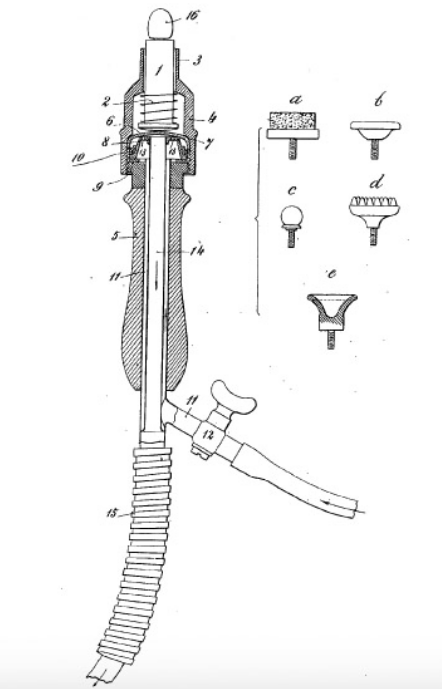
281 Duplaix
A. Appareil de massage Brevet N° 488311 demandé le 8
novembre 1917, délivré le 18 juin 1918, publié
le 20 septembre 1918. Office national de la propriété
industrielle. Imprimerie nationale.
Page 112
Cet instrument nous est connu uniquement par son brevet
et sa publicité parue dans plusieurs quotidiens comme « Le
Matin »282.
Si cet instrument ne se retrouve plus de nos jours, c’est
peut-être, comme le fait remarquer le mensuel La Publicité, qu’un encart de 65mm, avec « clichés
usés et effacés, impression grise, lettre maigre,
texte sans air » n’attire pas l’œil. « Si
avec une pareille annonce, l’American Vibrator se vend, c’est que
la stupidité et le gobisme du public dépasseront tout
ce que les expériences précédentes en avaient
révélé » [Fig.90].
Figure 90 : La publicité
décriée de l’American vibrator 
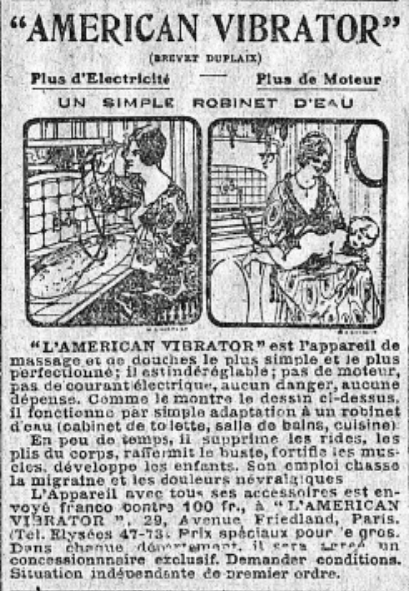
282 Le
Matin N° 12980 du 12 septembre 1919, page 4
283 Anonyme
Revue de la publicité La Publicité 1919 ;140 :348
Page 113
Le premier de tous les appareils de massage
vibratoire, le Clock-percuteur de
Mortimer-Granville appartient à cette catégorie. Les
catalogues des fabricants d’appareils médicaux et chirurgicaux,
du début du XXème siècle, nous livrent sous le terme d’appareils
pour massage vibratoire, de vibrateurs, voire de vibro-masseur des appareils à la silhouette voisine les uns
des autres. Le mouvement rotatif de l’axe d’un moteur mis en mouvement
par le courant électrique du secteur est transformé
par un mécanisme, variant d’un fabricant à l’autre,
en un mouvement de va et vient latéral et aussi vertical.
Ces mouvements donnent une sensation de vibration au contact de la peau. Il en existe de nombreux nous
proposons ici quelques exemples.
Joseph Mortimer Granville (1833-1900) est un médecin
anglais, membre de l'Église épiscopale, auteur de
nombreux ouvrages médicaux et de vulgarisation. En 1883,
il publia les résultats de sa méthode, d’abord dans
des articles de The Lancet, puis dans un ouvrage plus détaillé. Il agit toujours localement avec un appareil portatif
et fiable dénommé Clock-work percuteur [Fig.91] ou
Clock-percuteur fonctionnant d’abord avec un ressort d’horlogerie,
d’où son nom, comme évoqué précédemment
(Cf. 6.3.4.3.) puis sur batterie [Fig.92] sans modification du nom.
284 Brodart
H. Catalogue illustré n° 10, Instruments de chirurgie,
orthopédie Paris ; 1934
285 Catalogue
de l’exposition du 3ème congrès de Physiothérapie,
Paris 29 mars-2 avril 1910. Imprimerie Aragno, Paris.
286 Rainal
Frères Catalogue général 1825-1934 Paris :
H.M. Boutin ; 1934
287 Mortimer-Granville
J. Treatment of pain by mechanical vibrations The Lancet 1881; 117(2999):
286-88
288 Mortimer-Granville
J. Nerve Vibration as a therapeutic agent The Lancet 1882 ; 119(3067)
: 949-51
289 Mortimer-Granville
J. Nerve Vibration and excitation London : J. & A. Churchill
; 1883
Page 114
Figure 91 : Le Clock-percuteur
dans sa version à ressort. 
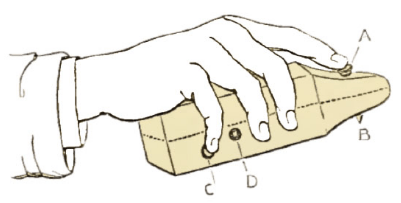
En appuyant sur le bouton A, la longueur de la course
augmente, la vitesse est légèrement réduite,
alors que la force du coup est augmentée. B : Le marteau
en ivoire pointu avec lequel la percussion est faite. Un marteau
à tête plate ou une brosse peut être substitué
à la pointe d’ivoire. C : Tant que ce bouton est pressé
par le doigt, le marteau continue son action. Lorsque la pression
cesse, il s'arrête. D : le remontoir.
Figure 92 : Dernière
génération du Clock-percuteur fabriqué par
Weiss & Sons 
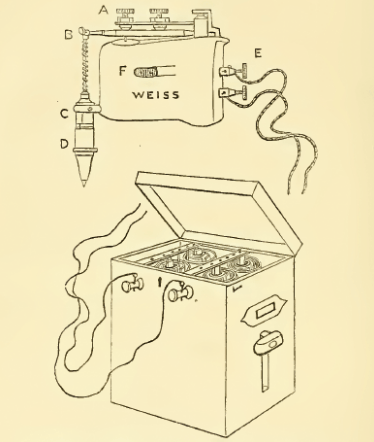
Les concusseurs sont plus percutants que vibrants, et de forme variable : un bouton,
un disque, un petit marteau à tête plate, un pinceau ou une brosse [Fig.93] suivant la volonté du médecin d’agir ponctuellement
ou sur une surface plus étendue.
Page 115
Figure 93 : Les différents
concusseurs de Mortimer-Granville 
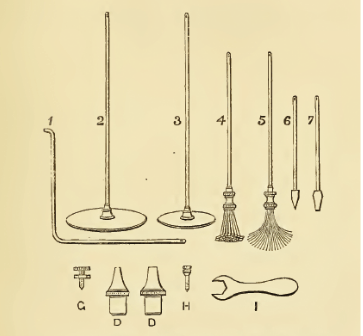
Lors du traitement de la région distale d’un membre,
il peut être placé directement dans l’eau [Fig.94]. Elle sera utilisée pour diffuser les vibrations. Les séances sont d'une durée variable
suivant les cas.
Figure
94 : La longue tige des concusseurs permet un traitement dans l’eau sans dommage pour l’instrument

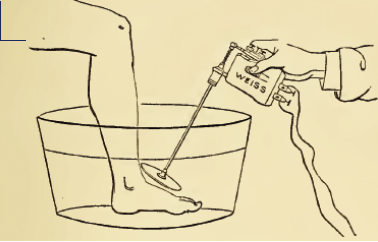
Le premier clock-percuteur a été fabriqué
d’après des plans datés du 5 janvier 1877 à
Londres, New Bond Street par Streeter, les suivants à Paris
par Collin, successeur de Charrière et la dernière
génération fonctionnant sur batterie par Weiss &
Sons [Fig.92]
Page 116
Ils se composent d'une dynamo munie d'excentriques. La
dynamo est montée sur un socle auquel un manche peut s’adapter.
Un couvercle en métal recouvre et protège le moteur.
Il sert lui-même de grande surface vibrante. Divers concusseurs peuvent se monter sur l'appareil [Fig.95] Ce vibrateur peut fonctionner avec un simple accumulateur.
Labadie trouve que, de tous, c’est le plus pratique.
Figure
95 : Vibrateur à dynamo 
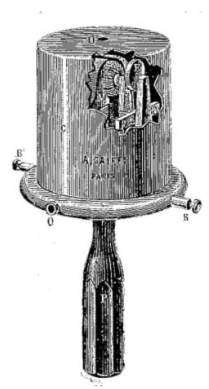
Issak Robert Zalkind fonde un atelier de fabrication de
petits appareils électro-médicaux en 1912. « ROZAL »
était la marque de fabrique déposée, symbolisée
par une croix grecque à l’intérieur d’une étoile
à cinq branches surmontant le mot « PARIS ».
L’entreprise de Robert Zalkind était située 17 rue
Séguier à Paris. Elle déménagea ensuite au 16-18 rue d’Odessa
toujours à Paris. Seule la discrète marque de fabrique
était appliquée sur les appareils, ce qui permettait
à Robert Zalkind de vendre à d’autres. Ils pouvaient
ajouter la leur, souvent plus voyante, sur le manche ou le corps
de l’appareil. Entre 1914 et 1922, Robert Zalkind dépose
huit brevets. Trois con-
290 Labadie-Lagrave
F., Legueu F. Traité médico-chirurgical de gynécologie
Paris : Félix Alcan ; 1904
291 Annuaire
du commerce Didot-Bottin 1921, Tome 3, Rue de l’Université,
Paris
Page 117
cernaient des appareils de massage . Il existe un appareil de type A [Fig.96] et un de type B [Fig.97]. Ils sont différenciés par la position
du moteur, verticale pour le type A, horizontale pour le type B.
Le brevet de cet appareil a été demandé le
18 avril 1919. Les fabrications de Robert Zalkind ressemblaient aux
appareils produits aux États Unis et concurrençaient,
avec succès, en France, les productions Allemandes de la
même époque.
Figure 96 : L’appareil
de type A d’après le catalogue ROZAL (avec l’autorisation
d’Hélène Zalkind) 

292 Zalkind
R.I. Appareil pour massage par tapotement, fonctionnant à la main ou au moteur.
Brevet d’invention N° 464586, demandé le 22 octobre 1913,
délivré le 16 janvier 1914, publié le 25 mars
1914. République Française. Office national de la
propriété industrielle
293 Zalkind
R.I. Appareil électrique pour massage vibratoire. Brevet
d’invention N° 498484, demandé le 18 avril 1919, délivré
le 20 octobre 1919, publié le 13 janvier 1920. République
Française. Office national de la propriété
industrielle.
294 Zalkind
R.I. Appareil à massage vibratoire. Brevet d’invention N°
502467, demandé le 9 août 1919, délivré
le 21 février 1920, publié le 15 mai 1920. République
Française. Office national de la propriété
industrielle
295 Zalkind
R.I. Appareil électrique pour massage vibratoire. Brevet
d’invention N° 498484, demandé le 18 avril 1919, délivré
le 20 octobre 1919, publié le 13 janvier 1920. République
Française. Office national de la propriété
industrielle.
296 Petitdant
B. Un appareil français de massage vibratoire, production
d’Issak Robert Zalkind Kinesither Rev 2019 ; 19(216) : 60-3
Page 118
Figure 97 : L’appareil de type B © Collection de l’auteur 

Le vibro-masseur d’Heinrich
Simons modèle Berlin nous est connu par une publicité.
Elle doit dater de 1921 selon le site Brand-History.com [Fig.98].
Figure 98 : Publicité
pour le Simo-Vibrator, modèle Berlin, d’Heinrich Simons 

Cet appareil mesure, avec son concusseur, 15.5cm de large (14 cm sans le concusseur) et 23cm de
haut avec sa poignée. Il pèse 990g avec son câble
d’alimentation. Il a été fabriqué par la société
M. Rupalley et Cie, 27 rue de Liège à Paris. Il fonc-
297 https://brand-history.com/heinrich-simons-g-m-b-h-berlin-teltow/simo-vibrator/simo-vibrator-simo-vibrator-der-dauerhafteste-und-betriebssicherste-elektrische-hand-vibrator-unentbehrlich-fur-eine-erfolgreiche-schonheits-und consulté le 29 janvier 2021
298 Petitdant
B. Un appareil électrique portatif de massage vibratoire
Rupalley et Cie Clystere 2017 ; 60 : 6-18
Page 119
tionne en 110 volts. Au-dessus du manche se trouve le
moteur électrique dissimulé dans un cylindre chromé,
prolongé par un cône également chromé.
Ce cône contient le système transformant les rotations
du moteur électrique en déplacements latéraux
ou longitudinaux. Ces mouvements vont donner la sensation de vibrations au niveau cutané.
Figure 99 : L’appareil
produit par Rupalley et Cie 
Les prises murales étant rares, notez la douille
voleuse en buis pour le branchement à la place d’une ampoule
© Collection de l’auteur

Cet appareil permet de donner un exemple de l’un de ces
systèmes [Fig.99]. Un court tube vissé sur l’axe moteur contient
un ressort occupant la lumière du tube. Une pièce,
ressemblant à un épi de faitage, comprend un cône
avec une petite boule à son sommet et une grosse boule à
sa base. Sous la grosse boule se trouve un court cylindre et une
tige filetée. La grosse boule comporte une rainure longitudinale
pour recevoir une vis. La petite boule rentre, contre le ressort,
dans le tube solidaire de l’axe moteur. Elle est maintenue en place
par une bague vissée au sommet du carter conique et par une
vis traversant d’abord cette bague, puis le filetage du carter conique
et entrant dans la rainure. Sur la tige filetée se fixe le
concusseur en bois de hêtre teinté [Fig.100]. Il existe, bien sûr, des variantes pour chaque
appareil, pour la propriété industrielle de chacun.
Page 120
Figure 100 : Les éléments
du cône, de gauche à droite le concusseur, la bague
vissée, la pièce en épi de faitage, le cône
chromé, le tube contenant le ressort se vissant sur l’axe
moteur 
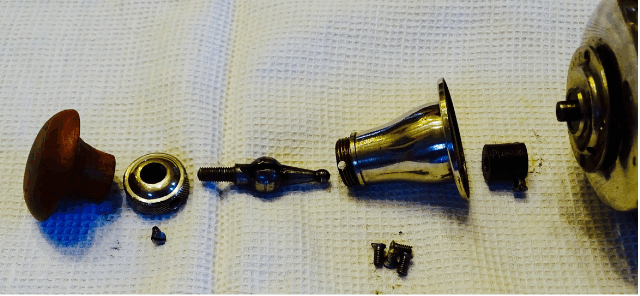
Cet appareil, fabriqué à Berlin, est l’un
des plus emblématique. Il était préconisé
pour favoriser la circulation sanguine de toute région du
corps. L'appareil s’est répandu dès 1919. Le SANAX était, ce que l’on dénommerait de nos jours,
l'un des leaders du marché [Fig.101]. D’abord sous carter sphérique, la diversification
de la gamme conduit à des appareils plus volumineux.
Figure
101 : Ensemble de publicité
au format timbre-poste courante en Allemagne
dans les années 1920-1930 
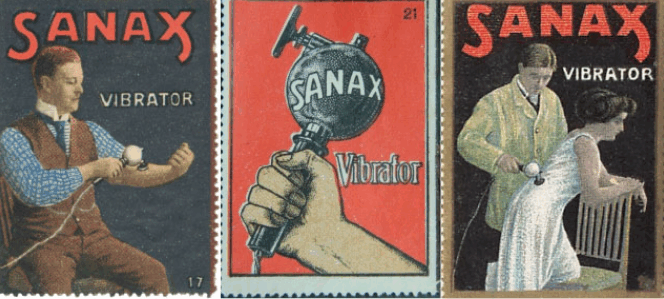
Page 121
Le vibrateur représenté [Fig.102] comporte un moteur à courant continu de 16 volts
et de 4 à 5 ampères, entraînant un flexible
(F). Il fait tourner un excentrique contenu dans la boîte
(B) surmontant le manche. Les roulements de l'excentrique se font
sur billes, sur la boîte (B) les différents concusseurs se fixent en bout ou latéralement (a).
Figure 102 : Le moteur
entraîne un flexible (F) qui fait tourner un excentrique contenu
dans la boîte (B) surmontant le manche (M), différents
concusseurs se fixent en bout ou latéralement (a) 
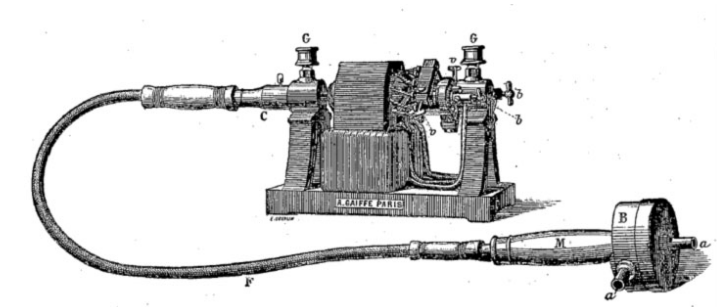
Un autre appareil électrique à flexible,
plus simple, posé sur table est plus couramment employé.
Les instruments retrouvés dans cette catégorie sont
très voisins les uns des autres. Un petit moteur électrique,
fonctionnant avec le courant alternatif, développe une force
de 15 kilogrammètres avec une vitesse de 1 800 à 2000
tours à la minute. Il est placé sur une table sur
laquelle sont parfois également disposés un coupe-circuit,
un interrupteur et un rhéostat  , permettant de régler la vitesse du moteur. Labadie nous signale que l’appareil est relié au courant
du secteur par un câble , permettant de régler la vitesse du moteur. Labadie nous signale que l’appareil est relié au courant
du secteur par un câble
299 Labadie-Lagrave
F., Legueu F. Traité médico-chirurgical de gynécologie
Paris : Félix Alcan ; 1904
Page 122
souple [Fig.103].
Figure
103 : Un vibrateur électrique
simplifié utilisé à l’Établissement
thermal de Spa 
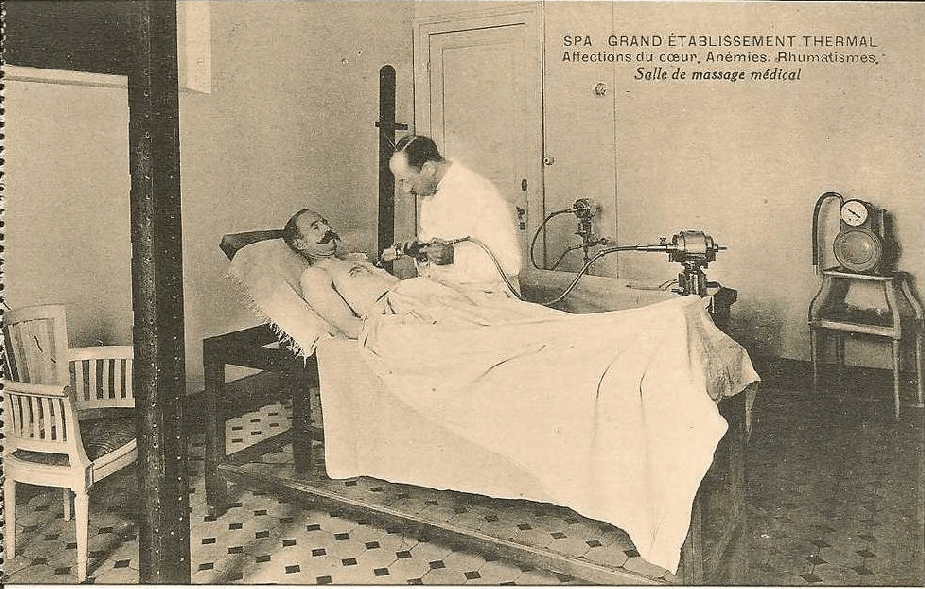
Le mouvement de rotation est transmis à un concusseur par un flexible adapté directement sur l'arbre
du moteur. La firme Stanley Cox Ltd de Londres proposait, dans les
années 1920, le Power pour 25£, le pied et la carrosserie
du moteur émaillé noir, les autres parties étaient
nickelées [Fig.104].
Figure 104 : Le Vibrateur
Power vendu par Stanley Cox Ltd 
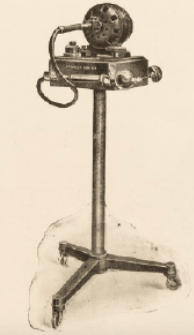
Page 123
Le vibrateur électrique simplifié pour lequel
nous avons trouvé un maximum d’information est le « Trémolo » [Fig.105]. Cet appareil à rhéostat  , breveté, fonctionne sur courant alternatif ou
continu en 12 ou 24 volts. Le flexible reliant le moteur et le Trémolo
est démontable. Le moteur est fixé sur un tabouret d’acajou ou de noyer ciré. , breveté, fonctionne sur courant alternatif ou
continu en 12 ou 24 volts. Le flexible reliant le moteur et le Trémolo
est démontable. Le moteur est fixé sur un tabouret d’acajou ou de noyer ciré.
Figure 105 : Le tabouret
supportant le moteur, le flexible et le Trémolo suspendu
à droite 

Six concusseurs viennent se visser sur la tête du
Trémolo. Le premier, destiné au dos et à l’abdomen,
est un disque pneumatique de 115 mm de diamètre [Fig.106].
Figure 106 : Concusseur
à disque pneumatique pour le tronc 

300 Drapier
Catalogue bandages herniaires, ceintures, bas pour varices, accessoires
Paris : 1911
Page 124
Pour le cœur, est prévu un plateau d’ébonite
de 70mm de diamètre avec support à cardan [Fig.107].
Figure
107 : Concusseur à plateau
et son support à cardan pour la région précordiale

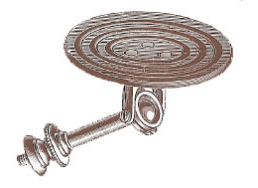
Pour le pharynx, un concusseur d’ébonite en V doit
être utilisé [Fig.108].
Figure 108 : Concusseur
d’ébonite en V pour le pharynx 

Il existe deux modèles de double rouleau rotatif,
l’un de 40, l’autre de 68mm de diamètre. Ce sont des galets
d’ébonite caoutchoutée. Ils sont destinés à
l’abdomen, au dos, aux membres [Fig.109]
Figure
109 : [Fig.109] Concusseur à double rouleau en ébonite
caoutchoutée 
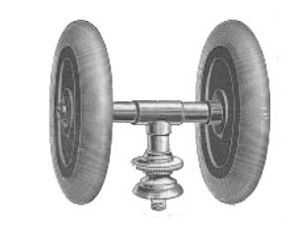
Page 125
Le « frontal » comme son nom l’indique
est destiné au visage [Fig.110]
Figure 110 : Concusseur
dit « Le Frontal » à lame souple 
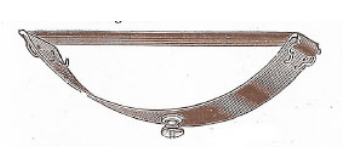
Les concusseurs ronds, ovales ou sphériques sont
en gutta-percha, ils existent en diamètre de 2.5, 4, 6 et
7cm de diamètre [Fig.111].
Figure
111 : Exemple de concusseur rond


Le professeur Zabludovski utilise un appareil du même type mais fonctionnant
avec un accumulateur portable. Le concusseur utilisé est
en caoutchouc souple de forme hémisphérique de 7.5cm
de diamètre [Fig.112].
301 Eiger
J. Zabludovski’s technik der massage Leipzig : Georg Thieme ; 1911
[note CFDRM : la 1ère
édition française est de 1904, Ed. G. Steinheil
TDM  ] ]
Page 126
Figure
112 : Le Pr Zabludovski est représenté utilisant son appareil de
massage
vibratoire électrique fonctionnant
avec un accumulateur  [note CFDRM : c'est à la page 145 de la 1ère édition française est
de 1904, Ed. G. Steinheil TDM [note CFDRM : c'est à la page 145 de la 1ère édition française est
de 1904, Ed. G. Steinheil TDM  ] ]
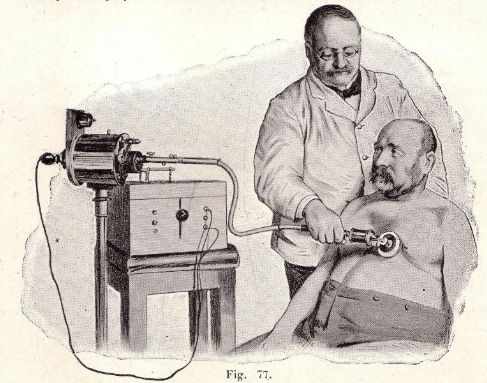
Ces vibrateurs électriques simplifiés ont
servi de base à un instrument produisant des percussions.
A l’extrémité du flexible est fixé un manche
porteur de lanières de cuir ou de caoutchouc, plus ou moins
nombreuses, plus ou moins espacées les unes des autres. La
fréquence des percussions dépend de la rotation du
moteur et de l’espacement des lanières [Fig.113].
Figure
113 : Le Dr Pierre
Kouindjy [1862-1928] appliquant
des percussions à l’aide d’un manche muni de lanières
dont la rotation est actionnée par un vibrateur électrique
simplifié visible à gauche 

302 Ibid
Page 127
Colombo, cité par Kouindjy, propose d’interposer l’avant-bras ou la main pour atténuer
les vibrations et rendre la technique plus supportable. Il parle « d’humanisation »
de la technique [Fig.114].
Figure
114 : « Humanisation »
des vibrations réalisées par le Dr Pierre Kouindjy

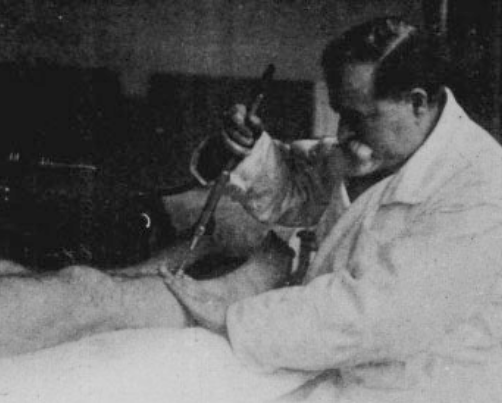
Emil
Muschike, comme Josef Semerak (cf. 6.3.2.6.),
était masseur. Il a inventé un vibrateur sans concusseur interchangeable.
Le moteur électrique fait tourner deux marteaux diamétralement
opposés. Ils viennent frapper une plaque et produisent ainsi
des vibrations. Il ne repose pas sur table mais est fixé
en hauteur sur un bras articulé [Fig.115]. Au cours de l’année 1898, Emil Muschik a déposé
quatre brevets au Royaume Uni , aux USA, en Suisse et au Danemark. Ce vibrateur n’est men-
303 Kouindjy
P. Précis de Kinésithérapie : La mobilisation
méthodique, la massothérapie, la mécanothérapie,
la rééducation, l'éducation physique Paris
: Maloine ; 1922
304 Muschik
E. Improvements in massage apparatus, Patent N°8461, Date of
application 9th Apr. 1898, accepted 16th July, 1898. Printed for
His Majesty Stationery Office, Malcomson Ltd, 1898.
305 Muschik
E. Massage device, Patent N°636163, application filed June 6,
1898, patented October 31, 1899. United States Patent Office
306 Muschik
E. Massage-apparat, Patentschrift N°17778, 22. September 1898
Schweizeriche Eidgenossenschaft.
307 Muschik
E. Massageapparat. Danskt Patent N°1898. Patent udstedt den
28. Oktober 1898, beskyttet fra den 17 Marts 1899
Page 128
tionné qu’en 1939 dans la presse française. Il a donc été fabriqué, commercialisé
et utilisé en Allemagne pendant une longue période et a même traversé
la Grande
Guerre [Note
CFDRM 14/18] sans encombre.
Figure
115 : Le vibrateur de Muschik dessin
publié dans L’Illustration 28 janvier 1939 
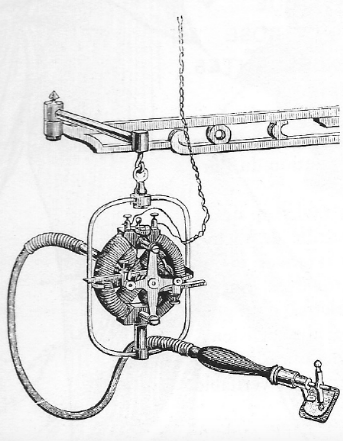
308 Anonyme
Un nouvel appareil pour le massage vibratoire L’Illustration 28
janvier 1939.
Page 129
Il serait possible de faire entrer ces différents
instruments dans l’une ou l’autre des catégories précédentes.
Cependant, un classement indépendant leur est attribué
car leur finalité est spécifique à un organe
ou à une pathologie.
Cet instrument, du catalogue Drapier, présente un double rang de billes striées
« pour tonifier la paroi chez les hernieux qui ont un
travail sédentaire ou une paroi affaiblie » [Fig.116].
Figure 116 : Masseur herniaire
du catalogue Drapier 
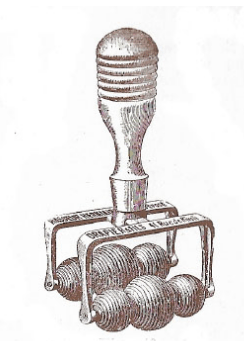
6.3.5.2
Les instruments de massage abdominal
6.3.5.2.1
Les boules de massage abdominal
D’après le catalogue Drapier, Il existe deux types de boules, lisses et striées
et deux types de présentation avec ou sans poignée.
Les boules sans poignée sont destinées plutôt
à l’automassage.
Ce sont des boules creuses en bois. Elles existent en trois diamètres
9, 10.5 et 12cm. À vide, elles pèsent respectivement
0,175, 0,225 et
309 Drapier
Catalogue bandages herniaires, ceintures, bas pour varices, accessoires
Paris : 1911
310 Ibid.
Page 130
0,270g. Elles peuvent être lestées avec de
la grenaille de plomb. La plus petite peut contenir jusqu’à
1kg, la moyenne 1,5kg et la plus grosse 3,370kg. Pour les remplir,
il faut dévisser la vis présente à la surface
de la boule.
Il est précisé que pour son automassage, le patient doit se coucher et faire rouler la boule
sur le ventre dans un mouvement giratoire de bas en haut et de droite
à gauche en commençant par le flanc droit, sens, bien
sûr, du transit intestinal [Fig.117].
Figure 117 : boules
de massage, lisse en haut à gauche et striée en haut
à droite, le bouchon à vis fermant l’orifice de remplissage
par de la grenaille de plomb est visible au pôle supérieur.
En bas, boule striée pleine, non lestable. 

Les boules avec poignée sont utilisées par
le masseur. Elles pèsent à vide 25 à 30g de
plus que celles sans poignée. Elles peuvent contenir le même
poids de grenaille de plomb [Fig.118].
311 Petitdant
B. Des boules de massage. (article in press) Kinesither Rev (2021),
http://dx.doi.org/10.1016/j.kine.2021.02.006
Page 131
Figure 118 : Boule à
poignée lestée de grenaille de plomb, notez la vis
de bois permettant l’accès à la cavité interne
pleine de grenaille de plomb. © Collection de l’auteur 

Reibmayr indique aussi l’existence, mais en la déconseillant,
de la ceinture de massage abdominal du Dr Schaffer. Il s’agit avant tout d’un automassage, plus qu’un instrument utilisé par le masseur. Elle est constituée
de plaques métalliques fixées sur des sangles. Le
déplacement de ces plaques sur la peau, lors des balancements
de la marche, assurait le massage. Le poids des plaques, le serrage important, inévitable,
de la ceinture apportaient surtout de l’inconfort au patient [Fig.119]
312 Reibmayr
A. Die Technik der Massage Leipzig &
Wien : Franz Deuticke ; 1892
Page 132
Figure 119 : La ceinture
de massage abdominal du Docteur Schaffer 
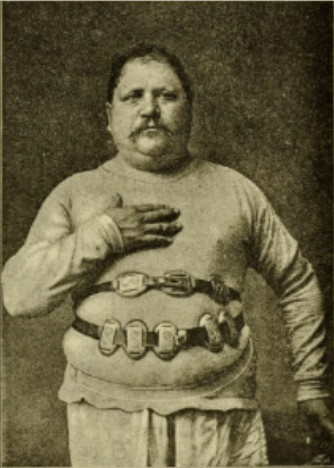
Il s’agit d’instruments déjà rencontrés,
mais adaptés aux doigts par leur taille. Un manche en bois
tourné accueille une boule cannelée [Fig.120].
Figure 120 : Boule de petite
taille adaptée au traitement des doigts 
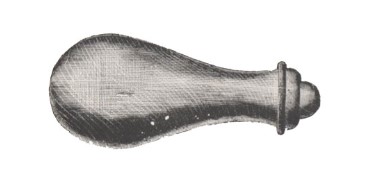
Cet instrument se compose d’une boule pneumatique en caoutchouc
fermée par un manche en os. Il est destiné au massage de l’œil. Il permet
d’exercer une pres-
Page 133
sion régulière, souple, toujours perpendiculaire
à l’axe de l’œil. La boule pneumatique permet cette pression
particulière. Le manche est placé entre l’index et
le majeur avec la pulpe reposant sur la boule. Le pouce est en contre
appui en face [Fig.121]. « Il faut exercer trois ou quatre pressions
se succédant immédiatement sur chaque œil, et d’aller
tour à tour de l’un à l’autre pendant une minute ou
deux. » Il vaut mieux faire trois ou quatre séances par
jour plutôt que de les prolonger.
Figure 121 : L’optogène
et comment le tenir pour l’utiliser 
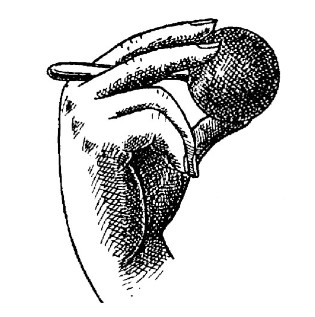
Charles Dion est un ingénieur en électricité
qui a travaillé avec Edison et qui enseigne à l’Institut
ophtalmique de Paris. Il dépose avec Yvan Goubaux un premier
brevet en Suisse en 1896 puis un brevet en 1903 au Royaume Uni et en France en 1904. « Cet appareil se compose essentiellement
d’une tige médiane fixée dans un petit bâti
métallique dans lequel viennent coulisser deux autres tiges
latérales creuses. L’extrémité qui vient s’appuyer
sur l’œil est fermée par un morceau de cristal, matière
313 Anonyme
La médecine qui guérit : les panacées authentiques,
les remèdes infaillibles. Paris : Institut Biothérapic-Alexia
; sd
314 Siffermann
Dr. L’œil humain et ses anomalies fonctionnelles guéries
par le massage avec l’appareil Dion Strasbourg : F. Staat ; 1899
315 Dion
Ch., Goubaux Y. Appareil pour le traitement des altérations
de la vue Brevet N° 13073 - 20 août 1896 Bureau fédéral
de la propriété intellectuelle
316 Dion
Ch. Improvements in apparatus for the massage of the eyes for the
cure of myopy, Patent N°10101, Date of application 4th May.
1903, accepted 18th feb, 1904. Printed for His Majesty Stationery
Office, Love & Malcomson Ltd, 1904
317 Dion
Ch. Système d’appareil perfectionné pour la gymnastique
rationnelle des yeux, pour la guérison de la myopie et les
altérations de la vue Brevet N° 342985 demandé
le 7 mai 1904, délivré le 23 juillet 1904, publié
le 22 septembre 1904. Office National de la Propriété
Industrielle.
Page 134
dure, non élastique, agissant toujours de même.
Ces deux tiges jouissent de deux mouvements l’un d’avant en arrière,
l’autre de latéralité. » [Fig.122] Elles sont déplacées d’avant en arrière
grâce au bouton à vis placé sur la tige médiane.
La pression exercée se lit sur le dynamomètre gradué
en grammes. Le mouvement de latéralité permet d’adapter
l’appareil à la morphologie du patient pour que le cristal
soit toujours en face du globe oculaire. Une plaque vient s’emboîter
sur le nez et deux branches semblables à des branches de
lunettes et des courroies en arrière stabilisent l’appareil.
Le massage, toujours infra-douloureux, dure entre cinq et dix minutes
[Fig.123]. A l’issue du massage le patient reste encore quelques minutes les yeux fermés.
Figure
122 : L’appareil du Dr Dion 
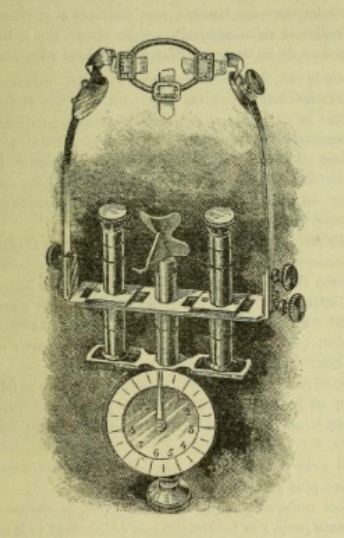
318 Siffermann Dr. L’œil
humain et ses anomalies fonctionnelles guéries par le massage
avec l’appareil Dion Strasbourg : F. Staat ; 1899
Page 135
Figure
123 : Traitement d’un patient 

Leonard Russell Lacy (1876-19??) a déposé
deux brevets d’instruments destinés au massage de l’œil,
en 1930, et 1935. Le second est une amélioration du premier. Il
existait deux méthodes pour réaliser le massage. La première était pneumatique, les œillères
en matériau plastique d’une des extrémités
étaient pressées contre les paupières et des
pompages avec les ampoules en caoutchouc étaient réalisés
[Fig.124]. La deuxième méthode, permise par le second
brevet, consistait à masser les paupières avec l'autre
extrémité de l'appareil. Avec les œillères
pressées contre les paupières. L'utilisateur utilisait
la manivelle pour faire tourner ces œillères [Fig.125]. Dans tous les cas, la stimulation de la circulation
sanguine était évoquée comme mode d’action
sur la vue. Lacy commercialise son appareil par sa société
Neu-Vita, créée en 1929.
319 Lacy L.R. Improved
apparatus for massaging the eyes Patent N° 363101, Application
date, Nov 20th.1930 – Complete left, Aug 20th.1931
– accepted Dec 17th.1931.
His Majesty’s stationery office, Love & Malcomson,
Ltd 1932
320 Lacy L.R. Improved
apparatus for massaging the eyes Patent N° 434927, Application
date, March 26th.1935 – accepted Sept 11th.1935. His Majesty’s stationery office,
Courier Press 1935
Page 136
Figure 124 : Illustration
du premier brevet de l’Oculiser 
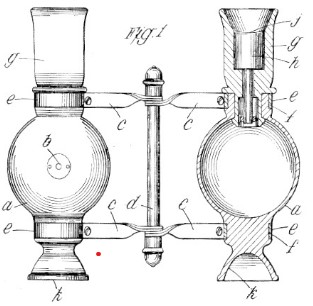
Figure 125 : Illustration
du brevet de l’Oculiser de 1935 avec 3 variantes du mécanisme
de rotation des œillères 
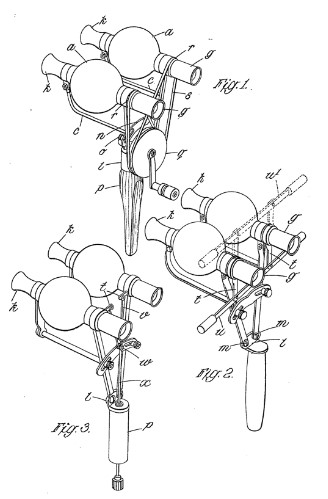
Les instruments dédiés au massage
facial ou face-massage se rencontrent soit comme instruments séparés
soit comme instruments réunis en coffret. Les instruments
individuels sont des adaptations d’instruments destinés à
d’autres régions mais adaptés au visage par une miniaturisation.
Page 137
Ce tampon a la forme d’un petit champignon, fait d’un tissu très
léger et recouvert sur toute sa surface d’une épaisse
couche de gomme électrogène de teinte rouge ambrée. Il peut être utilisé indifféremment
avec la main droite ou de la main gauche, dans l’idéal avec
un dans chaque main. Le masseur saisit le tampon par son col, par une pince tri-digitale. Il imprime au pouce un mouvement de dedans en dehors
produisant un glissement du tampon sur la pulpe des deux autres
doigts, correspondant à une rotation du tampon sur un demi-cercle environ. Le pouce revient
ensuite à sa position de départ, le tampon décrit
une suite de demi-cercle en sens inverse. Le point de contact idéal
du tampon et de la peau est la partie moyenne de la tête du
champignon. Un contact au centre ne provoquerait qu’un effleurage infime, le contact en périphérie des mouvements
de trop grande amplitude [Fig.126].
Figure 126 : Le Tampon-masseur et la manière de s’en servir 

Il s’agit d’une petite cloche de verre à bord lisse
se terminant par un embout. Il s’adapte à un tube flexible
terminé par une poire de caoutchouc. Tout en pressant la poire, la ventouse est appliquée, par exemple, sur les rides du front
[Fig.127]. En relâchant la pression, la raréfaction de l’air aspire et soulève
la peau. Il suffit de serrer à nouveau la poire pour détacher
la ventouse et la manœuvre se répète de place en
321 Peytoureau Dr. Manuel de face-massage Paris : Editions Hygie ; 1936
TDM  [Note CFDRM : l'édition que nous possédons
est celle de 1928 et il semble que ce soit la 1ère] [Note CFDRM : l'édition que nous possédons
est celle de 1928 et il semble que ce soit la 1ère]
322 Ibid.
Page 138
place. Le schéma de l’ensemble poire, tube et ventouse
et la description du mode d’application correspondent au brevet
de Madame Stumm demandé en septembre 1927 .
Figure
127 : La ventouse
de massage facial 
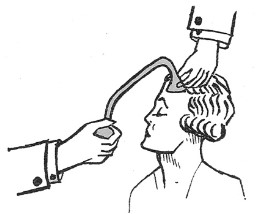
Cette pince se présente comme une pince à disséquer
mais dont les mors ont une forme spécifique et sont recouverts
de longs embouts de caoutchouc. L’autre extrémité se termine par une sphère
métallique. Elle se loge dans le creux de la paume de la
main du masseur. Il est ainsi possible de saisir les téguments
avec les embouts soit par une surface plane, soit concave, soit
convexe soit presque punctiforme et d’exercer une pression en appuyant sur la sphère. Si une action superficielle
est souhaitée, la pince est tenue comme un stylo et la peau légèrement pincée. Pour une action profonde, les mors font une prise large
et la pince, bien empaumée. La main esquisse un mouvement
de pronation ou de supination. Une troisième utilisation est possible, la pince
est tenue latéralement, un mors vient frapper la peau puis avec la force du mouvement l’autre fait
de même par l’intermédiaire du premier. C’est là
une sorte de manœuvre de percussion légère ou tapotement [Fig.128].
Figure
128 : La pince du Docteur Acquaviva


323 Ibid.
324 Stumm
M. Appareil pneumatique pour massage facial Brevet N° 641449
demandé le 3 septembre 1927, délivré le 16
avril 1928, publié le 3 août 1928. Office national
de la propriété industrielle. Imprimerie nationale.
325 Peytoureau Dr. Manuel de face-massage Paris : Editions Hygie ; 1936
TDM 
Page 139
Billes, rouleaux lisses ou crantés, queues de rat lisses ou striées se trouvent réunis en coffret, plus ou moins luxueux,
pour figurer sur la table de toilette de l’élégante
ou de la masseuse d’institut de beauté. Le coffret présenté
est un exemple de l’unité Allemande en devenir, évoquée précédemment
(cf. 4.1.2.) car l’intérieur du couvercle du coffret porte
les armoiries des Grands-Ducs de Mecklembourg et le mot Hoflieferanten
ce qui signifie « fournisseur de la couronne »
sous-entendu des Grands Ducs.
Heinrich
Simons déposa en Suisse, en 1895, quatre brevets pour des instruments de massage
facial. Il dirigeait à Berlin
un institut de massage facial et de soins de beauté (Institut für Gesichtmassage und Schönheitpflege). Il semble qu’il ait eu le
premier l’idée de réunir ces instruments en un seul
coffret à la fin du XIXème siècle, bientôt copié par d’autres. C’est peut-être ce qui a conduit Paul Lehmstedt
à déposer un brevet pour l’ensemble du coffret. Il devait être associé ou successeur d’Heinrich
Simons puisque
le brevet le dit domicilié à l’adresse figurant sur
le coffret présenté [Fig.129].
326 Goetze
M., Simons H. Massageapparat mit versetzt angeorducten cylindrischen
Walzen, Patentschrift N°9924, 28. Januar 1895 Schweizeriche
Eidgenossenschaft.
327 Simons
H. Massageapparat mit cylindrischer Walze, Patentschrift N°10625,
29. Juni 1895 Schweizeriche Eidgenossenschaft.
328 Simons
H. Massageapparat mit kugelförmigen Massagerollen, Patentschrift
N°10626, 29. Juni 1895 Schweizeriche Eidgenossenschaft
329 Simons
H. Mit einem daumenartigen und einem konischen Ende versehene Massagevorrichtung,
Patentschrift N°10702, 29. Juni 1895 Schweizeriche Eidgenossenschaft
330 Petitdant
B. Un coffret d'instruments de massage du XIXe siècle de Heinrich Simons Kinesither Rev 2019;19(206):35-42
331 Bergman
Dr. Le visage et les soins à lui donner Le massage du visage
"Récamier'' d'après le célèbre système
H. Simons, L'art de rajeunir et d'embellir Paris : La parfumerie
"Récamier''; 1900.
332 Lehmstedt
P. Improvements in and relating to massage apparatus Patent N°
6627, date of application, 18th Mar., 1902 – Complete specification
left, 22nd Nov., 1902 – accepted 5th Feb., 1903. His Majesty stationery
office, Love & Malcomson, Ltd 1903
Page 140
Figure
129 : Le coffret Heinrich Simons
de Berlin portant les armoiries des Grands-Ducs de Mecklembourg
et les mentions G.m.b.H. et Hoflieferanten © Collection de
l’auteur  [Note CFDRM : quelques autres exemples de
notre collection [Note CFDRM : quelques autres exemples de
notre collection  ] ]

William Lloyd et Wentworth Loder de Brighton en Angleterre, fabricants d’objets de toilette, déposent le
1er décembre 1906 un brevet pour un petit objet proche du tampon-masseur de Peytoureau (cf 6.3.5.5.1.). La différence se situe au niveau du matériau,
du tissu pour Peytoureau, matière plastique pour le Massager. Le chapeau de ce champignon entre en contact avec la
peau. Il est maintenu entre les doigts par son pied. Au départ
conçu pour maintenir les cheveux, mieux que les doigts ou
une brosse, lors de la coupe, il est devenu, comme son nom commercial
l’indique, un instrument de massage
facial [Fig.130]. Dès sa conception, le chapeau était parfaitement
lisse et légèrement concave, lui permettant d’une
part d’être un excellent ins
333 Lloyd
W., Loder W. An improved shaving appliance Patent N° 27348,
date of application, 1st Dec., 1906 – Complete specification left,
12th Apr., 1907 – accepted 13th June 1907. His Majesty stationery
office, Love & Malcomson, Ltd 1907
334 Peytoureau
Dr. Manuel de face-massage Paris : Editions Hygie ; 1936
Page 141
trument de massage et d’autre part de retenir les onguents utilisés
et de les restituer petit à petit. Quelques mois plus tard, les inventeurs font évoluer l’instrument en transformant
le pied en un cylindre creux. Il communique avec la concavité
du chapeau par un petit pertuis  , permettant de délivrer de l’onguent en continu.
Pour la même finalité, ils proposent une autre option,
creuser une rainure circulaire à la face plane du chapeau
et la faire également communiquer avec la concavité. , permettant de délivrer de l’onguent en continu.
Pour la même finalité, ils proposent une autre option,
creuser une rainure circulaire à la face plane du chapeau
et la faire également communiquer avec la concavité.
Figure 130 : Le Massager, sur le cliché de droite, notez la surface inférieure
légèrement concave
© Collection de l’auteur 
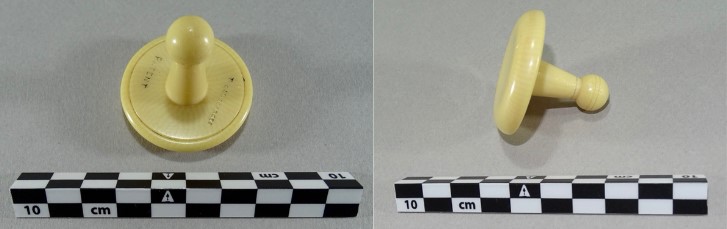
Entre 1910 et le début de Grande
Guerre, les publicités pour le
Vibro-Energos dans les revues allemandes, sont nombreuses et variées.
Tous les instruments de massage, surtout ceux de massage
vibratoire se disent capables de traiter
la calvitie. Le Vibro-Energos est destiné, lui, strictement
au massage des
régions pileuses qu’elles soient couvertes de cheveux, de
barbe ou de moustache [Fig.131].
335 Lloyd
W., Loder W. An improved device for applying preparations to the
skin Patent N° 19350, date of application, 28th Aug., 1907 –
accepted 7th Nov. 1907. His Majesty stationery office, Love &
Malcomson, Ltd 1907
Page 142
Figure 131 : Publicité
pour le Vibro-Energos parue en 1912 
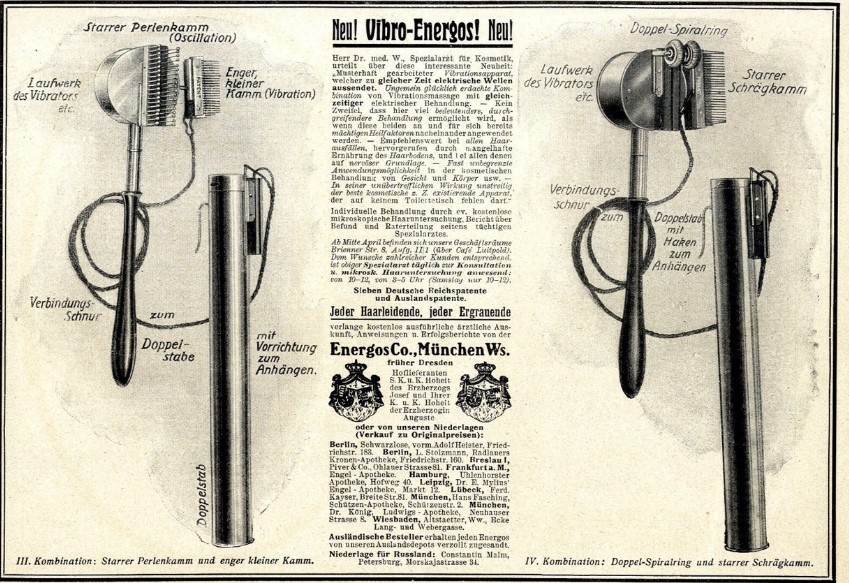
Page 143
Les machines de Zander, sont une réaction à
la gymnastique de Ling. Ces machines avaient pour but de pallier
aux variations liées aux assistants du médecin. En
effet, une machine peut appliquer une résistance identique
indéfiniment pour les appareils actifs ou fournir un mouvement
similaire pour les appareils passifs .
Zander
[Note CFDRM : Gustav (1835-1920)] expérimente ses appareils
de thérapie dans les années 1850. Les résistances
varient en déplaçant des poids le long de bras de
levier. Avec un bras de levier court la résistance est faible
et inversement. Ce système peut s’adapter à la force
de chaque individu, qu’elle soit faible ou normale, et contribuer
à l’augmenter. Si les muscles sont paralysés ou très
faibles des machines motorisées luttent contre l’atrophie.
Les appareils actifs sont actionnés par le patient, les appareils passifs fonctionnent au gaz, à la vapeur ou à l’électricité
alimentant un moteur de 3 à 4 CV339.
Pour Wischnewetzky, c’est un moteur à gaz de 10 CV dont seulement
5 à 6 sont utilisés pour mouvoir 38 appareils, alimenter
un compresseur pour les gaz médicaux, un ascenseur et une
ventilation.
Tous les appareils sont dénommés par un
code de lettre et de chiffres, A pour le membre supérieur
(bras = Arm en suédois), B pour le membre inférieur
(jambe = Ben), etc. Les machines de massage
vibratoire portent la lettre F, celle
assurant le pétrissage la lettre H, celles destinées aux frottements la lettre J.
336 Göranssons
Mekaniska Verkstadt La gymnastique médico-mécanique
de Zander, ses principes, ses applications suivis de quelques indications
sur la création d’établissements gymniques d’après
cette méthode Stockholm : Imprimerie royale, Norstedt et
Söner ; 1896
337 Zander
G. Notice sur la gymnastique de Zander
et l’établissement de gymnastique médicale mécanique
suédoise à Stockholm. Paris, Imprimerie A. Reiff,
1879
338 Guyenot
P.. : La mécanothérapie
à l’institut Zander d’Aix les Bains. Aix les bains :
Imprimerie Gérente ; 1904 TDM  TDM TDM  [Note du CFDRM livret dans lequel il aborde
le massage] [Note du CFDRM livret dans lequel il aborde
le massage]
339 Göranssons
Mekaniska Verkstadt La gymnastique médico-mécanique
de Zander, ses principes, ses
applications
suivis de quelques indications sur la création d’établissements
gymniques d’après cette méthode Stockholm : Imprimerie
royale, Norstedt et Söner ; 1896
340 Wischnewetzky
L. The mechanico-therapeutic institute. Contributions to mechanico-therapeutics
and orthopedics Vol 1, N°1, New-York : Mechanico-therapeutic
and orthopedic Zander ; 1891
Page 144
6.3.6.1.1.1 Vibrations des différentes parties
du corps F1 
Dénommé également « Grand
vibrateur », cet appareil « communique aux
membres inférieurs des vibrations d’intensité graduée, mais de fréquence
toujours identique. Le malade est assis sur une chaise, et place
soit ses talons, soit ses mollets, sur la banquette horizontale
de l’appareil [Fig.132]. On peut aussi, en articulant sur l’arbre vertical situé
à l’extrémité gauche de la banquette des branches
horizontales terminées par des tampons, des pelotes ou des
croissants, procéder au massage
vibratoire de l’estomac, de l’intestin,
du cœur, des troncs nerveux ou des membres. Pour la face, on utilise
des poires en caoutchouc creux. Si on veut, avec cet appareil, procéder
à la vibration totale du corps, le malade s’assoit sur la
banquette … ». Pour Régnier, la fréquence des vibrations est de 300 par minute
et de 900 pour Fallen.
Figure 132 : Le grand vibrateur 
[Note CFDRM : l'auteur nous rappelle
que la lettre F correspond aux appareils de massages vibratoires]
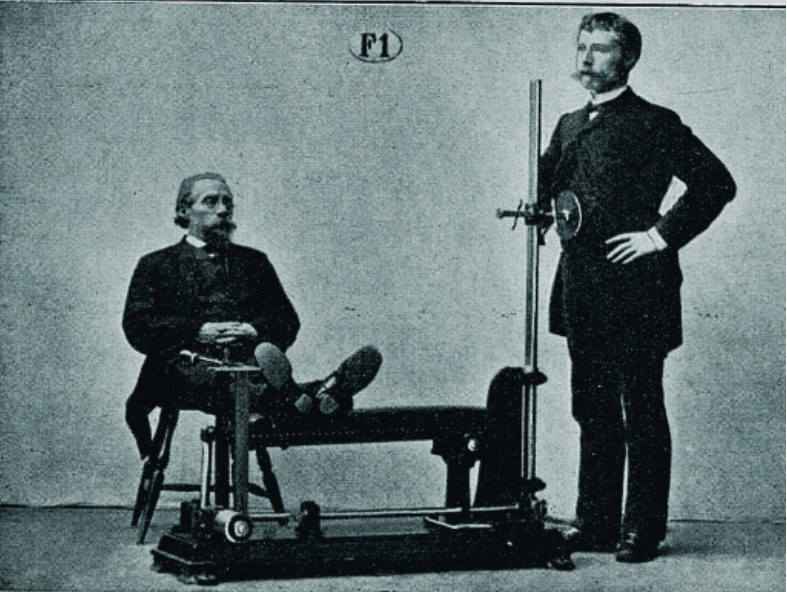
341 Régnier
L.R. La Mécanothérapie,
application du mouvement à la cure des maladies, J.P. Baillière
;1901 ParisTDM 
342 Ibid.
343 Fallen
C. : The Zander institute for mechanico-therapeutics or swedish
movements and massage by machinery. New-York : circa 1890
Page 145
« Cet appareil communique au corps un mouvement
vertical moins rapide et plus étendu que le précédent ». Pour Fallen, les réglages permettent d’aller d’une vibration
douce aux sensations d’un trot vigoureux [Fig.133].
Figure
133 : Machine F2 pour vibration du
corps entier comme en équitation 
[Note CFDRM : l'auteur nous rappelle
que la lettre F correspond aux appareils de massages vibratoires]

344 Régnier
L.R. La Mécanothérapie,
application du mouvement à la cure des maladies, J.P. Baillière
;1901 ParisTDM 
345 Fallen
C. : The Zander institute for mechanico-therapeutics or swedish
movements and massage by machinery. New-York : circa 1890
Page 146
6.3.6.1.2.1 Percussions du tronc et des bras (grandeur
1) G1
Les percussions sont réalisées par des boucles de caoutchouc. Pour Régnier, « en même temps qu’elles accomplissent
une série de mouvements comparables à ceux des marteaux
de piano qui frappent les cordes, (elles) se déplacent automatiquement
de haut en bas, allant de la nuque au sacrum. » [Fig.134].
Figure
134 : Percussions du tronc 
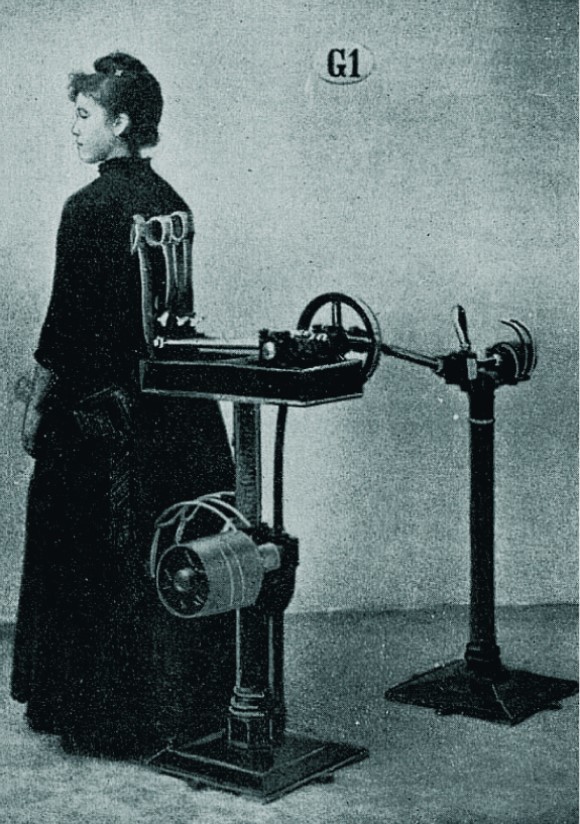
346 Régnier
L.R. La Mécanothérapie,
application du mouvement à la cure des maladies, J.P. Baillière
;1901 ParisTDM 
Page 147
Figure 135 : Percussions
du membre inférieur 
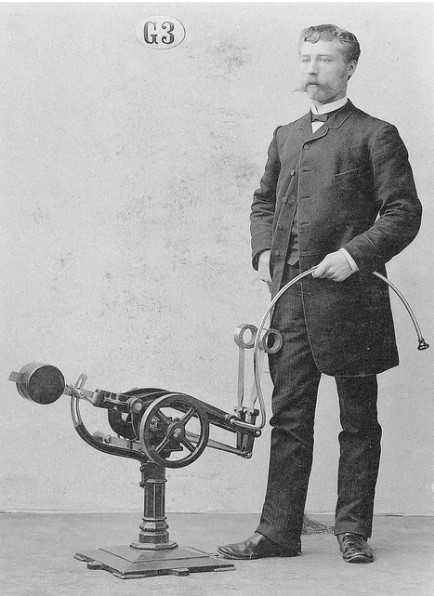
6.3.1.2.2 Percussions du membre inférieur G3
Les mêmes boucles de caoutchouc sont utilisées
pour cet appareil. Ici, le déplacement est assuré
par le patient à l’aide d’une grande poignée en arc
de cercle tenue dans la main. [Fig.135].
6.3.6.1.2.3 Percussions du
tronc et des bras (grandeur II) G4
Les descriptions, , , des machines de Gustav
Zander (1835-1920) citent
une machine G4 pour la percussion du tronc et des bras de grandeur II.
« Grandeur II » doit signifier que la machine
agit avec plus de vigueur mais aucune iconographie n’a été
découverte.
347 Göranssons
Mekaniska Verkstadt La gymnastique médico-mécanique
de Zander, ses principes, ses applications suivis de quelques indications
sur la création d’établissements gymniques d’après
cette méthode Stockholm : Imprimerie royale, Norstedt et
Söner ; 1896
348 Zander
G. Notice sur la gymnastique de Zander
et l’établissement de gymnastique médicale mécanique
suédoise à Stockholm. Paris : Imprimerie A. Reiff
; 1879
349 Guyenot
P.. : La mécanothérapie
à l’institut Zander d’Aix les Bains. Aix les bains :
Imprimerie Gérente ; 1904 TDM  TDM TDM  [Note du CFDRM livret dans lequel il aborde
le massage] [Note du CFDRM livret dans lequel il aborde
le massage]
350 Wischnewetzky
L. The mechanico-therapeutic institute. Contributions to mechanico-therapeutics
and orthopedics Vol 1, N°1, New-York : Mechanico-therapeutic
and orthopedic Zander ; 1891
351 Petitdant
B. Les appareils de mécanothérapie de Zander Clystère
2015 ; 36 : 13-33
Page 148
Partie en travaux, la suite est écrite mais reste tout le travail
de mise en liens.
– Bernard
Petitdant le cite dans Massage
manuel et instrumental en Europe du début du XIXème
siècle à l’entre-deux-guerres,
2021 TDM  (p.148) (p.148)
6.3.6.1.2.4 Percussions de la tête G5 
L’appareil G5 est tout aussi mystérieux, il reste
aussi sans illustration .
Cette machine porte la lettre de référence
H
6.3.6.1.3.1 Pétrissage de l’abdomen H1 
« Le malade est couché sur une banquette
mobile de façon que la région épigastrique
et la partie médiane du ventre entre en contact avec une
série de cinq roulettes en bois animées d’un mouvement
de haut en bas. Pour que le pétrissage porte successivement sur l’hypocondre et l’épigastre, le
cadre de la planchette, sur laquelle est couché le malade,
exécute un va-et-vient qui promène le ventre sur les
roulettes » [Fig.136].
Figure 136 : Machine H1
assurant le pétrissage de l’abdomen 
[Note CFDRM : l'auteur nous rappelle
que la lettre H correspond aux appareils pratiquants des
pétrissages]
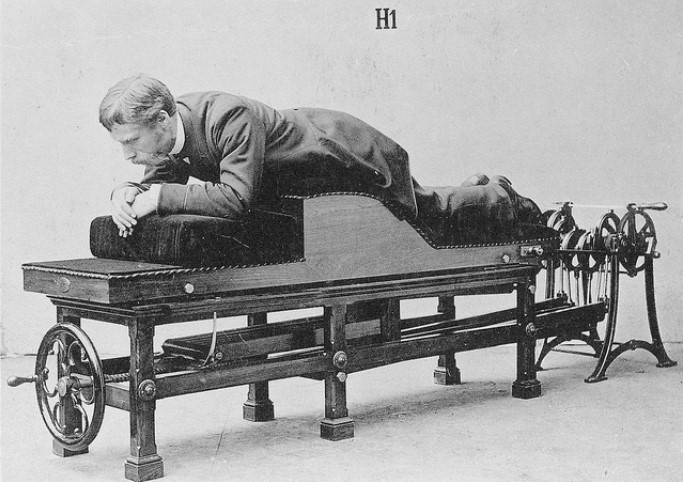
352 Ibid.
353 Régnier
L.R.: La Mécanothérapie, application du mouvement
à la cure des maladies. Paris : J.P. Baillière ; 1901
Page 149
Ces machines sont référencées par
la lettre J. Elles sont au nombre de six.
6.3.6.1.4.1 Frottements des bras J1
« Deux courroies verticales et parallèles,
présentant sur celles de leurs surfaces qui se regardent
une série de renflements réguliers, sont animées
d’un mouvement de va-et-vient en sens inverse. Le malade introduit
son membre supérieur entre les deux courroies en mouvement
et l’y pousse du poignet à l’épaule et vice versa
en soutenant sa main sur une barre horizontale et mobile qui guide
ses mouvements. » [Fig.137].
Figure 137 : Machine assurant
le frottement du membre supérieur 
[Note CFDRM : l'auteur nous rappelle
que la lettre J correspond aux appareils pratiquants des
frottements]
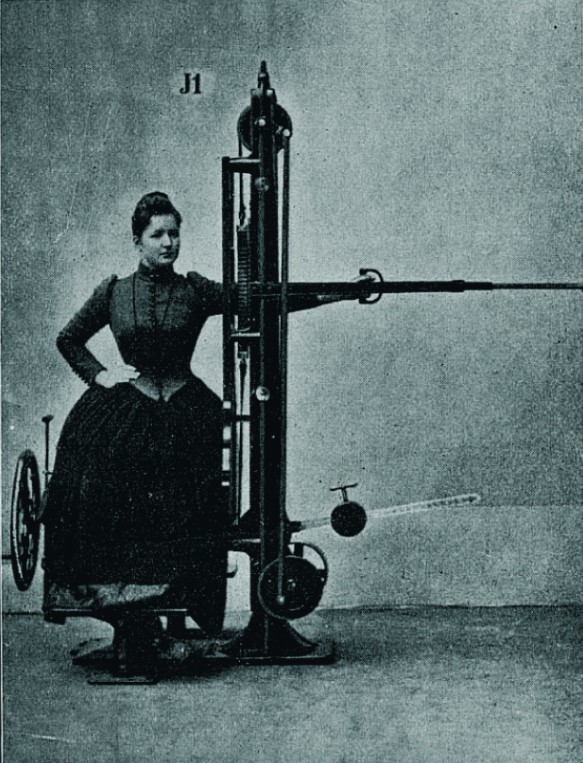
354 Ibid.
Page 150
« L’appareil utilisé pour les doigts
est construit d’une façon analogue » au précédent.
Pour les membres inférieurs, « les courroies
sont remplacées par des lames horizontales à saillies
régulièrement espacées et qui s’écartent
en faisant ressort sur la jambe qu’on place entre elles. Elles exécutent,
comme les courroies, un mouvement de va-et-vient » [Fig.138].
Figure 138 : Machine assurant
les frottements du membre inférieur 
[Note CFDRM : l'auteur nous rappelle
que la lettre J correspond aux appareils pratiquants des
frottements]
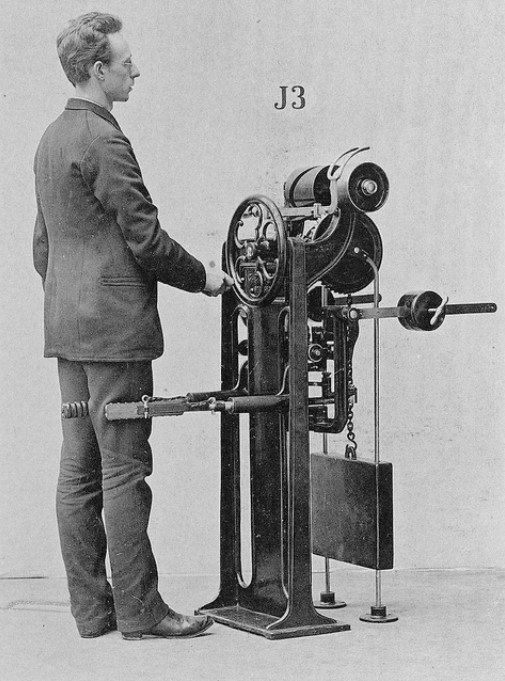
355 Ibid.
356 Ibid.
Page 151
6.3.1.4.4 Frottements des pieds J4
Pour la friction de la plante des pieds, « la partie active
est constituée par un gros cylindre dont la surface est revêtue
de saillies parallèles à son grand axe. Le malade
applique ses pieds sur le cylindre de façon que leur axe
soit perpendiculaire à celui du cylindre » [Fig.139].
Figure
139 : Frottements des pieds 
[Note CFDRM : l'auteur nous rappelle
que la lettre J correspond aux appareils pratiquants des
frottements]

6.3.1.4.5 Frottements du dos J5
Le patient s’allonge sur une « sorte de chaise
longue percée en son centre d’une ouverture et mobile sur
des rails. Dans l’ouverture tourne une roue capitonnée sur
laquelle la région lombo-dorsale du malade est promenée
par le déplacement de la chaise longue. » Pour tous ces appareils, l’intensité de la friction est réglée
par un contrepoids [Fig.140].
357 Ibid.
358 Ibid.
Page 152
Figure
140 : Machine pour le frottement du dos 
[Note CFDRM : l'auteur nous rappelle que la
lettre J correspond aux appareils pratiquants des frottements]
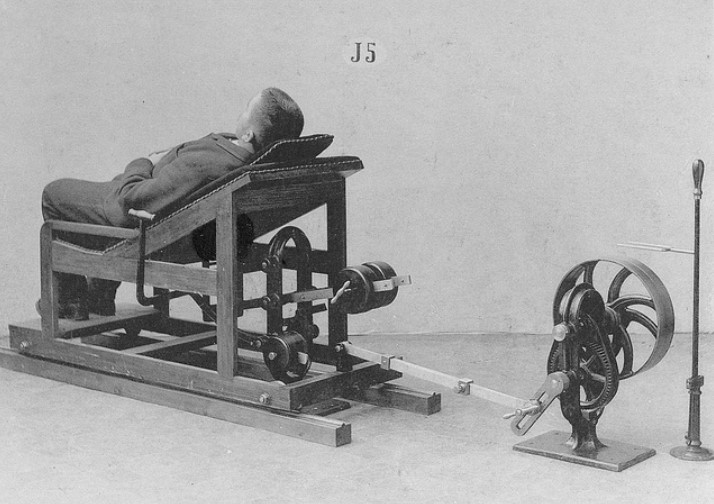
6.6.1.4.6 Frottements circulaires de l’abdomen J6
« Deux pelotes montées sur une tige
animée d’un mouvement circulaire » servent « à
la friction de l’abdomen et imitent le mouvement manuel des masseurs ». L’intensité de la friction est réglée par le rapprochement plus ou
moins intime du corps et de l’appareil [Fig.141].
359 Ibid.
Page 153
Figure 141 : Machine assurant
des frottements circulaires de l’abdomen 
[Note CFDRM : l'auteur nous rappelle
que la lettre J correspond aux appareils pratiquants des
frottements]
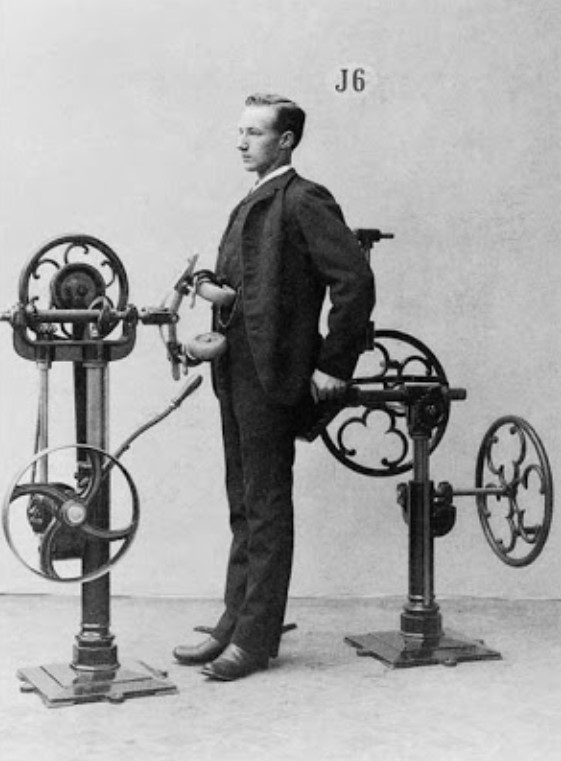
Le catalogue Dupont montre un « fauteuil trépidant » [Fig.142] inspiré, indubitablement, de celui de Charcot. Il est préconisé pour la maladie de Parkinson
mais il pourrait s’appliquer pour des vibrations de tout le corps comme l’appareil F2 de Zander (cf. ).
360 Dupont
Lits, fauteuils, voitures et appareils mécaniques pour malades
et bléssés. Harambat : Paris ; circa 1925
361 Gilles
de La Tourette G. Considérations sur la médecine vibratoire,
ses applications et sa technique Nouvelle Iconographie de la Salpêtrière
1892 ; 5 : 265-75
Page 154
Figure 142 : Fauteuil trépidant
de la Société Dupont 
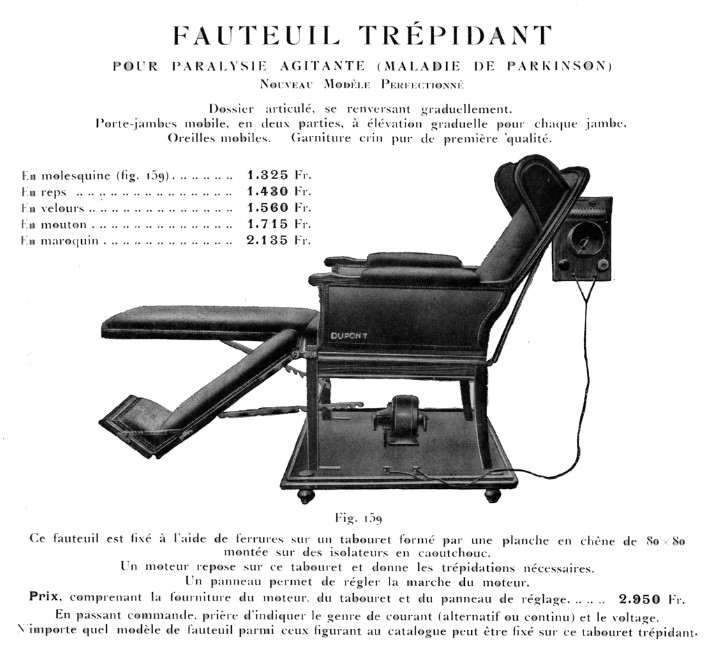
Le succès des machines de Zander a conduit des fabricants à proposer un appareillage
moins encombrant pour les cabinets ou les instituts de petite taille.
La partie destinée au patient semble cossue. La machinerie
est-elle apparente pour les besoins de la photo ou pour impressionner
le patient ? [Fig.143].
Page 155
Figure 143 : Carte postale
ancienne montrant un Fibrationbett à droite et sa machinerie
dénommée Fibrationapparat à gauche 
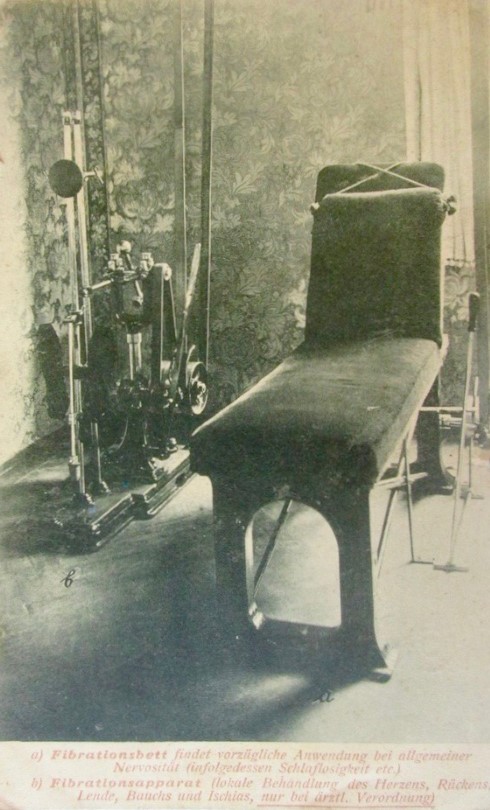
Un moteur électrique fait tourner deux roues, de
part et d’autre de ce moteur, où s’accroche une sangle. Le
point d’accrochage sur la roue est excentré en périphérie
provoquant des va-et-vient de la sangle de peu d’amplitude mais
de fréquence plus ou moins importante. Le patient est à
l’intérieur de la boucle de la sangle et en léger
déséquilibre avant ou arrière pour la mettre
en tension. En raison de la hauteur du sup-
Page 156
port du moteur, les régions abdominale et fessière
sont essentiellement soumises à l’action de la machine. Une
télécommande filaire permet d’ajuster la rotation
du moteur donc la fréquence des va-et-vient de la sangle
[Fig.144, 145 et 146].
Figure 144 : Publicité
allemande pour une machine à sangle 
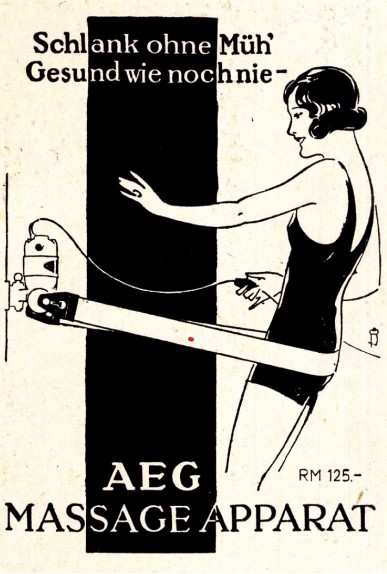
Figure 145 : Publicité
pour une machine à sangle 
parue dans la revue L’illustration en novembre 1932
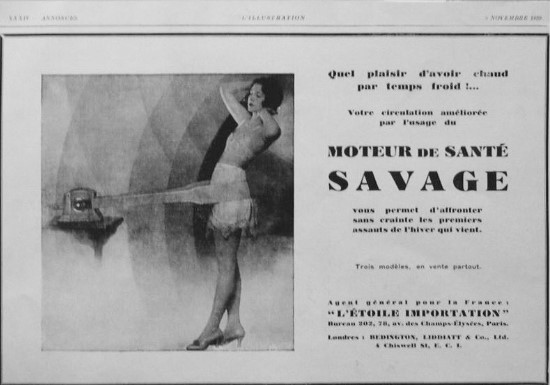
Page 157
Figure 146 : Publicité
montrant un usage au niveau de la ceinture scapulaire
parue dans la revue L’illustration du 8 juin 1939 
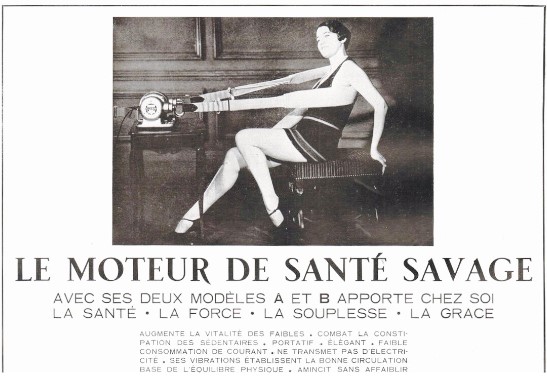
Page 158
Conclusion 
Ce
travail est ouvert, bien sûr, à la réfutabilité
(falsifiabilité) poppérienne  . Cependant,
il semble être le premier à recenser les instruments
de massage tout en les classant. Ce classement a pris en compte
non seulement les manœuvres suppléées par ces appareils,
mais surtout leurs caractéristiques techniques. Cette approche
originale permet de mieux appréhender l’instrument lui-même. . Cependant,
il semble être le premier à recenser les instruments
de massage tout en les classant. Ce classement a pris en compte
non seulement les manœuvres suppléées par ces appareils,
mais surtout leurs caractéristiques techniques. Cette approche
originale permet de mieux appréhender l’instrument lui-même.
Pour notre recherche, nous avons systématiquement
privilégié la documentation ancienne, les brevets
d’invention, les publications d’époque, édités
au cours de la période étudiée. C’est, pour
nous, une source plus fiable même si elle est plus difficile
d’accès. Les publications récentes sont à utiliser
avec plus de précautions, car elles peuvent contenir des
erreurs, mais elles permettent des études transversales.
L’utilisation des brevets d’invention permet de neutraliser les
erreurs significatives de datation. Ce procédé évite
également les usurpations, permet de corriger des attributions
erronées donc de rendre à l’inventeur sa création.
Certains de ces appareils, à leur époque
déjà, ont été considérés
comme du matériel de charlatan. Leurs promoteurs les présentaient comme la panacée
et non comme ce qu’ils étaient réellement, un outil
facilitant le travail du masseur.
Une partie des instruments classés dans les instruments
simples, dans les instruments élaborés ou les instruments
dédiés se retrouve toujours de nos jours. Les matières
plastiques ont remplacé, un temps, le bois et les fibres
végétales pour les appareils bon marché. Même
si ces derniers existent toujours, l’écologie a conduit à
une réapparition des matériaux naturels. Il faut cependant
rester prudent. Les règles d’hygiène avaient fait
disparaître les instruments en bois, par exemple. Si leur
usage n’est pas strictement individuel, inévitablement, le
risque de transmission microbienne, virale, mycosique réapparaît.
La désinfection des autres matériaux doit cependant
être rigoureuse.
Les héritiers des médecins-masseurs, des masseurs
médicaux sont, bien sûr,
les masseurs-kinésithérapeutes. La profession a été créée
par la loi n°
46.857 du 30 avril
Page 159
1946 . Des entreprises sont apparues pour fournir à
ces nouveaux professionnels des matériels spécifiques
adaptés à leurs compétences.
Parallèlement à ces instruments professionnels
destinés à un usage intensif, vont apparaître
des appareils vibratoires destinés aux particuliers. Ce sont
les années 1960, 1970 et 1980 qui voient surtout cette prolifération.
Un « effet de mode » préside toujours
à l’apparition de nombreux instruments, aux différences
minimes, sur une courte période.
Figure 147 : Le Concentra,
instrument fabriqué en RFA © Collection de l’auteur


Figure 148 : Le Massinet
Type 2, instrument fabriqué en RDA © Collection de l’auteur


362 Loi
n°46-857 du 30 avril 1946 Réglementation des professions
de masseur
gymnaste médical, de masseur
kinésithérapeute et de pédicure Journal officiel
de la République Française 1 mai 1946 p 3653
363 Macron
A. La profession de masseur-kinésithérapeute instituée
par la loi n°46-857 du 30 avril 1946 genèse et évolutions
d’une profession de santé réglementée. Thèse
Faculté de Droit, Université de Montpellier 2015
Page 160
Même si le matériau diffère, les concusseurs
sont identiques, par leur forme et leur variété, à
ceux de la période étudiée. Si nous devions
ajouter une catégorie pour classer ces productions nouvelles,
nous créerions les « instruments à usage
domestique ». Ils sont nombreux. Leur nom et leurs formes
les distinguent. Les particularités géopolitiques
de l’Europe n’influencent pas leur commercialisation. Ils se rencontrent,
en effet, de chaque côté du Rideau de Fer [Fig.147, 148, 149 et 150].
Figure
149 : Instrument fabriqué
en URSS © Collection de l’auteur 
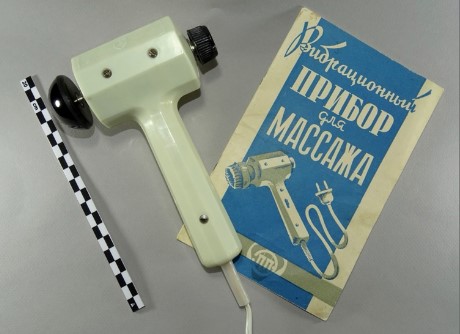
Figure 150 : Le Relax fabriqué
en Suède © Collection de l’auteur 

La classification proposée permet aussi d’intégrer
les instruments de massage les plus récents du masseur-kinésithérapeute.
Elle n’est donc pas réservée aux instruments plus
ou moins anciens.
Page 161
En utilisant la classification proposée un travail
de plus grande envergure pourrait tenter de recenser la production
européenne et américaine d’instruments de massage,
de la fin du XIXème siècle à nos jours.
Table des illustrations
Figure
1 : La Turnerkreuz ...................................................................................................... 22
Figure
2 : Rebouteux breton massant une cheville
« foulée » ............................................. 26
Figure
3 : Médaille commémorative du centenaire de l’EFOM ............................................ 30
Figure
4 : Diplôme d’Infirmière-Masseuse de l’EFOM de 1932 ........................................... 31
Figure
5 : Schématisation des pôles
d’intérêts de la SDK à sa création et leurs animateurs d’après Monet .... 32
Figure
6 : Portrait de Pehr Henrik Ling ................................................................................. 36
Figure
7 : Portait de Gustav Zander ...................................................................................... 39
Figure
8 : Portrait de Johann Georg Mezger......................................................................... 42
Figure
9 : Plaque commémorative apposée
sur un mur de la piscine de l’hôtel Amstel...... 43
Figure
10 : Massage podal d’après une
édition de 1595 du Canon d’Avicenne ................... 45
Figure
11 : Carte postale ancienne de Géorgie
montrant un massage podal ...................... 46
Figure
12 : Ce n’est pas un supplice mais un
traitement par massage podal en Ouganda .. 47
Figure
13 : Carte postale ancienne montrant
l’installation nécessaire pour amener l’eau
thermale d’Aix les Bains dans la salle de douche-massage .................................................. 57
Figure
14 : Carte postale ancienne montrant
bien qu’en hydrothérapie, balnéothérapie ou
crénothérapie, le massage
reste un massage standard ....................................................... 58
Figure
15 : Les instruments de l’Admiral Henry ................................................................... 59
Figure
16 : Les instruments de l’Admiral Henry ................................................................... 60
Figure
17 : Gant de crin double tricotage,
à gauche et gant de laine à droite ..................... 61
Figure
18 : Gant brosse sans pouce du catalogue
Natton .................................................... 61
Figure
19 : Le strigile illustrant le livre
de G. du Choul ......................................................... 62
Figure
20 : Les rouleaux de Flashar, à
gauche le grand, à droite le petit ............................. 62
Figure
21 : La roulette du Dr Boyer ...................................................................................... 63
Figure
22 : Battoir musculaire de bois monoxyle ................................................................. 64
Figure
23 : Le Massagebett du Pr Zablukovski...................................................................... 66
Figure
24 : Le Massagebock et un exemple d’utilisation ..................................................... 66
Figure
25 : Le « Masso-lit » du Dr Weber ............................................................................. 67
Figure
26 : La table de massage du Docteur
Krafft ............................................................... 67
Figure
27 : Lanière de massage d’après
le catalogue Drapier .............................................. 68
Figure
28 : Le Rückenreiber ou lanière
de massage ............................................................. 69
Figure
29 : Battoir musculaire de caoutchouc ...................................................................... 69
Figure
30 : Le marteau de Klemm......................................................................................... 70
Figure
31 : Le marteau de Flashar, fabriqué
par Rudolf Détert à Berlin ............................... 70
Figure
32 : En haut, la boule du marteau est en caoutchouc, en
bas, la tête est faite d’un
matériau dur recouvert de
caoutchouc................................................................................ 71
Figure
33 : Le réveille-muscle ou frappeur du catalogue Drapier
de 1911........................... 71
Figure
34 : Le percuteur de Klemm ...................................................................................... 72
Figure
35 : Patient utilisant le percuteur
de Klemm ............................................................. 72
Figure
36 : Les quatre régions du « pommelling hammer » ................................................. 73
Figure
37 : Le Pulsator du Docteur Gower............................................................................ 73
Figure
38 : Le doigtier du Docteur Krügkula ......................................................................... 74
Figure
39 : Le croissant de Flashar........................................................................................ 74
163
Figure
40 : Les différents éléments
d’une boule de massage démontable .......................... 75
Figure
41 : Boule de bois lisse non démontable .................................................................. 76
Figure
42 : À gauche, rouleau ondé
a une branche sur poignée, ......................................... 76
Figure
43 : Rouleaux parallèles à
cylindres striés à gauche, à boules cannelées
à droite .... 77
Figure
44 : Rouleau à cannelures du
catalogue Natton ........................................................ 77
Figure
45 : Un exemple de rouleau caoutchouc
de la gamme Punkt-Roller ....................... 78
Figure
46 : L’estampille de Punkt Roller ............................................................................... 78
Figure
47 : Publicité pour le Radio-Masseur, rouleau chauffant parue ................................ 79
Figure
48 : À gauche, rouleau de Mager, à
droite, rouleau d’Heinrich ................................ 79
Figure
49 : Le rouleau de L.R. Lacy commercialisé
par Neu-Vita .......................................... 80
Figure
50 : Lanière à boules
de la Parfumerie Récamier ...................................................... 81
Figure
52 : Lanière à boules
à poignées amovibles servant elles-mêmes de masseurs à
boules lisses .... 81
Figure
53 A & 53
B : Lanière à boules
du catalogue Drapier ...................................................... 82
Figure
54 : Le Roléo, instrument à
boules des plus simples ................................................ 83
Figure
55 : Luxueux instrument à boules
en boitier d’acajou .............................................. 84
Figure
56 : Le Thermoroller Protos Siemens
ouvert pour être branché, .............................. 84
Figure
57 : À gauche, le Thermoroller fermé
pour être utilisé, à droite, gros plan de la
tête à boules ... 85
Figure
58 : L’appareil de Semerak ....................................................................................... 86
Figure
59 : L’appareil de Semerak, face inférieure ............................................................... 86
Figure
60 : L’Élastoma .......................................................................................................... 87
Figure
61 : Le rouleau de Butler .......................................................................................... 88
Figure
62 : L’Elektroller ........................................................................................................ 89
Figure
63 : La couronne solidaire de la roue
entraine l’engrenage à l’extrémité de l’axe ... 89
Figure
64 : Les différents éléments
cachés à l’intérieur de la poignée
cylindrique de
l’appareil ............................................................................................................................... 90
Figure
65 : Le Vigorator ........................................................................................................ 91
Figure
66 : Le Zodiac, Illustration d’une publicité ................................................................. 92
Figure
67 : Le cylindre de Stein ............................................................................................. 93
Figure
68 : Le régénérateur
organique électromagnétique « SANITAS » du Dr Pion ........... 93
Figure
69 : Vue inférieure, entre les
deux électrodes annelées servant à
rouler sur la peau
se trouvent les aimants ....................................................................................................... 94
Figure
70 : Le Vibrostat, vue d’ensemble ............................................................................ 96
Figure
71 : Illustration du brevet de Stanislas
Sachs permettant de visualiser le
fonctionnement .................................................................................................................... 97
Figure
72 : Pulsoconn de la première
génération, fin du XIXème siècle .............................. 98
Figure
73 : Le Pulsoconn du docteur Macaura
conforme au brevet français ....................... 99
Figure
74 : Le Veedee et trois de ses concusseurs ............................................................. 100
Figure
75 : Gros plan du disque distal gradué
du Veedee sans sa fixation ......................... 100
Figure
76 : Gros plan du réglage à
l’aide du bord de la rondelle sur les graduations......... 101
Figure
77 : Les concusseurs se fixent dans
les emplacements prévus immédiatement avant
le disque ............................................................................................................................. 101
Figure
78 : Le Manipulse et un concusseur de
caoutchouc en cloche................................ 102
164
Figure
79 : L’extrémité inférieure
du Manipulse. Lorsque le concusseur vissé au centre est
retiré les masselottes coulissant
sur leur pied de biche entrent en contact avec la peau. 103
Figure
80 : Le New American Vibrator, avec
trois concusseurs dont un installé à 45°....... 104
Figure
81 : Le bouton de réglage du
New American Vibrator ............................................ 104
Figure
82 : Le vibrateur de Marfort .................................................................................... 105
Figure
83 : Le Vibrationsapparate du Pr. Zabludovski
à moteur à main fixé sur table ....... 106
Figure
84 : Le « Concussor » du Docteur Ewer ................................................................... 106
Figure
85 : Encart publicitaire pour l’Esthética ................................................................... 107
Figure
86 : Illustration d’une publicité ....................................................................................... 109
Figure
87 : Publicité pour le Fageko
parue dans la revue Woche de mars 1921 ................ 110
Figure
88 : Le Taifun présenté à
la foire de Leipzig en 1928 .............................................. 110
Figure
89 : Illustration du brevet d’Amable
Duplaix .......................................................... 111
Figure
90 : La publicité décriée
de l’American vibrator ...................................................... 112
Figure
91 : Le Clock-percuteur dans sa version à
ressort. .................................................. 114
Figure
92 : Dernière génération
du Clock-percuteur fabriqué par Weiss
& Sons .............. 114
Figure
93 : Les différents concusseurs
de Mortimer-Granville........................................... 115
Figure
94 : La longue tige des concusseurs
permet un traitement dans l’eau sans dommage
pour l’instrument ............................................................................................................... 115
Figure
95 : Vibrateur à dynamo .......................................................................................... 116
Figure
96 : L’appareil de type A .......................................................................................... 117
Figure
97 : L’appareil de type B ......................................................................................... 118
Figure
98 : Publicité pour le Simo-Vibrator, modèle Berlin, d’Heinrich
Simons ................. 118
Figure
99 : L’appareil produit par Rupalley
et Cie .............................................................. 119
Figure
100 : Les éléments du cône ..................................................................................... 120
Figure
101 : Ensemble de publicité au
format timbre-poste courante en Allemagne ....... 120
Figure
102 : Le moteur entraîne un flexible
qui fait tourner un excentrique ..................... 121
Figure
103 : Un vibrateur électrique
simplifié utilisé à l’Établissement
thermal de Spa .... 122
Figure
104 : Le Vibrateur Power vendu par Stanley
Cox Ltd .............................................. 122
Figure
105 : Le tabouret, le flexible et le Trémolo
suspendu à droite ................................ 123
Figure
106 : Concusseur à disque pneumatique pour le tronc ........................................... 123
Figure
107 : Concusseur à plateau et
son support à cardan pour la région précordiale .... 124
Figure
108 : Concusseur d’ébonite en
V pour le pharynx ................................................... 124
Figure
109 : Concusseur à double rouleau
en ébonite caoutchoutée ................................ 124
Figure
110 : Concusseur dit « Le Frontal » à lame souple .................................................. 125
Figure
111 : Exemple de concusseur rond .......................................................................... 125
Figure
112 : Le Pr Zabludovski est représenté
utilisant son appareil de massage vibratoire
électrique fonctionnant avec
un accumulateur ................................................................. 126
Figure
113 : Le Dr Pierre Kouindjy appliquant
des percussions.......................................... 126
Figure
114 : « Humanisation » des vibrations réalisées
par le Dr Pierre Kouindjy ............. 127
Figure
115 : Le vibrateur de Muschik dessin
publié dans L’Illustration 28 janvier 1939 .... 128
Figure
116 : Masseur herniaire du catalogue
Drapier ........................................................ 129
Figure
117 : Boules de massage ......................................................................................... 130
Figure
118 : Boule à poignée lestée
de grenaille de plomb................................................ 131
Figure
119 : La ceinture de massage abdominal
du Docteur Schaffer ............................... 132
Figure
120 : Boule de petite taille adaptée au
traitement des doigts ................................ 132
Figure
121 : L’optogène et comment le
tenir pour l’utiliser............................................... 133
Figure
122 : L’appareil du Dr Dion ...................................................................................... 134
165
Figure
123 : Traitement d’un patient ................................................................................. 135
Figure
124 : Illustration du premier brevet
de l’Oculiser ................................................... 136
Figure
125 : Illustration du brevet de l’Oculiser
de 1935 avec 3 variantes ........................ 136
Figure
126 : Le Tampon-masseur et la manière de s’en
servir ........................................... 137
Figure
127 : La ventouse de massage facial ....................................................................... 138
Figure
128 : La pince du Docteur Acquaviva....................................................................... 138
Figure
129 : Le coffret Heinrich Simons de Berlin
portant les armoiries des Grands-Ducs de
Mecklembourg et les mentions G.m.b.H.
et Hoflieferanten ............................................. 140
Figure 130 : Le Massager .................................................................................................... 141
Figure
131 : Publicité pour le Vibro-Energos parue en 1912 .............................................. 142
Figure
132 : Le grand vibrateur .......................................................................................... 144
Figure
133 : Machine F2 pour vibration du corps
entier comme en équitation................. 145
Figure
134 : Percussions du tronc....................................................................................... 146
Figure
135 : Percussions du membre inférieur................................................................... 147
Figure
136 : Machine H1 assurant le pétrissage
de l’abdomen .......................................... 148
Figure
137 : Machine assurant le frottement du
membre supérieur ................................. 149
Figure
138 : Machine assurant les frottements
du membre inférieur ............................... 150
Figure
139 : Frottements des pieds .................................................................................... 151
Figure
140 : Machine pour le frottement du dos ............................................................... 152
Figure
141 : Machine assurant des frottements
circulaires de l’abdomen ........................ 153
Figure
142 : Fauteuil trépidant de la
Société Dupont ......................................................... 154
Figure
143 : Carte postale ancienne montrant
un Fibrationbett à droite et sa machinerie
dénommée Fibrationapparat à gauche .............................................................................. 155
Figure
144 : Publicité allemande pour
une machine à sangle ............................................ 156
Figure
145 : Publicité pour une machine
à sangle .............................................................. 156
Figure
146 : Publicité montrant un usage
au niveau de la ceinture scapulaire .................. 157
Figure
147 : Le Concentra, instrument fabriqué
en RFA .................................................... 159
Figure
148 : Le Massinet Type 2, instrument
fabriqué en RDA ......................................... 159
Figure
149 : Instrument fabriqué en URSS ......................................................................... 160
Figure
150 : Le Relax fabriqué en Suède ............................................................................ 160
Table des tableaux
Tableau I : Les manœuvres de massage d’après
Estradère.....................49
Tableau II : Les manœuvres de massage d’après
Berne.........................53
Bibliographie
Abu ‘Ali al-Husayn ibn ‘Abd Allah ibn Sina dit Avicenne
Avicennæ Arabum Médicorum Principis Canon Medicinæ,
d’après la traduction latine de Gérard de Crémone
Venise : Juntas ; 1595
Amar J. Principes de rééducation fonctionnelle
Académie des sciences séance du 19 avril 1915 CR hebdo
Sciences 1915 ; 160 : 559-62
Amiot J. Mémoires concernant l’histoire, les sciences,
les arts, les mœurs et les usages des Chinois Tome 4 Paris :
Nyon ; 1779
Andry de Boisregard N. L'Orthope´die ou l'Art de
pre´venir et de corriger dans les enfans les difformite´s
du corps. Le tout par des moyens a` la porte´e des Pe`res
& des Me`res, & de toutes les personnes qui ont des enfans
a` e´lever. Bruxelles : Georges Fricx ; 1743
Annuaire du commerce Didot-Bottin 1914, rue de l’Université,
Paris
Annuaire du commerce Didot-Bottin 1921, Tome 3, Rue de
l’Université, Paris
Anonyme The remarquable therapy machines of Dr Gustav
Zander - National Park US Department of the Interior, Hot Sprins
National Park Arkansas
Anonyme Fauteuil de poste, machine pour guérir
et pour éloigner les maladies que causent l’excès
de nourriture, la vie trop sédentaire et le défaut
de transpiration suffisante. Le Mercure de France 1734 ; 2 :
2879-89
Anonyme La médecine qui guérit : les panacées
authentiques, les remèdes infaillibles. Paris : Institut
Biothérapic-Alexia ; sd
Anonyme Revue de la publicité La Publicité
1919 ;140 :348
Anquetil Duperron A-H. Zend-Avesta de Zoroastre Tome 1
äris : Tillard ; 1771 (p356)
Balfour W. Illustrations of the Efficacy of Compression
and Percussion in the Cure of Rheumatism and Sprains, Scrofulous
Affections of the Joints and Spine, Chronic Pains Arising from a
Scrofulous Taint in the Constitution, Lameness, and Loss of Power
in the Hands from Gout, Paralytic Debility of the Extremities, General
Derangement of the Nervous System; and in Promoting Digestion, with
All the Secretions and Excretions. Lond Med Phys J. 1824 Jun; 51(304):
446–62.
Ballexserd J. Dissertation sur l'éducation physique
des enfans depuis leur naissance jusqu'à l'âge de puberté
Paris : Vallat-La-Chapelle ; 1762
Barcklay J. The muscular motion of the human body Edinburgh :
W. Laing and A. Constable ; 1808
Bell J. Mechanotherapy, Man and Machines Physiotherapy
1994 ; 80(2) : 61-6
Bergman Dr. Le visage et les soins à lui donner
Le massage du visage "Récamier'' d'après le célèbre système
H. Simons, L'art de rajeunir et d'embellir Paris : La parfumerie
"Récamier''; 1900
Berliner Adressbuch, https://digital.zlb.de
Berne G. Le massage manuel théorique et pratique
Paris : Rueff et Cie ; 1894
Berne G. Le massage, manuel théorique et pratique
Paris : J.-B. Baillière et fils ; 1922
Bidault P., Lepart J. Étains médicaux et
pharmaceutiques Paris : Ed. Ch. Massin ; sd
Bilz F.E. La nouvelle médication naturelle. Traité
et aide mémoire de médication et d'hygiène
naturelles Paris : Bilz ; 1898
Bourneville Dr Manuel pratique de la garde-malade et de
l’infirmière Paris : Progrès médical ;
1889
Boyer A.B. Improvements in or relating to massage apparatus
or roller. Patent N°21123, date of application 22nd Oct., 1901,
accepter 23rd Nov,1901 His Majesty’s stationery office : Malcomson
& C° Ltd ; 1901
Brichieri Comombi L., Zappulli 0., Romanelli L. Dispositif
pneumatique portatif pour massage vibratoire Brevet N° 835726
demandé le 25 mars 1938, délivré le 3 octobre
1938, publié le 29 décembre 1938. Office national
de la propriété industrielle. Imprimerie nationale.
Brodart H. Catalogue illustré n° 10, Instruments
de chirurgie, orthopédie Paris ; 1934
Brousses J. Manuel technique de massage Paris : Masson
& Cie ; 1920
Bum A. Mechanotherapie (Massage und Gymnastik) Wien :
Urban & Schwarzenberg ; 1893
Busch F. General orthopaedics, gymnastics and massage
in Von Ziemssen’s handbook of general therapeutics vol.5 New-York
: William Wood & Co ; 1886
Calvert R.N. The history of massage An illustrated survey
from around the world Healing Arts Press : Rochester ;
2002
Catalogue de l’exposition du 3ème congrès
de Physiothérapie, Paris 29 mars-2 avril 1910. Imprimerie
Aragno, Paris.
Catalogue Manufacture d’Armes et Cycles de St Etienne
1924 p. 193 Paris : Imprimerie Pigelet ; 1924
Cecil T. Massage sèche London : Simpkin, Marshall
& Co ; 1888
Chevalier Ch. L'Hôpital dans la France du XXème
siècle Paris: Perrin; 2009
Cleoburey W. A full account of the system of friction,
as adopted and pursued with the greatest success in cases of contracted
joints and lameness, from various causes Oxford : Munday and
Slatter ; 1825
Coliez G. La foire commerciale de Leipzig en 1928 Revue
industrielle 1928 ; 74 :601
Condon D. Early Irish Cinema : Kinemac, Pulsocon, Skibbereen : A
New Lexicon for Irish Cinematic Sensation
http://filmireland.net/2015/11/24/early-irish-cinema-kinemac-pulsocon-skibbereen-a-new-lexicon-for-irish-cinematic-sensation/
Coulon H. De l'usage des strigiles dans l'antiquité.
Mémoire lu le 18 avril 1895, au Congrès des Sociétés
Savantes à la Sorbonne Cambrai : Régnier ;
1895
Coury Ch. La médecine de l’Amérique précolombienne
Paris : Roger Dacosta ; 1969
Dagron G. Le massage et la massothérapie : les
frictions aux masseurs, la massothérapie aux médecins
Paris : Masson ; 1900
de Frumerie G. Cours de massage accessoire des soins d’accouchements
à donner aux femmes enceintes et parturientes aux nourrices
et nourrissons Vigot : Paris ; 1904
de Frumerie G. La pratique du massage. Cours à
l’usage des infirmiers et infirmières Vigot : Paris ;
1901
de Frumerie G. La pratique du massage. Manuel à
l’usage des étudiants en médecine, des infirmiers
et infirmières, des candidats au diplôme de l’état
de masseur et de masseuse Vigot : Paris ; 1941
de Frumerie G. Le massage pour tous Indications et technique
du massage général
Vigot : Paris ; 1917 2ème éd.
de Frumerie G. Traitement manuel des déviations
pathologiques du rachis Vigot : Paris : 1924
de Genst H. Histoire de l'éducation physique, tome
II. Temps modernes et grands courants contemporains Bruxelles :
A. de Boeck ; 1949
de Lacroix de Lavalette L. La Sismothérapie ou
l'utilisation du mouvement vibratoire en médecine générale
et particulièrement en thérapeutique gynécologique
Thèse Médecine Paris 1899
De Lavergne L. L’abbé de Saint-Pierre Revue des
deux mondes 1889 ; 79 : 557-89
Defrance J., Brier P., El Boujjoufi T. Transformations
des relations entre médecine et activités Gesnerus
2013 ;70/1 : 86–110
Desessartz J.Ch. Traité de l'éducation corporelle
des enfants en bas âge Paris : J_Th. Hérissant ;
1760
Desseaux A. Franc¸ois Humbert, orthope´diste
me´connu, initiateur du traitement curatif des “boiteux” Histoire
des sciences médicales 2015 ; 49(3/4) : 381-92
Deutsche Reich, Reichpatentamt, Patenschrift N°328245
Vibrationsapparat, Patentiert im Deutschem Reiche vom 7 Februar
1919
Deutsches Reich, Reichpatentamt, Patenschrift N°337035
Vibrationsapparat, Patentiert im Deutschem Reiche vom 16 Oktober
1919.
Deutsches Reich, Reichpatentamt, Patenschrift N°432591
Vibrationsapparat, Patentiert im Deutschem Reiche vom 29 April 1925.
Deville E. Considérations sur le massage et son
application dans l'entorse Thèse Médecine Strasbourg :
Silbermann ; 1864
Dion Ch. Improvements in apparatus for the massage of
the eyes for the cure of myopy, Patent N°10101, Date of application
4th May. 1903, accepted 18th feb., 1904. Printed for His Majesty
Stationery Office, Love & Malcomson Ltd, 1904
Dion Ch. Système d’appareil perfectionné
pour la gymnastique rationnelle des yeux, pour la guérison
de la myopie et les altérations de la vue Brevet N° 342985
demandé le 7 mai 1904, délivré le 23 juillet
1904, publié le 22 septembre 1904. Office National de la
Propriété Industrielle
Dion Ch., Goubaux Y. Appareil pour le traitement des altérations
de la vue Brevet N° 13073 - 20 août 1896 Bureau fédéral
de la propriété intellectuelle
Dowse Stretch Th. Lectures on massage & electricity
in the treatment of disease (masso-electrotherapeutics) London :
Hamilton, Adams & Co ; 1889
Drapier Catalogue bandages herniaires, ceintures, bas
pour varices, accessoires Paris : Imprimerie Chantenay ;
1911
Du Choul G. Des bains et de la palestre, Manuscrit rédigé
entre 1546 et 1547 au plus tard
Dujardin-Beaumetz G. De la massothérapie Nice-Médical
1887 ; 3 : 33-41
Dumas J.L. Histoire de la pensée. Renaissance et
Siècle des Lumières Paris : Tallandier ;
1990
Duplaix A. Appareil de massage Brevet N° 488311 demandé
le 8 novembre 1917, délivré le 18 juin 1918, publié
le 20 septembre 1918. Office national de la propriété
industrielle. Imprimerie nationale
Dupont Lits, fauteuils, voitures et appareils mécaniques
pour malades et blessés. Harambat : Paris ; circa
1925
Eiger J. Zabludovski’s technik der massage Leipzig :
Georg Thieme ; 1911
Estradère J. Du massage, son historique, ses manipulations,
ses effets thérapeutiques. Paris Adrien Delahaye ; 1863
Eulenburg M. Die Schwedische Halgymnastik, Versuch einer
wissenschaftlichen Begründung derselben Berlin : A. Hirschwald :1853
Fallen C. : The Zander institute for mechanico-therapeutics
or swedish movements and massage by machinery. New-York, circa 1890
Flashar Dr Apparate zur Massage Centralblatt für
Chirurgie 1886 ; 43 :745-7
Fleissner H. Massage apparatus Patent N° 520160 Convention
Date in Germany : Oct. 13, 1937, Application date in United
Kingdom : Oct. 13, 1938, Completed specification accepted April
16, 1940. Leamington Spa His Majesty’s stationary office 1940
Fraikin A., Grenier de Cardenal H. : La Mécanothérapie
in Physiothérapie tome 4, Mécanothérapie, rééducation
motrice, jeux et sports, méthode Bier, hydrothérapie,
aérothérapie. Bibliothèque de thérapeutique.
Paris, J.P. Baillière, 1909
Frank J.P. System einer vollständigen medicinischen
Polizey Mannheim : Schwan ; 1784
Fritze L.S. Massage instrument, Patent N°676604, application
filed March 19, 1900, patented June 18, 1901. United States Patent
Office
Garçon M. Quelques types de guérisseurs
Revue anthropologique 1928 ;38ème année :
90-6
Garratt J.E. The Veedee and how to use it London :Veedee
Company ; sd
Gastou P. Hygiène du visage – Cosmétique,
esthétique et massage Paris : J.B. Baillière ;
1915
Gautier J. Du massage ou manipulation appliqué
à la thérapeutique et à l'hygiène Le
Mans : Monnoyer ; 1880
Georgii A. A few words on kinesipathy or swedish medical
gymnastics. The application of active and passive movements to the
cure of diseases according to the method of P.H. Ling London :
Hippolyte Bailliere ; 1850
Georgii C. Kine´sithe´rapie ou Traitement
des maladies par le mouvement selon la méthode de Ling Paris :
Germer Baillière ; 1847
Gibney J. A treatise on the properties and medical application of
the vapour bath: in its different varieties and their effects :
in various species of diseased action
London : Thomas and George Underwood ; 1829
Gilles de La Tourette G. Considérations sur la
médecine vibratoire, ses applications et sa technique Nouvelle
Iconographie de la Salpêtrière 1892 ; 5 :
265-75
Goetze M., Simons H. Massageapparat mit versetzt angeorducten
cylindrischen Walzen, Patentschrift N°9924, 28. Januar 1895
Schweizeriche Eidgenossenschaft.
Göranssons Mekaniska Verkstadt La gymnastique médico-mécanique
de Zander, ses principes, ses applications suivis de quelques indications
sur la création d’établissements gymniques d’après
cette méthode – Stockholm : Imprimerie royale, Norstedt
et Söner, 1896
Grafstrom A. V. A Text Book of Mechano-Therapy (Massage
And Medical Gymnastics) New-York : O.M.Foegri & Co ;
1898
Grmek M.D. Histoire de la pensée médicale
Antiquité et Moyen-Age Paris : Seuil ; 1995
Grose J.-H. Voyage aux Indes orientales Londres 1758
Grosvenor J. A full account of the system of friction,
as adopted and pursued with the greatest success in cases of contracted
joints and lameness, from various causes Oxford : Munday and
Slatter ; 1825
Guilleminot H. Electricité médicale Paris :
Steinheil ; 1907
Guyenot
P.. : La mécanothérapie
à l’institut Zander d’Aix les Bains. Aix les bains :
Imprimerie Gérente ; 1904 TDM  TDM TDM  [Note du CFDRM livret dans lequel il aborde
le massage] [Note du CFDRM livret dans lequel il aborde
le massage]
Hamilton-Beach Company Health and how to get it Racine :
Charles Lee Bryson, 1912
Hanssen N., Ottosson A. Nobel price for physical therapy ?
Rise,fall and revival of medico-mechanical institutes Phys Ther
2015 ; 95(8) : 1184-94
Hartmann H. Gynécologie opératoire Paris :
Steinheil ; 1911
Historical makers of microscopes and microscope slides
http://microscopist.net
Hoerni B La loi du 30 septembre 1892 Histoire des Scjences
médicales 1998 ; 1(32) : 63-7
Imbault-Huart M.J. La médecine au Moyen-Age à
travers les manuscrits de la Bibliothèque Nationale Paris :
Ed. de la Porte Verte ; 1983
Jacobsohn P. Ein einfacher Hand-Vibrationsmassage-Apparat
(Vibrostat) Dtsch. Med. Wochenschr. 1919; 45(16): 436-437
Johansen J.C. Abdominal massage apparatus, Patent N°860669,
application filed September 28, 1906, patented July 23, 1907. United
States Patent Office.
Johansen J.C. Anordning til anbringelse af massagepelotter
i vibratorer. Danskt Patent N°10863. Patent udstedt den 12.
Maj 1908, beskyttet fra den 8 Juli 1907
Johansen J.C. Appareil pour le massage du ventre. Brevet
d’invention N° 374760, demandé le
16 février 1907, délivré le 25 avril
1907, publié le 22 juin 1907. Imprimerie Nationale
Johansen J.C. Dispositif de réglage pour les pelotes
de massage dans les instruments vibratoires. Brevet d’invention
N° 392106, demandé le 7 juillet 1908, délivré
le 16 septembre 1908, publié le 18 novembre 1908. Imprimerie
Nationale
Johansen J.C. Improvements in abdominal massage apparatus,
Patent N°3990, date of application 18th Feb. 1907, accepted
2nd May 1907. Printed for His Majesty Stationery Office, Love &
Malcomson Ltd, 1907
Johansen J.C. Improvements in or relating to massage apparatus,
Patent N°17554, date of application 23rd July., 1910, accepted
9th February 1911. Printed for His Majesty Stationery Office, Love
& Malcomson Ltd, 1911
Johansen J.C. Improvements in or relating to massage apparatus,
Patent N°103863, Application date Feb. 15, 1916, accepted Feb.
15, 1917. Printed for His Majesty Stationery Office, Love &
Malcomson Ltd, 1917
Johansen J.C. Improvements in or relating to massage apparatus,
Patent N°19032, date of application 12th Aug., 1910, accepted
31st Dec 1910. Printed for His Majesty Stationery Office, Love &
Malcomson Ltd, 1911
Johansen J.C. Johansen J.C. Improvements in or relating
to massage apparatus, Patent N°7784, date of application 30th
Mar., 1912, accepted 26th Sept 1912. Printed for His Majesty Stationery
Office, Love & Malcomson Ltd, 1912
Johansen J.C. Massage apparatus, Patent N°1175360,
application filed August 4, 1910, patented Mar 14, 1916. United
States Patent Office.
Johansen J.C. Massage apparatus, Patent N°1177415,
application filed August 8, 1911, patented Mar 28, 1916. United
States Patent Office
Johansen J.C. Massageapparat. Danskt Patent N°6517.
Patent udstedt den 20. April 1904, beskyttet fra den 28 Maj 1903
Johansen J.C., Johansen A. Improvements in or relating
to adjusting mechanism for massage apparatus or the like, Patent
N°118703, Application date Sept. 26, 1917, accepted Sept. 18,
1918. Printed for His Majesty Stationery Office, Love & Malcomson
Ltd, 1918
Johnson W. The anatriptic art : a history of the art termed
anatripsis by Hippocrates, tripsis by Galen, frictio by Celsus,
manipulation by Beveridge, and medical rubbing in ordinary language,
from the earliest times to the present day : followed by an account
of its virtues in the cure of disease and maintenance of health,
with illustrative cases London : Simpkin, Marshall, & Co ;
1866
Katsch H. Haupt- Preisliste Fabrik chirurgischer Instrumente,
Orthopädisher Maschinen Bandagen und Verbandstoffe Munschen
1906
Kellgren A. The technic of ling’s system
of manual treatment Edinburg & London : Y.J. Pentland ;
1890
Kleen E. Handbook of massage Philadelphia : Blakiston ;
1892
Klein B. D’un usage curieux en médecine. Réflexions
sur « De l’utilité de la flagellation de
J.H. Meibom » Paris : Classiques Garnier ;
2016,ZZ
Kouindjy P. Précis de Kinésithérapie:
La mobilisation méthodique, la massothérapie, la mécanothérapie,
la rééducation, l'éducation physique Paris :
Maloine ; 1922
Krafft Ch. Le massage des contusions et des entorses fraîches
Lausanne : George Bridel & Cie ; 1895
Kreutzmüller C. Final Sale in Berlin. The Destruction
of Jewish commercial activity 1930-1945 New york : Berghahn
Books ; 2013
Labadie-Lagrave F., Legueu F. Traité médico-chirurgical
de gynécologie Paris : Félix Alcan ; 1904
Lacy L.R. An improved massaging device Patent N° 393557,
Application date, March 25th.1933 – accepted June 8th.1933. His
Majesty’s stationery office, Love & Malcomson Ltd 1933
Lacy L.R. Improved apparatus for massaging the eyes Patent
N° 363101, Application date, Nov 20th.1930 – Complete left,
Aug 20th.1931 – accepted Dec 17th.1931. His Majesty’s stationery
office, Love & Malcomson, Ltd 1932
Lacy L.R. Improved apparatus for massaging the eyes Patent
N° 434927, Application date, March 26th.1935 – accepted Sept
11th.1935. His Majesty’s stationery office, Courier Press 1935
Lagrange F. Les mouvements méthodiques et la mécanothérapie
Paris : Félix Alcan ; 1899
Laisné N. Application de la gymnastique à
la guérison de quelques maladies avec des observations sur
l’enseignement actuel de la gymnastique Paris : Louis
Leclerc ; 1865
Laisné N. Du massage, des frictions et manipulations
appliquées à la guérison de quelques maladies
Paris : Masson ; 1868
Lamotte A. Traité professionnel de massage de beauté
Paris : Morin et Millant ; sd circa 1923
Lardry J-M. Etude de l’ouvrage intitulé « Du
massage, son historique, ses manipulations, ses effets thérapeutiques »
du Dr Jean Dominique Joachim Estradère Kinesither Rev 2016 ;16(171) :88-91
Lardry J-M. Gymnastique médicinale et chirurgicale,
ou essai sur l'utilité du mouvement, ou des différents
exercices du corps, et du repos dans la cure des maladies par Clément
Joseph Tissot (1747-1826)
Lardry J.M. Étude de l’ouvrage « Application
de la gymnastique à la guérison de quelques maladies
avec des observations sur l’enseignement actuel de la gymnastique »
de Napoléon-Alexandre Laisné. Kinesither Rev 2016 ;16(174) :
63-6
Latson W.R. Common disorders with rational methods of
treatment the Health Culture Company New-York 1904
Le Betou I.G.I. Therapeutic manipulation or Medicina mechanica
: a successful treatment of various disorders of the human body,
by mechanical application. London : Simpkin, Marshall &
Co ; 1851
Le Gentil Voyage dans les mers de l’Inde tome 1 Paris :
Imprimerie Royale ; 1779
Leca A-P. La médecine égyptienne au temps
des pharaons Paris : Roger Dacosta ; 1971
Lehmstedt P. Improvements in and relating to massage apparatus
Patent N° 6627, date of application, 18th Mar., 1902 – Complete
specification left, 22nd Nov., 1902 – accepted 5th Feb., 1903. His
Majesty stationery office, Love & Malcomson, Ltd 1903
Lentz Ch. Illustrated catalogue and price list of surgical
instruments, hospital supplies, orthopedic apparatus, trusses. Philadelphia :
Lentz & Sons ; cc 1915
Levacher de La Feutrie Th. Traité du rakitis ou
l’art de redresser les enfants contrefaits Paris : Lacombe ;
1772
Levacher F.-G., Nouveau moyen de prévenir et de
guérir la courbure de l’épine, Mémoire
de l’Académie royale de chirurgie, 1768 ; 4 : 596-613.
Leverdin A. Dr G. Zander, ihre medico-mechanische gymnastik
Stockholm : Imprimerie royale, Norstedt et Söner, 1892
– Le texte allemand est suivi de sa traduction en français,
en anglais et en italien.
Lloyd W., Loder W. An improved device for applying preparations
to the skin Patent N° 19350, date of application, 28th Aug.,
1907 – accepted 7th Nov. 1907. His Majesty stationery office, Love
& Malcomson, Ltd 1907
Lloyd W., Loder W. An improved shaving appliance Patent
N° 27348, date of application, 1st Dec., 1906 – Complete specification
left, 12th Apr., 1907 – accepted 13th June 1907. His Majesty stationery
office, Love & Malcomson, Ltd 1907
Londe Ch. Bibliographie : Nouvelles preuves du danger
des lits mécaniques Archives générales de médecine
1828 ; 1(16), 646-8
Londe Ch. Gymnastique médicale ou L'exercice appliqué
aux organes de l'homme Paris :Croullebois ; 1821
Lorinser K.I. Zum Schutz der Gesundheit in den Schulen Berlin
: Ludwig Hold ; 1836
Lucas-Championnière J. Traitement des fractures
par le massage et la mobilisations Paris : Rueff et Cie ;
1895
Lyons A.S., Petrucelli R.J. Histoire illustrée
de la médecine Paris : Presse de la Renaissance ;
1979
Macaura G.J. A new or improved machine for medical manipulation.
Application date April 10, 1940. Patent N° 540298. His Majesty’s
Stationery Office. Courier Press 1941
Macaura G.J. Appareil de massage vibratoire à commande
manuelle demande déposée le 13 mai 1924 N°111236
Bureau fédéral de la propriété industrielle.
Macaura G.J. Appareil pulsateur pour massage et autres
applications. Brevet N° 439100, demandé le 18 janvier
1912, délivré le 29 mars 1912, publié le 5
juin 1912. Office nationale de la propriété industrielle.
Imprimerie Nationale.
Macaura G.J. Appareil vibrateur-masseur. Brevet N°
322806, demandé le 7 juillet 1902, délivré
le 16 octobre 1902, publié le 13 février 1903. Office
nationale de la propriété industrielle. Imprimerie
Nationale.
Macaura G.J. Improvements in and relating to hand actuated
vibrators for massage pur
poses. Application date 2 May, 1923. Patent N° 235355.
His Majesty’s Stationery Office. Love & Malcomson Ltd 1925
Macaura G.J. Improvements in and relating to hand actuated
vibrators for massage purposes. Application date 2 May, 1924. Patent
N° 235356 Patent of addition to N° 221846 23 May, 1923.
His Majesty’s Stationery Office. Love & Malcomson Ltd 1925
Macaura G.J. Improvements in and relating to the treating
of patients by static, galvanic or like electrical currents. Date
of application 13th May., 1905. Patent N°10067 24 th Aug., 1905.
His Majesty’s Stationery Office. Love & Malcomson Ltd 1905
Macaura G.J. Improvements in and relating to vibrators
for massage or like treatments. Date of application 6th Jul., 1905.
Patent N° 13932 7 th Sept., 1905. His Majesty’s Stationery Office.
Love & Malcomson Ltd 1905
Macaura G.J. Massierapparat mit Magnetinduktor Angemeldet
21 mai 1924 N°104520 Österreichisches Patentamt.
Macaura G.J. Movement-cure apparatus. Application field
December 6, 1901. Patent N° 716448 December 23, 1902. United
States Patent Office
Macaura G.J. Vibrateur à action oscillatoire pour
massage et autres applications. Brevet N° 439099, demandé
le 18 janvier 1912, délivré le 29 mars 1912, publié
le 5 juin 1912. Office nationale de la propriété industrielle.
Imprimerie Nationale.
Macaura G.J. Vibrator for massage purposes Application
number 254542, 13-10-1925 Canadian intelectual property office.
Macaura G.J. Vibrator for massage purposes. Application
field May 9, 1924. Patent N° 15592144 July 13, 1926. United
States Patent Office
Macaura G.J. Vibrator for the massage treatment. Date
of application 12th Feb., 1902. Patent N° 03619 24 th Apr.,
1902. His Majesty’s Stationery Office. Love & Malcomson Ltd
1902
Macaura GJ. Appareil pulsateur pour massage et autres
applications. Brevet No 439100, demandé le 18 janvier 1912,
délivré le 29 mars 1912, publié le 5 juin 1912.
Office nationale de la propriété industrielle. Imprimerie
Nationale.
Macaura GJ. Vibrateur à action oscillatoire pour
massage et autres applications. Brevet No 439099, demandé
le 18 janvier 1912, délivré le 29 mars 1912, publié
le 5 juin 1912. Office nationale de la propriété industrielle.
Imprimerie Nationale.
Marcireau J. La médecine physique secrets d’hier,
techniques d’aujourd’hui Paris : Le courrier du Livre ;
1965
Marfort J.E. Manuel pratique de massage et de gymnastique
médicale suédoise Paris : Vigot ; 1907
Martin J.P. : Le Pulsoconn du Dr Macaura Clyste`re 2013
;19 :14-8 (www.clystere.com)
Martin J.P. Base de données Fabricants de matériels
médico-chirurgicaux, France (www.clystere.com)
Martin J.P. Ivoire, os, matériaux artificiels : comment les
reconnaître ? Clystère www.clystere.com 2011 ;
3 : 6-9
Martin J.P. L’Elektroller Clystère 2011 ;
2 : 2-3 (www.clystere.com)
Martin J.P. L’histoire des seringues, injecteurs et aspirateurs
étudiés comme modèle de l’évolution
technologique des instruments médicaux DU Histoire de la
Médecine Université Paris Descartes 2018
Martin J.P. L’instrumentation chirurgicale et coutellerie
en France des origines au XIXème siècle Paris :
L’Harmattan ; 2013
Martin J.P. L’instrumentation medico-chirurgicale en caoutchouc
en France XVIIIème,
XIXème siècle Paris : L’Harmattan ;
2013
Martin J.P. Les fabricants français de matériels
médicaux Cahiers de Clystère N°4 www.clystere.com
Mcafee N.E. Massage : An Elementary Textbook For Nurses
Pittsburgh : Reed & Witting Co ; 1917
Meibomius J.H. De l’utilité de la flagellation
dans la médecine et dans les plaisirs du mariage et des fonctions
des lombes et des reins Paris : Mercier ; 1795
Milkman G.W. Combination massage roller and exerciser
Patent N°681331, application filed May 2, 1900, patented August
27, 1901. United States Patent Office
Monet J. Emergence de la Kinésithérapie
en France à la fin du XIXème et au début du
XXème siècle Thèse Doctorat Sociologie, Université
Paris I Panthéon-Sorbonne Juin 2003
Monet J., Quin G. Sauveur-Henri-Victor Bouvier (1799–1877):
orthopédiste, chirurgien et promoteur de l’éducation
physique Gesnerus 2013 ; 70(1) : 53–67
Mortimer-Granville J. Nerve Vibration and excitation London :
J. & A. Churchill ; 1883
Mortimer-Granville J. Nerve Vibration as a therapeutic
agent The Lancet 1882 ;119(3067) : 949-51
Mortimer-Granville J. Treatment of pain by mechanical
vibrations The Lancet 1881 ; 117(2999) : 286-88
Muschik E. Improvements in massage apparatus, Patent N°8461,
Date of application 9th Apr. 1898, accepted 16th July, 1898. Printed
for His Majesty Stationery Office, Malcomson Ltd, 1898.
Muschik E. Massage device, Patent N°636163, application
filed June 6, 1898, patented October 31, 1899. United States Patent
Office
Muschik E. Massage-apparat, Patentschrift N°17778,
22. September 1898 Schweizeriche Eidgenossenschaft.
Muschik E. Massageapparat. Danskt Patent N°1898. Patent
udstedt den 28. Oktober 1898, beskyttet fra den 17 Marts 1899
Neumann A.C. Die Heil-gymnastick oder die Kunst die Leibesübungen,
angewandt zur Heilung von Krankheiten Berlin : P.Jeanrenaud ;
1852
Nicholls D.A., Cheek J. Physiotherapy and the shadow of
prostitution : the Society of Trained Masseuses and the scandals
of 1894 Soc Science Med 2006 ;62 : 2336-48
Norström G. Formulaire du massage Paris : JB
Baillière ; 1895
Nyrops C . Dr J.C. Johansens Auto-vibrator København :
Trykt Hos Nielsen & Lydiche ; 1907
Paré A. Œuvres Lyon : Jean Grégoire ;
1664
Patentschrift, Schweizerische Eidgenossenschaft, Eidgen.
Amt für geistiges Eigentum, Patent 10626, 29 Juni 1895
Perez S. Histoires des médecins – Artisans et artistes
de la Santé de l’Antiquité à nos jours Paris :
Perrin ; 2018
Petit L. Le massage par le médecin, physiologie,
manuel opératoire, indications Paris : Alexandre Coccoz ;
1885
Petitdant B. Auto-vibrator du Docteur Johansen, New American
Vibrator, deux noms pour un même instrument de massage vibratoire
Kinesither Rev 2020 ;20(228) :33-6
Petitdant B. Docteur Johansen et les quarante brevets
Clystère 2020 ;71 :9-19 (www.clystere.com)
Petitdant B. L’appareil de massage de P. Semerak, pressions
glissées et percussions Kinesither Rev 2019;19(214):36–39
Petitdant B. La vibrothérapie sous toutes ses formes
« Death is stagnation, life is vibration » Clystère
2017 ;61 :11-47 www.clystere.com
Petitdant B. Le Docteur Macaura et son Pulsoconn, appareil
de massage vibratoire Kinesither Rev 2018;18(199):36–42
Petitdant B. Le goniomètre médical au fil
du temps Kinesither Rev 2016 ; 16(179) :48-61
Petitdant B. Le régénérateur organique
électromagnétique « SANITAS »
du Docteur Pion Clystère 2020 ; 70 : 30-37 www.clystere.com
Petitdant B. Le Veedee, appareil à main pour le
massage vibratoire Clystère 2019 ; 69 :14-23 (www.clystere.com)
Petitdant B. Le Vibrostat, appareil de massage vibratoire
Clystère 2018 ; 63 : 4-16 www.clystere.com
Petitdant B. Les appareils de mécanothérapie
de Zander Clystère 2015 ;36 :13-33 www.clystere.com
Petitdant B. Massage et renforcement musculaire dans les
années 1920 : une lanière à boules lisses
couplée à un tendeur de musculation Kinesither Rev
2019 ;20(219) :33-35
Petitdant B. Origines, histoire, évolutions de
la mesure de la force de préhension et des dynamomètres
médicaux Kinesither Rev 2017 ; 17(181) : 40-58
Petitdant B. Un appareil électrique portatif de
massage vibratoire Rupalley & Cie Clystère 2017 ;
60 : 6-18 www.clystere.com
Petitdant B. Un appareil français de massage vibratoire,
production d’Issak Robert Zalkind Kinesither Rev 2019 ; 19(216) :
60-3
Petitdant B. Un coffret d'instruments de massage du XIXe
siècle de Heinrich Simons Kinesither Rev 2019 ; 19(206) :
35-42
Peytoureau Dr. Manuel de Face-massage et de massage capillaire
Essai de culture physique du visage Paris : Hygie ; 1936
Pfister G. Cultural confrontation : German Turnen,
swedish gymnastics and english sports- european diversity in physical
activities from a historical perspective Culture, Sport, Society
2003 ; 6(1) : 61-91
Phélippeaux M.V.A. Etude pratique sur les frictions
et le massage ou guide du médecin masseur Paris : L’Abeille
médicale ; 1870 TDM  [Note du CFDRM l'édition originale
date de 1869] [Note du CFDRM l'édition originale
date de 1869]
Piesen J. Improvements in or relating to massage apparatus
Application date Sept. 3, 1928. N° 296676, complete accepted
Jan. 31, 1929. His Majesty stationery office Love & Malcomson
1929.
Piorry article « Massage » Une société
de Médecins et de chirurgiens Dictionnaire des sciences médicales
Tome 31 Paris : C.L.F. Panckoucke ; 1819
Pugh J. A physiological, theoric and practical treatise
on the utility of the science of muscular action for restoring the
power of the limbs London : C. Dilly ; 1794
Quin G. A Professor of Gymnastics in Hospital. Napoléon
Laisné (1810-1896) introduce Gymnastics at the « Hôpital
des Enfants malades » Staps 2009 ; 86(4) :79-91
Quin G. Approche comparée des pratiques médicales
de »massage » et de « gymnastique »
à la fin du XIX ème siècle et au début
du XXème siècle (Angleterre, France, Allemagne, Suisse)
Histoire des sciences médicales 2014 ; 48(2) :
215-24
Quin G. Jules Guérin: brève biographie d’un
acteur de l’institutionnalisation de l’orthopédie (1830–1850)
Gesnerus 2009 ; 66(2) : 237–55
Quin G. Le mouvement peut-il guérir ? Les
usages médicaux de la gymnastique au XIXème siècle
Lausanne : Editions BHMS ; 2019
Quin G., Monet J. De Paris a` Strasbourg : L’essor des
e´tablissements orthope´diques et gymnastiques (premie`re
moitie´ du XIXe`me sie`cle) Histoire des Sciences médicales
2011 ; 45(4) : 369-79
Quin, G. Genèse et structure d'un inter-champ orthopédique
(première moitié du XIXème siècle) :
Contribution à l'histoire de l'institutionnalisation d'un
champ scientifique. Revue d'histoire des sciences 2011 ;
64(2) : 323-47
Rainal Frères Catalogue général 1825-1934
Paris : H.M. Boutin ; 1934
Reece and Co The catalogue of drugs, or medicine chest
companion London : The Medical Hall, ; 1846
Régnier L.R.: La Mécanothérapie,
application du mouvement à la cure des maladies. Paris, J.P.
Baillière, 1901
Reibmayr A. - Die Technik der Massage Wien : Toeplitz
et Deuticke ; 1884
Reibmayr A. Die Massage und ihre Verwethung in den verschiedenen
Disciplinen der praktischen Medizin Wien : Toeplitz et Deuticke ;
1883
Remondière R. L'institution de la kinésithérapie
en France (1840-1946), Les Cahiers du Centre de Recherches
Historiques 12 | 1994, mis en ligne le 27 février
2009, consulté le 10 décembre 2020. URL :
http://journals.openedition.org/ccrh/2753.
Remondière R. La mécanothérapie au
temps de la Grande Guerre Revue historique des armées [En
ligne], 274 | 2014, mis en ligne le 18 juillet 2014, consulté
le 11 décembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/rha/7969
Renner Cl. Histoire illustrée des étains
médicaux Paris : EGV Éditions 2011
Reveil O. Formulaire raisonné des médicaments
nouveaux Paris : J.B. Baillière ; 1864
Rizet F. De la manière de pratiquer le massage
dans l'entorse Arras : A.Courtin ; 1864
Rodeck C.G. Appareil de massage vibratoire à air
comprimé Brevet N° 463551 demandé le 11 octobre
1913, délivré le 19 décembre 1913, publié
le 26 février 1914. Office national de la propriété
industrielle. Imprimerie nationale.
Rostan L. article « Massage » in
Adelon, Béclard, Biett, et al. Dictionnaire de Médecine
Tome 14 Paris : Béchet jeune ; 1826
Rowe W.H. Massage : A treatise on masso-electra-therapeutics
Hartlepool, Pearson & Bell 1898
Sartori G. Apparatus for massaging, Patent N°732897,
application filed August 14, 1902, patented July 7, 1903. United
States Patent Office
Sartori G. Device for mechanical skin treatment or massage,
Patent N°8726, date of application 27th Apr., 1901, accepted
9th Jan. 1902. Printed for His Majesty Stationery Office, Malcomson
& Co Ltd, 1902
Sartori G. Für Betrieb mittelst eines gasförmigen
Druckmittels eingerichtete Massiervorrichtung Patent N° 22732
26 Juli 1901. Schweizerische Eidgenossenschaft
Sartori G. Massiervorrichtung Österreichische patentschrift
N°17826 Angemeldet am 16. Juli 1902 – Beginn der Patentdauer :
15 April 1904. Kais. Königl. Patentamdt Ausgegeben am 10 OKtober
1904
Schreiber J. Traité pratique de massage et de gymnastique
médicale Paris : Octave Doin ; 1884
Seacombe B. Magneto-electric massaging machine Patent
N° 12844, date of application, 1st June, 1909 – Complete specification
left, 1st Dec., 1909 – accepted 10 Mar., 1910. His Majesty stationery
office, Love & Malcomson, Ltd 1910
Semerak J. Improvements in massage and beating apparatus
for the human body. Patent 16362. Date of application, 27th July,
1898 – Accepted 8th Oct., 1898. Printed for Her Majesty’s Stationery
Office, Malcomson & C° Ltd, 1898
Semerak J. Massage apparatus Patent N° 634590 dated
October 10, 1899 United States Patent Office
Sibrower F.C. Appareil pneumatique pour massage vibratoire
Brevet N° 782530 demandé le 22 août 1934, délivré
le 18 mars 1935, publié le 6 juin 1935. Office national de
la propriété industrielle. Imprimerie nationale
Siffermann Dr. L’œil humain et ses anomalies fonctionnelles
guéries par le massage avec l’appareil Dion Strasbourg :
F. Staat ; 1899
Simons H. Improvements in or connected with apparatus
for the simultaneous shampooing or massage of, and the administration
of electricity to, the human body - N° 10408. Date of application
27th may 1895 Printed for her Majesty’s Stationery Office by Darling
& son, Ltd – 1895
Simons H. Massageapparat mit cylindrischer Walze, Patentschrift
N°10625, 29. Juni 1895 Schweizeriche Eidgenossenschaft
Simons H. Massageapparat mit kugelförmigen Massagerollen,
Patentschrift N°10626, 29. Juni 1895 Schweizeriche Eidgenossenschaft
Simons H. Mit einem daumenartigen und einem konischen
Ende versehene Massagevorrichtung, Patentschrift N°10702, 29.
Juni 1895 Schweizeriche Eidgenossenschaft
Société de Médecins et de chirurgiens
Dictionnaire des sciences médicales Article « Palette »
Tome 39 Paris : C.L.F. Panckoucke ; 1819
Spiess A. Die Lehre der Turnkunst en 4 vol. Bale :
Schweighaufer’sche Verlagsbuchhandlung ; 1874
Spiess A. Turnbuch für Schulen als Anleitung fiir
den Turnunterricht durch die Lehrer der Schulen en 2vol. Bale :
Schweighaufer’sche Verlagsbuchhandlung ; 1847
Stumm M. Appareil pneumatique pour massage
facial Brevet N° 641449 demandé
le 3 septembre 1927, délivré le 16 avril 1928, publié
le 3 août 1928. Office national de la propriété
industrielle. Imprimerie Nationale
Terlouw T. Roots of physical medicine, physical therapy,
and mechanotherapy in the Nederlands in the 19th century :
a disputed area within the healcare domain J Man Manipul Ther 2007 ;
(15)2 : 23-41
Thompson E. Improvements relating to magneto-electric
machines for massaging treatment Patent N° 223148, date of application :
April 3, 1924 – Complete accepted : Oct. 16. 1924 –. His Majesty
stationery office, Love & Malcomson, Ltd 1924
Thompson E. Perfectionnement aux appareils magnéto-électriques
pour le massage Brevet N° 579865 demandé le 7 avril 1924,
délivré le 14 août 1924, publié le 25
octobre 1924. Office national de la propriété industrielle.
Imprimerie nationale
Thooris A. Gymnastique et massage médicaux Paris :
G. Doin & Cie ; 1951
Tissot C.-J. Gymnastique médicinale et chirurgicale
ou essai sur l'utilité du mouvement ou des différents
exercices du corps et du repos dans la cure des maladies Paris :
P., Bastien ; 1780
Vandermonde Ch.-A. Essai sur la manière de perfectionner
l'espèce humaine Paris : Vincent ;1756
Velter A., Lamothe M.J. Les outils du corps Paris :
Messidor-Temps actuels ; 1984
Verdier J. Discours sur l’éducation nationale,
physique et morale des deux sexes Paris : chez l’auteur ; 1772
Vermeulen Ch. La mécanothérapie dans le
nouvel établissement thermal de Vichy. Paris, Institut international
de bibliographie scientifique, 1903
Weber A.S. Traité de la massothérapie Masson :
Paris ; 1891
Weiss A., Frennelet H. Pandectes françaises périodiques
– Recueil mensuel de jurisprudence et de législation 1905 ;
20 : 26-7
Wendschuch C. Haupt Katalog Ausgabe Dresden : Lehmannsche
Buchdruckrei ;1910
Westberg J. Adjusting swedish gymnastics to the female
nature : discrepancies in the gendering of girls’ physical
education in the mid-nineteenth century Espacio, Tiempo y Educatión
2018 ; 5(1) : 261-79
Wischnewetzky L. The mechanico-therapeutic institute.
Contributions to mechanico-therapeutics and orthopedics Vol 1, N°1,
New-York, Mechanico-therapeutic and orthopedic Zander, 1891
Zalkind R.I. Appareil à massage vibratoire. Brevet
d’invention N° 502467, demandé le 9 août 1919,
délivré le 21 février 1920, publié le
15 mai 1920. République Française. Office national
de la propriété industrielle
Zalkind R.I. Appareil électrique pour massage vibratoire.
Brevet d’invention N° 498484, demandé le 18 avril 1919,
délivré le 20 octobre 1919, publié le 13 janvier
1920. République Française. Office national de la
propriété industrielle
Zalkind R.I. Appareil pour la production de courants de
haute fréquence fonctionnant sur courant alternatif. Brevet
d’invention N° 504407, demandé le 25 septembre 1919,
délivré le 13 avril 1920, publié le 5 juillet
1920. République Française. Office national de la
propriété industrielle
Zalkind R.I. Appareil pour la production de courants de
haute fréquence fonctionnant sur courant alternatif. Brevet
d’invention N° 21849, demandé le 27 novembre 1919, délivré
le 12 octobre 1920, publié le 30 mars 1921. République
Française. Office national de la propriété
industrielle
Zalkind R.I. Appareil pour massage par tapotement, fonctionnant
à la main ou au moteur. Brevet d’invention N° 464586,
demandé le 22 octobre 1913, délivré le 16 janvier
1914, publié le 25 mars 1914. République Française.
Office national de la propriété industrielle
Zalkind R.I. Articulation pour carter de ventilateur ou
autres applications. Brevet d’invention N° 536907, demandé
le 15 juin 1921, délivré le 21 février 1922,
publié le 12 mai 1922. République Française.
Office national de la propriété industrielle
Zalkind R.I. Carter à air chaud et son procédé
de fabrication. Brevet d’invention N° 543285, demandé
le 8 novembre 1921, délivré le 31 mai 1922, publié
le 30 août 1922. République Française. Office
national de la propriété industrielle
Zalkind R.I. Interrupteur-commutateur rotatif. Brevet
d’invention N° 529296, demandé le 31 décembre
1920, délivré le 6 septembre 1921, publié le
25 septembre 1921. République Française. Office national
de la propriété industrielle
Zander G. : Notice sur la gymnastique de Zander et
l’établissement de gymnastique médicale mécanique
suédoise à Stockholm. Paris, Imprimerie A. Reiff,
1879
Résumé
Titre : Massage manuel et instrumental en Europe
du début du XIXème siècle à l’entre-deux-guerres
Résumé : Le mot français “massage”
est commun à de nombreuses langues européennes d’origine
latines ou germaniques. Il est d’un usage récent et d’une
étymologie incertaine. Aprés avoir tenté de
déterminer son origine d’usage et étymologique, nous
retraçons brièvement l’histoire du massage manuel
en Europe et son intrication avec la gymnastique orthopédique.
Nous présentons ensuite un panorama, sans avoir la prétention
d’être exhaustif, du massage instrumental. Contrairement à
ce qui se rencontre habituellement, cette presentation des instruments
de massage ne se fait pas en fonction du type de manoeuvre que ces
appareils suppléent. Nous avons tenté ici une classification
en fonction des caractéristiques techniques propres des divers
instruments de massage.
Mots clés : Appareil, Instrument, Kinésithérapie,
Massage, Physiothérapie, Histoire, Vibrothérapie
Title : Manual and instrumental massage in Europe from
the beginning of the 19th century to the interwar period
Abstract : The French word "massage" is common
to many European languages of Latin or Germanic origin. Its use
is recent and its ethymology uncertain. After trying to determine
its origin and its etymology, we briefly review the history of manual
massage in Europe and its entanglement with orthopedic gymnastics.
Then we present a panorama, without pretending to be exhaustive,
of instrumental massage. Contrary to what is usually encountered,
this presentation of the massage instruments is not done according
to the type of maneuver that these devices provide. Here we have
attempted a classification according to the specific technical characteristics
of the various massage devices.
Keywords : Device, Instrument, Tool, Physitherapy, Massage,
History, Vibrotherapy
Bibliographie
Lyons A.S., Petrucelli R.J. Histoire illustrée de la médecine
Paris : Presse de la Renaissance ; 1979
Perez S. Histoires des médecins – Artisans et artistes de
la Santé de l’Antiquité à nos jours Paris :
Perrin ; 2018
Grmek M.D. Histoire de la pensée médicale Antiquité
et Moyen-Age Paris : Seuil ; 1995
Imbault-Huart M.J. La médecine au Moyen-Age à travers
les manuscrits de la Bibliothèque Nationale Paris :
Ed. de la Porte Verte ; 1983
Coury Ch. La médecine de l’Amérique précolombienne
Paris : Roger Dacosta ; 1969
Leca A-P. La médecine égyptienne au temps des pharaons
Paris : Roger Dacosta ; 1971
Velter A., Lamothe M.J. Les outils du corps Paris : Messidor-Temps
actuels ; 1984
Martin J.P. Instrumentation chirurgicale et coutellerie en France,
des origines au XIXème siècle Paris : L’Harmattan ;
2013
Martin J.P. L’histoire des seringues, injecteurs et aspirateurs
étudiés comme modèle de l’évolution
technologique des instruments médicaux DU Histoire de la
Médecine Université Paris Descartes 2018
Bidault P., Lepart J. Étains médicaux et pharmaceutiques
Paris : Ed. Ch. Massin ; sd
Renner Cl. Histoire illustrée des étains médicaux
Paris : EGV Éditions 2011
Martin J.P. L’instrumentation médico-chirurgicale en caoutchouc
en France XVIIIème, XIXème siècle Paris :
L’Harmattan ; 2013
Estradère
J. Du massage, son historique, ses manipulations,
ses effets thérapeutiques. Paris : Adrien Delahaye ; 1863
TDM 
http://www.cnrtl.fr/etymologie/masser consulté le 15 décembre 2020
Le Gentil Voyage dans les mers de l’Inde tome 1 Paris : Imprimerie
Royale ; 1779
Grose J.-H. Voyage aux Indes orientales Londres 1758
Anquetil Duperron A-H. Zend-Avesta de Zoroastre Tome 1 Paris :
Tillard ; 1771 (p356)
Estradère J. Du massage, son historique, ses manipulations,
ses effets thérapeutiques. Paris Adrien Delahaye ; 1863
Lardry J-M. Etude de l’ouvrage intitulé « Du massage,
son historique, ses manipulations, ses effets thérapeutiques »
du Dr Jean Dominique Joachim Estradère Kinesither Rev 2016 ;
16 (171) :88-91
Bell J. Mechanotherapy, Man and Machines Physiotherapy 1994; 80(2) :
61-6
Piorry article « Massage » Une société
de Médecins et de chirurgiens Dictionnaire des sciences médicales
Tome 31 Paris : C.L.F. Panckoucke ; 1819.
Rostan L. article « Massage » in Adelon, Béclard,
Biett, et al. Dictionnaire de Médecine Tome 14 Paris :
Béchet jeune ; 1826
Londe Ch. Gymnastique médicale ou l’exercice appliqué
aux organes de l’homme. Paris : Croullebois ; 1821
Une société de Médecins et de chirurgiens Dictionnaire
des sciences médicales Article « Palette »
Tome 39 Paris : C.L.F. Panckoucke ; 1819
Estradère J. Du massage, son historique, ses manipulations,
ses effets thérapeutiques. Paris : Adrien Delahaye ;
1863
Rostan L. article « Massage » in Adelon, Béclard,
Biett, et al. Dictionnaire de Médecine Tome 14 Paris :
Béchet jeune ; 1826
Reveil O. Formulaire raisonné des médicaments nouveaux
Paris : J.B. Baillière ; 1864
Le Betou I.G.I. Therapeutic manipulation or Medicina mechanica :
a successful treatment of various disorders of the human body, by
mechanical application. London : Simpkin, Marshall & Co ;
1851
Estradère J. Du massage, son historique, ses manipulations,
ses effets thérapeutiques. Paris Adrien Delahaye; 1863
Gautier J. Du massage ou manipulation appliqué à la
thérapeutique et à l'hygiène Le Mans :
Monnoyer ; 1880
Kleen E. Handbook of massage Philadelphia : Blakiston ;
1892
Bell J. Mechanotherapy, Man and Machines Physiotherapy 1994 ;
80(2) : 61-6
Dagron G. Le massage et la massothérapie : les frictions
aux masseurs, la massothérapie aux médecins Paris :
Masson ; 1900
Dujardin-Beaumetz G. De la massothérapie Nice-Médical
1887 ; 3 :33-41
Dowse Stretch Th. Lectures on massage & electricity in the treatment
of disease (masso-electrotherapeutics) London: Hamilton, Adams &
Co ; 1889
Rowe W.H. Massage: A treatise on masso-electra-therapeutics Hartlepool :
Pearson & Bell ; 1898
Murrell W. Massotherapeutics or Massage as a mode of treatment Philadelphia :
Blakiston, son &C° ; 1890
Paré A. Œuvres Lyon : Jean Grégoire ; 1664
Tissot C.-J. Gymnastique médicinale et chirurgicale, ou essai
sur l'utilité du mouvement, ou des différents exercices
du corps, et du repos dans la cure des maladies Paris : Bastien ;
1780
Lardry J-M. Gymnastique médicinale et chirurgicale, ou essai
sur l'utilité du mouvement, ou des différents exercices
du corps, et du repos dans la cure des maladies par Clément
Joseph Tissot (1747-1826)
Londe Ch. Gymnastique médicale ou L'exercice appliqué
aux organes de l'homme Paris : Croullebois ; 1821
ibid.
Thooris A. Gymnastique et massage médicaux Paris : G.
Doin & Cie ; 1951
Lagrange F. Les mouvements méthodiques et la mécanothérapie
Paris : Félix Alcan ; 1899
Bell J. Mechanotherapy, Man and Machines Physiotherapy 1994 ;
80(2) : 61-6
Phélippeaux M.V.A. Etude pratique sur les frictions et le
massage ou guide du médecin masseur Paris : L’Abeille médicale ;
1870
Gautier J. Du massage ou manipulation appliqué à la
thérapeutique et à l'hygiène Le Mans :
Monnoyer ; 1880
Estradère J. Du massage, son historique, ses manipulations,
ses effets thérapeutiques. Paris Adrien Delahaye; 1863
Dujardin-Beaumetz G. De la massothérapie Nice-Médical
1887 ; 3 : 33-41
Kleen E. Handbook of massage Philadelphia : Blakiston ;
1892
Busch F. General orthopaedics, gymnastics and massage in Von Ziemssen’s
handbook of general therapeutics vol.5 New-York : William Wood &
Co ; 1886
Dumas J.L. Histoire de la pensée. Renaissance et Siècle
des Lumières Paris : Tallandier ; 1990
Frank J.P. System einer vollständigen medicinischen Polizey
Mannheim : Schwan ; 1784
Busch F. General orthopaedics, gymnastics and massage in Von Ziemssen’s
handbook of general therapeutics vol.5 New-York : William Wood &
Co ; 1886
Lorinser K.I. Zum Schutz der Gesundheit in den Schulen Berlin
: Ludwig Hold ; 1836
Busch F. General orthopaedics, gymnastics and massage in Von Ziemssen’s
handbook of general therapeutics vol.5 New-York : William Wood &
Co ; 1886
Ibid
Spiess A. Turnbuch für Schulen als Anleitung fiir den Turnunterricht
durch die Lehrer der Schulen 2vol. Bale : Schweighaufer’sche
Verlagsbuchhandlung ; 1847
Spiess A. Die Lehre der Turnkunst 4 vol. Bale : Schweighaufer’sche
Verlagsbuchhandlung ; 1874
Busch F. General orthopaedics, gymnastics and massage in Von Ziemssen’s
handbook of general therapeutics vol.5 New-York : William Wood &
Co ; 1886
Quin G. Approche comparée des pratiques médicales
de « massage » et de « gymnastique »
à la fin du XIX ème siècle et au début
du XXème siècle (Angleterre, France, Allemagne, Suisse)
Histoire des sciences médicales 2014 ; 48(2) :
215-24
Neumann A.C. Die Heil-gymnastick oder die Kunst die Leibesübungen,
angewandt zur Heilung von Krankheiten Berlin : P.Jeanrenaud ;
1852
Eulenburg M. Die Schwedische Halgymnastik, Versuch einer wissenschaftlichen
Begründung derselben Berlin : A. Hirschwald ; 1853
Andry de Boisregard N. L'Orthope´die ou l'Art de pre´venir
et de corriger dans les enfans les difformite´s du corps.
Le tout par des moyens a` la porte´e des Pe`res & des
Me`res, & de toutes les personnes qui ont des enfans a` e´lever.
Bruxelles : Georges Fricx ; 1743
Quin, G. Genèse et structure d'un inter-champ orthopédique
(première moitié du XIXème siècle) :
Contribution à l'histoire de l'institutionnalisation d'un
champ scientifique. Revue d'histoire des sciences 2011 ;
64(2) : 323-47
Vandermonde Ch.-A. Essai sur la manière de perfectionner
l'espèce humaine Paris : Vincent ;1756
Desessartz J.Ch. Traité de l'éducation corporelle
des enfants en bas âge Paris : J. Th. Hérissant ;
1760
Verdier J. Discours sur l’éducation nationale, physique et
morale des deux sexes Paris : chez l’auteur ; 1772
Quin, G. Genèse et structure d'un inter-champ orthopédique
(première moitié du XIXème siècle) :
Contribution à l'histoire de l'institutionnalisation d'un
champ scientifique. Revue d'histoire des sciences 2011 ;
64(2) : 323-47
Ballexserd J. Dissertation sur l'éducation physique des enfans
depuis leur naissance jusqu'à l'âge de puberté
Paris : Vallat-La-Chapelle ; 1762
Tissot C.-J. Gymnastique médicinale et chirurgicale, ou essai
sur l'utilité du mouvement, ou des différents exercices
du corps, et du repos dans la cure des maladies Paris : Bastien ;
1780
Ibid.
Londe Ch. Bibliographie : Nouvelles preuves du danger des lits mécaniques
Archives générales de médecine 1828 ;
1(16), 646-8
Quin, G. Genèse et structure d'un inter-champ orthopédique
(première moitié du XIXème siècle) :
Contribution à l'histoire de l'institutionnalisation d'un
champ scientifique. Revue d'histoire des sciences 2011 ;
64(2) : 323-47
Monet J., Quin G. Sauveur-Henri-Victor Bouvier (1799–1877): orthopédiste,
chirurgien et promoteur de l’éducation physique Gesnerus
2013 ; 70(1) : 53–67
Quin G. Jules Guérin: brève biographie d’un acteur
de l’institutionnalisation de l’orthopédie (1830–1850) Gesnerus
2009 ; 66(2) : 237–55
Quin G., Monet J. De Paris a` Strasbourg : L’essor des e´tablissements
orthope´diques et gymnastiques (premie`re moitie´ du
XIXe`me sie`cle) Histoire des Sciences médicales 2011 ;
45(4) : 369-79
Desseaux A. Franc¸ois Humbert, orthope´diste me´connu,
initiateur du traitement curatif des “boiteux” Histoire des sciences
médicales 2015 ; 49(3/4) : 381-92
Quin G. Le mouvement peut-il guérir ? Les usages médicaux
de la gymnastique au XIXème siècle Lausanne :
Editions BHMS ; 2019
Defrance J., Brier P., El Boujjoufi T. Transformations des relations
entre médecine et activités Gesnerus 2013 ; 70/1 :
86–110
Petit L. Le massage par le médecin, physiologie, manuel opératoire,
indications Paris : Alexandre Coccoz ; 1885
Lardry J-M. Etude de l’ouvrage intitulé « Du massage,
son historique, ses manipulations, ses effets thérapeutiques »
du Dr Jean Dominique Joachim Estradère Kinesither Rev 2016 ;
16(171) :88-91
Ibid
Murrell W. Massotherapeutics or Massage as a mode of treatment Philadelphia :
Blakiston, son & C° ; 1890
Defrance J., Brier P., El Boujjoufi T. Transformations des relations
entre médecine et activités Gesnerus 2013 ; 70/1 :
86–110
Quin, G. Genèse et structure d'un inter-champ orthopédique
(première moitié du XIXème siècle) :
Contribution à l'histoire de l'institutionnalisation d'un
champ scientifique. Revue d'histoire des sciences 2011 ;
64(2) : 323-47
Quin G. A Professor of Gymnastics in Hospital. Napoléon Laisné
(1810-1896) introduce Gymnastics at the « Hôpital
des Enfants malades » Staps 2009 ; 86(4) :79-91
Lardry J.M. Étude de l’ouvrage « Application de
la gymnastique à la guérison de quelques maladies
avec des observations sur l’enseignement actuel de la gymnastique »
de Napoléon-Alexandre Laisné. Kinesither Rev 2016 ;16(174) :
63-6
Georgii A. Kine´sithe´rapie ou Traitement des maladies
par le mouvement selon la méthode de Ling Paris : Germer
Baillière ; 1847
Georgii A. A few words on kinesipathy or swedish medical gymnastics.
The application of active and passive movements to the cure of diseases
according to the method of P.H. Ling London : Hippolyte Bailliere ;
1850
Estradère J. Du massage, son historique, ses manipulations,
ses effets thérapeutiques Paris : Adrien Delahaye; 1863
Laisné N. Du massage, des frictions et manipulations appliquées
à la guérison de quelques maladies Paris : Victor
Masson et fils ; 1868
Phélippeaux M.V.A. Etude pratique sur les frictions et le
massage ou guide du médecin masseur Paris : l’Abeille
Médicale ; 1869
Lainé N. Application de la gymnastique à la guérison
de quelques maladies avec des observations sur l’enseignement actuel
de la gymnastique Paris : Louis Leclerc ; 1865
Quin G. Le mouvement peut-il guérir ? Les usages médicaux
de la gymnastique au XIXème siècle Lausanne :
BHSM ; 2019
Laisné N. Du massage, des frictions et manipulations appliquées
à la guérison de quelques maladies Paris : Victor
Masson et fils ; 1868
Murrell W. Massotherapeutics or Massage as a mode of treatment Philadelphia :
Blakiston, son & C° ; 1890
Monet J. La naissance de la kinésithérapie Paris :
Glyphe ; 2009
Petitdant B. Origines, histoire, évolutions de la mesure
de la force de préhension et des dynamomètres médicaux
Kinesither Rev 2017 ; 17(181) : 40-58
Petitdant B. Le goniomètre médical au fil du temps
Kinesither Rev 2016 ; 16(179) : 48-61
Amar J. Principes de rééducation fonctionnelle Académie
des sciences séance du 19 avril 1915 CR hebdo Sciences 1915 ;
160 : 559-62
Hoerni B La loi du 30 septembre 1892 Histoire des Scjences médicales
1998 ; 1(32) : 63-7
Quin G. Approche comparée des pratiques médicales
de »massage » et de « gymnastique »
à la fin du XIX ème siècle et au début
du XXème siècle (Angleterre, France, Allemagne, Suisse)
Histoire des sciences médicales 2014 ; 48(2) :
215-24
Monet J. Emergence de la Kinésithérapie en France
à la fin du XIXème et au début du XXème
siècle Thèse Doctorat Sociologie, Université
Paris I Panthéon-Sorbonne Juin 2003
Remondiere R. L'institution de la kinésithérapie en
France (1840-1946), Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques
12 | 1994, mis en ligne le 27 février 2009,
consulté le 10 décembre 2020. URL :
http://journals.openedition.org/ccrh/2753 ; DOI :
https://doi.org/10.4000/ccrh.2753
Ibid
Bourneville Dr Manuel pratique de la garde-malade et de l’infirmière
Paris : Progrès médical ; 1889
Lucas-Championnière J. Traitement des fractures par le massage
et la mobilisation Paris : Rueff et Cie ; 1895
Berne G. Le massage manuel théorique et pratique Paris :
Rueff et Cie ; 1894
Norström G. Formulaire du massage Paris : JB Baillière ;
1895
de Frumerie G. La pratique du massage. Cours à l’usage des
infirmiers et infirmières Vigot : Paris ; 1901
de Frumerie G. Cours de massage accessoire des soins d’accouchements
à donner aux femmes enceintes et parturientes aux nourrices
et nourrissons Vigot : Paris ; 1904
de Frumerie G. Le massage pour tous Indications et technique du
massage général Vigot : Paris ; 1917 2ème
éd.
de Frumerie G. Traitement manuel des déviations pathologiques
du rachis Vigot : Paris : 1924
de Frumerie G. La pratique du massage. Manuel à l’usage des
étudiants en médecine, des infirmiers et infirmières,
des candidats au diplôme de l’état de masseur et de
masseuse Vigot : Paris ; 1941
Remondiere R. L'institution de la kinésithérapie en
France (1840-1946), Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques
12 | 1994, mis en ligne le 27 février 2009,
consulté le 10 décembre 2020. URL :
http://journals.openedition.org/ccrh/2753 ; DOI :
https://doi.org/10.4000/ccrh.2753
Monet J. Emergence de la Kinésithérapie en France
à la fin du XIXème et au début du XXème
siècle Thèse Doctorat Sociologie, Université
Paris I Panthéon-Sorbonne Juin 2003
Remondière R. La mécanothérapie au temps de
la Grande Guerre Revue historique des armées [En ligne],
274 | 2014, mis en ligne le 18 juillet 2014, consulté
le 11 décembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/rha/7969
Busch F. General orthopaedics, gymnastics and massage in Von Ziemssen’s
handbook of general therapeutics vol.5 New-York : William Wood &
Co ; 1886
Pugh J. A physiological,
theoric and practical treatise on the utility of the science of
muscular action for restoring the power of the limbs London :
C. Dilly ; 1794
Barcklay J. The muscular motion of the human body Edinburgh :
W. Laing and A. Constable ; 1808
Cleoburey W. A full account of the system of friction, as adopted
and pursued with the greatest success in cases of contracted joints
and lameness, from various causes Oxford : Munday and Slatter ;
1825
Gibney J. A treatise on the properties and medical application of
the vapour bath: in its different varieties and their effects :
in various species of diseased action
London : Thomas and George Underwood ; 1829
Anonyme Immoral « massage » establishment
Br Med J 1894 ; 2: 88
Nicholls D.A., Cheek J. Physiotherapy and the shadow of prostitution:
the Society of Trained Masseuses and the scandals of 1894 Soc Science
Med 2006; 62 : 2336-48
http://www.csp.org.uk/frontline/article/foreign-fields-physiotherapy-during-first-world-war consulté le 15 décembre 2020
http://www.scarletfinders.co.uk/180.html consulté le 15 décembre 2020
Goldstone A.L. Massage as an orthodox medical treatment past and
future Complementary Ther Nursing Midwifery 2000 ;
6 : 169-71
Pfister G. Cultural confrontation: German Turnen, swedish gymnastics
and english sports- european diversity in physical activities from
a historical perspective Culture, Sport, Society 2003 ; 6(1) :
61-91
Georgii C. Kine´sithe´rapie ou Traitement des maladies
par le mouvement selon la méthode de Ling Paris : Germer
Baillière ; 1847
Pfister G. Cultural confrontation: German Turnen, swedish gymnastics
and english sports - european diversity in physical activities from
a historical perspective Culture, Sport, Society 2003 ; 6(1) :
61-91
de Genst H. Histoire de l'éducation physique, tome II. Temps
modernes et grands courants contemporains Bruxelles : A. de
Boeck ; 1949
Westberg J. Adjusting swedish gymnastics to the female nature: discrepancies
in the gendering of girls’ physical education in the mid-nineteenth
century Espacio, Tiempo y Educatión 2018 ; 5(1) :
261-79
Pfister G. Cultural confrontation: German Turnen, swedish gymnastics
and english sports - european diversity in physical activities from
a historical perspective Culture, Sport, Society 2003 ; 6(1) :
61-91
Ibid.
Georgii C. Kine´sithe´rapie ou Traitement des maladies
par le mouvement selon la méthode de Ling Paris : Germer
Baillière ; 1847
Kellgren A. Technique du traitement manuel suédois ( gymnastique
médicale suédoise) Paris : Maloine ; 1895
Göranssons Mekaniska Verkstadt : La gymnastique médico-mécanique
de Zander, ses principes, ses applications suivis de quelques indications
sur la création d’établissements gymniques d’après
cette méthode – Stockholm : Imprimerie royale, Norstedt
Zander G. : Notice sur la gymnastique de Zander et l’établissement
de gymnastique médicale mécanique suédoise
à Stockholm. Paris : Imprimerie A. Reiff ; 1879
Guyenot P. : La mécanothérapie à l’institut
Zander d’Aix les Bains. Aix les bains : Imprimerie Gérente ;
1904
Regnier L.R. La Mécanothérapie, application du mouvement
à la cure des maladies. Paris : J.P. Baillière ;1901
Wischnewetzky L. The mechanico-therapeutic institute. Contributions
to mechanico-therapeutics and orthopedics Vol 1, N°1, New-York,
Mechanico-therapeutic and orthopedic Zander, 1891
Hansson N., Ottosson A. Nobel price for physical therapy ?
Rise,fall and revival of medico-mechanical institutes Phys Ther
2015 ; 95(8) : 1184-94
Grafstrom A. V. A Text Book of Mechano-Therapy (Massage And Medical
Gymnastics) New-York : O.M.Foegri & Co ; 1898
Mcafee N.E. Massage : An Elementary Textbook For Nurses Pittsburgh :
Reed & Witting Co ; 1917
Calvert R.N. The history of massage An illustrated survey from around
the world Healing Arts Press : Rochester ; 2002
Latson W.R. Common disorders with rational methods of treatment
the Health Culture Company New-York 1904
Kellgren A. The technic of Ling’s system of manual treatment Edinburg
& London : Y.J. Pentland ; 1890
Terlouw T. Roots of physical medicine, physical therapy, and mechanotherapy
in the Nederlands in the 19th century : a disputed area within
the healcare domain J Man Manipul Ther 2007 ; (15)2 :
23-41
Tissot C.-J. Gymnastique médicinale et chirurgicale ou essai
sur l'utilité du mouvement ou des différents exercices
du corps et du repos dans la cure des maladies Paris : P.,
Bastien ; 1780
Amiot J. Mémoires concernant l’histoire, les sciences, les
arts, les mœurs et les usages des Chinois Tome 4 Paris : Nyon ;
1779
Abu ‘Ali al-Husayn ibn ‘Abd Allah ibn Sina dit Avicenne Avicennæ
Arabum Médicorum Principis Canon Medicinæ, d’après
la traduction latine de Gérard de Crémone Venise :
Juntas ; 1595
Marcireau J. La médecine physique secrets d’hier, techniques
d’aujourd’hui Paris : Le courrier du Livre ; 1965
Estradère J. Du massage, son historique, ses manipulations,
ses effets thérapeutiques. Paris Adrien Delahaye ; 1863
Estradère J. Du massage, son historique, ses manipulations,
ses effets thérapeutiques Paris : Adrien Delahaye ;
1863
Ibid
Ibid
Berne G. Manuel pratique de massage Paris : J.B. Baillière
et fils ; 1908
Petit L. Le massage par le médecin, physiologie, manuel opératoire,
indications Paris : Alexandre Coccoz ; 1885
Schreiber J. Traité pratique de massage et de gymnastique
médicale Paris : Octave Doin ; 1884
Laisné N. Du massage, des frictions et manipulations appliquées
à la guérison de quelques maladies Paris : Masson ;
1868
Brousses J. Manuel technique de massage Paris : Masson &
Cie ; 1920
Ibid.
Cecil T. Massage sèche London : Simpkin, Marshall &
Co ; 1888
Deville E. Considérations sur le massage et son application
dans l'entorse Thèse Médecine Strasbourg : Silbermann ;
1864
Estradère J. Du massage, son historique, ses manipulations,
ses effets thérapeutiques Paris : Adrien Delahaye ;
1863
Johnson W. The anatriptic art : a history of the art termed anatripsis
by Hippocrates, tripsis by Galen, frictio by Celsus, manipulation
by Beveridge, and medical rubbing in ordinary language, from the
earliest times to the present day : followed by an account of its
virtues in the cure of disease and maintenance of health, with illustrative
cases London : Simpkin, Marshall, & Co ; 1866
Ibid.
Cecil T. Massage sèche London : Simpkin : Marshall
& Co ; 1888
Natton Instruments et appareils de l’art médical Paris :
Imp Grandremy ; circa 1900
Coulon H. De l'usage des
strigiles dans l'antiquité. Mémoire lu le 18 avril
1895, au Congrès des Sociétés Savantes à
la Sorbonne Cambrai : Régnier ; 1895
Du Choul G. Des bains et de la palestre, Manuscrit rédigé
entre 1546 et 1547 au plus tard
Flashar Dr Apparate zur Massage Centralblatt für Chirurgie
1886 ; 43 :745-7
Estradère J. Du massage, son historique, ses manipulations,
ses effets thérapeutiques. Paris Adrien Delahaye ; 1863
Boyer A.B. Improvements in or relating to massage apparatus or roller.
Patent N°21123, date of application 22nd Oct., 1901, accepter
23rd Nov,1901 His Majesty’s stationery office : Malcomson &
C° Ltd ; 1901
Drapier Catalogue bandages herniaires, ceintures, bas pour varices,
accessoires Paris : 1911
Une société de Médecins et de chirurgiens Dictionnaire
des sciences médicales Article « Palette »
Tome 39 Paris : C.L.F. Panckoucke ; 1819
Estradère J. Du massage, son historique, ses manipulations,
ses effets thérapeutiques. Paris Adrien Delahaye ; 1863
Ibid.
Reveil O. Formulaire raisonné des médicaments nouveaux
Paris : J.B. Baillière ; 1864
Reibmayr A. Die Technik der Massage Leipzig & Wien : Franz
Deuticke ; 1892
Deville E. Considérations sur le massage et son application
dans l'entorse Thèse Médecine Strasbourg : Silbermann ;
1864
Estradère J. Du massage, son historique, ses manipulations,
ses effets thérapeutiques. Paris Adrien Delahaye ; 1863
Meibomius J.H. De l’utilité de la flagellation dans la médecine
et dans les plaisirs du mariage et des fonctions des lombes et des
reins Paris : Mercier ; 1795
Klein B. D’un usage curieux en médecine. Réflexions
sur « De l’utilité de la flagellation de
J.H. Meibom » Paris : Classiques Garnier ;
2016,
Ibid.
Rizet F. De la manière de pratiquer le massage dans l'entorse
Arras : A.Courtin ; 1864
Laisné N. Du massage, des frictions et manipulations appliquées
à la guérison de quelques maladies Paris : Masson ;
1868
Berne G. Le massage, manuel théorique et pratique Paris :
J.-B. Baillière et fils ; 1922
Eiger J. Zabludovski’s technik der massage Leipzig : Georg
Thieme ; 1911
Weber A.S. Traité de la massothérapie Masson :
Paris ; 1891
Krafft Ch. Le massage des contusions et des entorses fraîches
Lausanne : George Bridel & Cie ; 1895
Petit L. Le massage par le médecin, physiologie, manuel opératoire,
indications Paris : Alexandre Coccoz ; 1885
Reibmayr A. Die Massage und ihre Verwethung in den verschiedenen
Disciplinen der praktischen Medizin Wien : Toeplitz et Deuticke ;
1883
Reibmayr A. - Die Technik der Massage Wien : Toeplitz et Deuticke ;
1884
Reibmayr A. Die Technik der Massage Leipzig & Wien : Franz
Deuticke ; 1892
Petit L. Le massage par le médecin, physiologie, manuel opératoire,
indications Paris : Alexandre Coccoz ; 1885
Berne G. Le massage, manuel théorique et pratique Paris :
J.-B. Baillière et fils ; 1922
Flashar Dr Apparate zur Massage Centralblatt für Chirurgie
1886 ; 43 :745-7
Reibmayr A. Die Technik der Massage Leipzig & Wien : Franz
Deuticke ; 1892
Drapier Catalogue bandages herniaires, ceintures, bas pour varices,
accessoires Paris : 1911
Larousse P. Grand dictionnaire universel du XIXème siècle
tome2 Paris ; Larousse : 1867
Schreiber J. Traité pratique de massage et de gymnastique
médicale Paris : Doin ; 1884
Bum A. Mechanotherapie (Massage und Gymnastik) Wien :
Urban & Schwarzenberg ; 1893
Berne G. Le massage, manuel théorique et pratique Paris :
J.-B. Baillière et fils ; 1922
Reece and Co The catalogue of drugs, or medicine chest companion
London : The Medical Hall, ; 1846
Gower Ch. Auxiliaries to medicine in four tracts London : Hatchard ;
1819
Flashar Dr Apparate zur Massage Centralblatt für Chirurgie
1886 ; 43 :745-7
Estradère J. Du massage, son historique, ses manipulations,
ses effets thérapeutiques. Paris : Adrien Delahaye ;
1863
Bergman Dr. Le Visage et les soins à lui donner. Le massage
du visage "Récamier" d'après le célèbre système
H. Simons, L'art de rajeunir et d'embellir. Paris : La parfumerie
"Récamier" ; 1900
Drapier Catalogue bandages herniaires, ceintures, bas pour varices,
accessoires Paris : 1911
Bilz F.E. La nouvelle médication naturelle : traité
et aide-mémoire de médication et d'hygiène
naturelles Paris : F.E. Bilz ; 1899
Petitdant B. Des boules de massage. (article in press) Kinesither
Rev (2021), http://dx.doi.org/10.1016/j.kine.2021.02.006
Natton Instruments et appareils de l’art médical Paris :
Imprimerie Grandremy ; circa 1900
Reibmayr A. Die Technik der Massage Leipzig & Wien : Franz
Deuticke ; 1892
Lacy L.R. An improved massaging device Patent N° 393557, Application
date, March 25th.1933 – accepted June 8th.1933. His Majesty’s stationery
office, Love & Malcomson Ltd 1933
Bergman Dr Le visage et les soins à lui donner : le massage du
visage " Récamier " Paris : Parfumerie
Récamier ; 1900
Petitdant B. Massage et renforcement musculaire dans les années
1920 : une lanière à boules lisses couplée
à un tendeur de musculation Kinesither Rev 2019 ;20(219) :33-35
Milkman G.W. Combination massage roller and exerciser Patent N°681331,
application filed May 2, 1900, patented August 27, 1901. United
States Patent Office
Drapier Catalogue bandages herniaires, ceintures, bas pour varices,
accessoires Paris : Imprimerie Chantenay ; 1911
Catalogue Manufacture d’Armes et Cycles de St Etienne 1924 p. 193
Paris : Imprimerie Pigelet ; 1924
https://collection.sciencemuseumgroup.org.uk/objects/co140167/massager-germany-1880-1920-massager
https://www.bl.uk/business-and-ip-centre/articles/what-are-registered-designs
Fritze L.S. Massage instrument, Patent N°676604, application
filed March 19, 1900, patented June 18, 1901. United States Patent
Office
Petitdant B. L’appareil de massage de P. Semerak, pressions glissées
et percussions Kinesither Rev 2019;19(214):36–39
Semerak J. Improvements in massage and beating apparatus for the
human body. Patent 16362. Date of application, 27th July, 1898 –
Accepted 8th Oct., 1898. Printed for Her Majesty’s Stationery Office,
Malcomson & C° Ltd, 1898
Semerak J. Massage apparatus Patent N° 634590 dated October
10, 1899 United States Patent Office
Fleissner H. Massage apparatus Patent N° 520160 Convention Date
in Germany : Oct. 13, 1937, Application date in United Kingdom :
Oct. 13, 1938, Completed specification accepted April 16, 1940.
Leamington Spa His Majesty’s stationary office 1940
Piesen J. Improvements in or relating to massage apparatus Application
date Sept. 3, 1928. N° 296676, complete accepted Jan. 31, 1929.
His Majesty stationery office Love & Malcomson 1929.
Ibid.
Martin JP. L'Elektroller Clystère 2011;2:2–3 www.clystere.com.
Petitdant B. L'Élektroller, massage et électrothérapie
Kinesither Rev 2018;18(197):56–58
Seacombe B. Magneto-electric massaging machine Patent N° 12844,
date of application, 1st June, 1909 – Complete specification left,
1st Dec., 1909 – accepted 10 Mar., 1910. His Majesty stationery
office, Love & Malcomson, Ltd 1910
Thompson E. Improvements relating to magneto-electric machines for
massaging treatment Patent N° 223148, date of application :
April 3, 1924 – Complete accepted : Oct. 16. 1924 –. His Majesty
stationery office, Love & Malcomson, Ltd 1924
Thompson E. Perfectionnement aux appareils magnéto-électriques
pour le massage Brevet N° 579865 demandé le 7 avril 1924,
délivré le 14 août 1924, publié le 25
octobre 1924. Office national de la propriété industrielle.
Imprimerie nationale.
Petitdant B. Le régénérateur organique électromagnétique
« SANITAS » du Docteur Pion Clystère
www.clystere.com 2020 ; 70 : 30-37
de Lacroix de Lavalette L. La Sismothérapie ou l'utilisation
du mouvement vibratoire en médecine générale
et particulièrement en thérapeutique gynécologique
Thèse Médecine Paris 1899
Hartmann H. Gynécologie opératoire Paris : Steinheil ;
1911
Ibid.
Labadie-Lagrave F., Legueu F. Traité médico-chirurgical
de gynécologie Paris : Félix Alcan ; 1904
Kouindjy P. Précis de Kinésithérapie: La mobilisation
méthodique, la massothérapie, la mécanothérapie,
la rééducation, l'éducation physique Paris :
Maloine ; 1922
Régnier L.R. Mécanothérapie : Application
du mouvement à la cure des maladies J.B. Baillière :
Paris ; 1901
Marfort J.E. Manuel pratique de massage et de gymnastique médicale
suédoise Paris : Vigot ; 1907
Brousses J. Manuel technique de massage Paris : Masson &
Cie ; 1920
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Petitdant B. Le Vibrostat, appareil de massage vibratoire Clystère
www.clystere.com
2018 ; 63 : 4-16
Deutsche Reich, Reichpatentamt, Patenschrift N°328245 Vibrationsapparat,
Patentiert im Deutschem Reiche vom 7 Februar 1919
Deutsches Reich, Reichpatentamt, Patenschrift N°337035 Vibrationsapparat,
Patentiert im Deutschem Reiche vom 16 Oktober 1919
Deutsches Reich, Reichpatentamt, Patenschrift N°432591 Vibrationsapparat,
Patentiert im Deutschem Reiche vom 29 April 1925
Deutsches Reich, Reichpatentamt, Patenschrift N°337035 Vibrationsapparat,
Patentiert im Deutschem Reiche vom 16 Oktober 1919
Martin JP. Le Pulsoconn du Dr Macaura. Clystère 2013;19:14–8.
www.clystere.com.
Petitdant B. Le Docteur Macaura et son Pulsoconn, appareil de massage
vibratoire Kinesither Rev 2018;18(199):36–42
Macaura GJ. Vibrateur à action oscillatoire pour massage
et autres applications. Brevet No 439099, demandé le 18 janvier
1912, délivré le 29 mars 1912, publié le 5
juin 1912. Office nationale de la propriété industrielle.
Imprimerie Nationale.
Macaura GJ. Appareil pulsateur pour massage et autres applications.
Brevet No 439100, demandé le 18 janvier 1912, délivré
le 29 mars 1912, publié le 5 juin 1912. Office nationale
de la propriété industrielle. Imprimerie Nationale.
Ibid.
Macaura GJ. Improvements in and relating to vibrators for massage
or like treatments. Date of application 6th Jul 1905. Patent No.
13932 7th Sept 1905. His Majesty's Stationery Office. Love &
Malcomson
Garratt J.E. The Veedee and how to use it London : Veedee Company ;
sd
Katsch H. Haupt- Preisliste Fabrik chirurgischer Instrumente, Orthopädisher
Maschinen Bandagen und Verbandstoffe Munschen 1906
Petitdant B. Le VEEDEE, appareil à main pour le massage vibratoire
Clystère (www.clystere.com) 2019 ; 69 :14-23
Petitdant B. Docteur Johansen et les quarante brevets Clystère
(www.clystere.com) 2020 ;71 :9-19
Johansen J.C. Anordning til anbringelse af massagepelotter i vibratorer.
Danskt Patent N°10863. Patent udstedt den 12. Maj 1908, beskyttet
fra den 8 Juli 1907
Johansen J.C. Dispositif de réglage pour les pelotes de massage
dans les instruments vibratoires. Brevet d’invention N° 392106,
demandé le 7 juillet 1908, délivré le 16 septembre
1908, publié le 18 novembre 1908. Imprimerie Nationale
Petitdant B. Auto-vibrator du Docteur Johansen, New American Vibrator,
deux noms pour un même instrument de massage vibratoire Kinesither
Rev 2020 ;20(228) :33-6
Marfort J.E. Manuel pratique de massage et de gymnastique médicale
suédoise Paris : Vigot Frères ; 1907
Eiger J. Zabludovski’s technik der massage Leipzig : Georg
Thieme ; 1911
Wendschuch C. Haupt Katalog Ausgabe Dresden : Lehmannsche Buchdruckrei ;1910
Mortimer-Granville J. Nerve Vibration and excitation London :
J. & A. Churchill ; 1883
Rodeck C.G. Appareil de massage vibratoire à air comprimé
Brevet N° 463551 demandé le 11 octobre 1913, délivré
le 19 décembre 1913, publié le 26 février 1914.
Office national de la propriété industrielle. Imprimerie
nationale.
Sibrower F.C. Appareil pneumatique pour massage vibratoire Brevet
N° 782530 demandé le 22 août 1934, délivré
le 18 mars 1935, publié le 6 juin 1935. Office national de
la propriété industrielle. Imprimerie nationale.
Brichieri Comombi L., Zappulli 0., Romanelli L. Dispositif pneumatique
portatif pour massage vibratoire Brevet N° 835726 demandé
le 25 mars 1938, délivré le 3 octobre 1938, publié
le 29 décembre 1938. Office national de la propriété
industrielle. Imprimerie nationale.
Historical makers of microscopes and microscope slides http://microscopist.net consulté
le 29 janvier 2021
Berliner Adressbuch, https://digital.zlb.de consulté
le 29 janvier 2021
Ibid.
Sartori G. Device for mechanical skin treatment or massage, Patent
N°8726, date of application 27th Apr., 1901, accepted 9th Jan.
1902. Printed for His Majesty Stationery Office, Malcomson &
Co Ltd, 1902.
Sartori G. Für Betrieb mittelst eines gasförmigen Druckmittels
eingerichtete Massiervorrichtung Patent N° 22732 26 Juli 1901.
Schweizerische Eidgenossenschaft
Sartori G. Apparatus for massaging, Patent N°732897, application
filed August 14, 1902, patented July 7, 1903. United States Patent
Office.
Sartori G. Massiervorrichtung Österreichische patentschrift
N°17826 Angemeldet am 16. Juli 1902 – Beginn der Patentdauer :
15 April 1904. Kais. Königl. Patentamdt Ausgegeben am 10 OKtober
1904
Coliez G. La foire commerciale de Leipzig en 1928 Revue industrielle
1928 ; 74 :601
Duplaix A. Appareil de massage Brevet N° 488311 demandé
le 8 novembre 1917, délivré le 18 juin 1918, publié
le 20 septembre 1918. Office national de la propriété
industrielle. Imprimerie nationale.
Le Matin N° 12980 du 12 septembre 1919, page 4
Anonyme Revue de la publicité La Publicité 1919 ;140 :348
Brodart H. Catalogue illustré n° 10, Instruments de chirurgie,
orthopédie Paris ; 1934
Catalogue de l’exposition du 3ème congrès de Physiothérapie,
Paris 29 mars-2 avril 1910. Imprimerie Aragno, Paris.
Rainal Frères Catalogue général 1825-1934 Paris :
H.M. Boutin ; 1934
Mortimer-Granville J. Treatment
of pain by mechanical vibrations The Lancet 1881; 117(2999): 286-88
Mortimer-Granville J. Nerve Vibration as a therapeutic agent The
Lancet 1882 ; 119(3067) : 949-51
Mortimer-Granville J. Nerve Vibration and excitation London :
J. & A. Churchill ; 1883
Labadie-Lagrave F., Legueu F. Traité médico-chirurgical
de gynécologie Paris : Félix Alcan ; 1904
Annuaire du commerce Didot-Bottin 1921, Tome 3, Rue de l’Université,
Paris
Zalkind R.I. Appareil pour massage par tapotement, fonctionnant
à la main ou au moteur. Brevet d’invention N° 464586,
demandé le 22 octobre 1913, délivré le 16 janvier
1914, publié le 25 mars 1914. République Française.
Office national de la propriété industrielle
Zalkind R.I. Appareil électrique pour massage vibratoire.
Brevet d’invention N° 498484, demandé le 18 avril 1919,
délivré le 20 octobre 1919, publié le 13 janvier
1920. République Française. Office national de la
propriété industrielle.
Zalkind R.I. Appareil à massage vibratoire. Brevet d’invention
N° 502467, demandé le 9 août 1919, délivré
le 21 février 1920, publié le 15 mai 1920. République
Française. Office national de la propriété
industrielle
Zalkind R.I. Appareil électrique pour massage vibratoire.
Brevet d’invention N° 498484, demandé le 18 avril 1919,
délivré le 20 octobre 1919, publié le 13 janvier
1920. République Française. Office national de la
propriété industrielle.
Petitdant B. Un appareil français de massage vibratoire,
production d’Issak Robert Zalkind Kinesither Rev 2019 ; 19(216) :
60-3
https://brand-history.com/heinrich-simons-g-m-b-h-berlin-teltow/simo-vibrator/simo-vibrator-simo-vibrator-der-dauerhafteste-und-betriebssicherste-elektrische-hand-vibrator-unentbehrlich-fur-eine-erfolgreiche-schonheits consulté le 29 janvier 2021
Petitdant B. Un appareil électrique portatif de massage vibratoire
Rupalley et Cie Clystere 2017 ; 60 : 6-18
Labadie-Lagrave F., Legueu F. Traité médico-chirurgical
de gynécologie Paris : Félix Alcan ; 1904
Drapier Catalogue bandages herniaires, ceintures, bas pour varices,
accessoires Paris : 1911
Eiger J. Zabludovski’s technik der massage Leipzig : Georg
Thieme ; 1911
Ibid
Kouindjy P. Précis de Kinésithérapie: La mobilisation
méthodique, la massothérapie, la mécanothérapie,
la rééducation, l'éducation physique Paris :
Maloine ; 1922
Muschik E. Improvements in massage apparatus, Patent N°8461,
Date of application 9th Apr. 1898, accepted 16th July, 1898. Printed
for His Majesty Stationery Office, Malcomson Ltd, 1898.
Muschik E. Massage device, Patent N°636163, application filed
June 6, 1898, patented October 31, 1899. United States Patent Office
Muschik E. Massage-apparat, Patentschrift N°17778, 22. September
1898 Schweizeriche Eidgenossenschaft.
Muschik E. Massageapparat. Danskt Patent N°1898. Patent udstedt
den 28. Oktober 1898, beskyttet fra den 17 Marts 1899
Anonyme Un nouvel appareil pour le massage vibratoire L’Illustration
28 janvier 1939.
Drapier Catalogue bandages herniaires, ceintures, bas pour varices,
accessoires Paris : 1911
Ibid.
Petitdant B. Des boules de massage. (article in press) Kinesither
Rev (2021), http://dx.doi.org/10.1016/j.kine.2021.02.006
Reibmayr A. Die Technik der Massage Leipzig & Wien : Franz
Deuticke ; 1892
Anonyme La médecine qui guérit : les panacées
authentiques, les remèdes infaillibles. Paris : Institut
Biothérapic-Alexia ; sd
Siffermann Dr. L’œil humain et ses anomalies fonctionnelles guéries
par le massage avec l’appareil Dion Strasbourg : F. Staat ;
1899
Dion Ch., Goubaux Y. Appareil pour le traitement des altérations
de la vue Brevet N° 13073 - 20 août 1896 Bureau fédéral
de la propriété intellectuelle
Dion Ch. Improvements in apparatus for the massage of the eyes for
the cure of myopy, Patent N°10101, Date of application 4th May.
1903, accepted 18th feb, 1904. Printed for His Majesty Stationery
Office, Love & Malcomson Ltd, 1904
Dion Ch. Système d’appareil perfectionné pour la gymnastique
rationnelle des yeux, pour la guérison de la myopie et les
altérations de la vue Brevet N° 342985 demandé
le 7 mai 1904, délivré le 23 juillet 1904, publié
le 22 septembre 1904. Office National de la Propriété
Industrielle.
Siffermann Dr. L’œil humain et ses anomalies fonctionnelles guéries
par le massage avec l’appareil Dion Strasbourg : F. Staat ;
1899
Lacy L.R. Improved apparatus for massaging the eyes Patent N°
363101, Application date, Nov 20th.1930 – Complete left, Aug 20th.1931
– accepted Dec 17th.1931. His Majesty’s stationery office, Love
& Malcomson, Ltd 1932
Lacy L.R. Improved apparatus for massaging the eyes Patent N°
434927, Application date, March 26th.1935 – accepted Sept 11th.1935.
His Majesty’s stationery office, Courier Press 1935
Peytoureau Dr. Manuel de face-massage Paris : Editions Hygie ;
1936
Ibid.
Ibid.
Stumm M. Appareil pneumatique pour massage facial Brevet N°
641449 demandé le 3 septembre 1927, délivré
le 16 avril 1928, publié le 3 août 1928. Office national
de la propriété industrielle. Imprimerie nationale.
Peytoureau Dr. Manuel de face-massage Paris : Editions Hygie ;
1936
Goetze M., Simons H. Massageapparat mit versetzt angeorducten cylindrischen
Walzen, Patentschrift N°9924, 28. Januar 1895 Schweizeriche
Eidgenossenschaft.
Simons H. Massageapparat mit cylindrischer Walze, Patentschrift
N°10625, 29. Juni 1895 Schweizeriche Eidgenossenschaft.
Simons H. Massageapparat mit kugelförmigen Massagerollen, Patentschrift
N°10626, 29. Juni 1895 Schweizeriche Eidgenossenschaft
Simons H. Mit einem daumenartigen und einem konischen Ende versehene
Massagevorrichtung, Patentschrift N°10702, 29. Juni 1895 Schweizeriche
Eidgenossenschaft
Petitdant B. Un coffret d'instruments de massage du XIXe siècle
de Heinrich Simons Kinesither Rev 2019;19(206):35-42
Bergman Dr. Le visage et les soins à lui donner Le massage
du visage "Récamier'' d'après le célèbre
système H. Simons, L'art de rajeunir et d'embellir Paris
: La parfumerie "Récamier''; 1900.
Lehmstedt P. Improvements in and relating to massage apparatus Patent
N° 6627, date of application, 18th Mar., 1902 – Complete specification
left, 22nd Nov., 1902 – accepted 5th Feb., 1903. His Majesty stationery
office, Love & Malcomson, Ltd 1903
Lloyd W., Loder W. An improved shaving appliance Patent N° 27348,
date of application, 1st Dec., 1906 – Complete specification left,
12th Apr., 1907 – accepted 13th June 1907. His Majesty stationery
office, Love & Malcomson, Ltd 1907
Peytoureau Dr. Manuel de face-massage Paris : Editions Hygie ;
1936
Lloyd W., Loder W. An improved device for applying preparations
to the skin Patent N° 19350, date of application, 28th Aug.,
1907 – accepted 7th Nov. 1907. His Majesty stationery office, Love
& Malcomson, Ltd 1907
Göranssons Mekaniska Verkstadt La gymnastique médico-mécanique
de Zander, ses principes, ses applications suivis de quelques indications
sur la création d’établissements gymniques d’après
cette méthode Stockholm : Imprimerie royale, Norstedt
et Söner ; 1896
Zander G. Notice sur la gymnastique de Zander et l’établissement
de gymnastique médicale mécanique suédoise
à Stockholm. Paris, Imprimerie A. Reiff, 1879
Guyenot P. : La mécanothérapie à l’institut
Zander d’Aix les Bains. Aix les bains : Imprimerie Gérente ;
1904
Göranssons Mekaniska Verkstadt La gymnastique médico-mécanique
de Zander, ses principes, ses applications suivis de quelques indications
sur la création d’établissements gymniques d’après
cette méthode Stockholm : Imprimerie royale, Norstedt
et Söner ; 1896
Wischnewetzky L. The mechanico-therapeutic institute. Contributions
to mechanico-therapeutics and orthopedics Vol 1, N°1, New-York :
Mechanico-therapeutic and orthopedic Zander ; 1891
Régnier L.R.: La Mécanothérapie, application
du mouvement à la cure des maladies. Paris : J.P. Baillière ;
1901
Ibid.
Fallen C. : The Zander institute for mechanico-therapeutics
or swedish movements and massage by machinery. New-York : circa
1890
Régnier L.R.: La Mécanothérapie, application
du mouvement à la cure des maladies. Paris : J.P. Baillière ;
1901
Fallen C. : The Zander institute for mechanico-therapeutics
or swedish movements and massage by machinery. New-York : circa
1890
Régnier L.R.: La Mécanothérapie, application
du mouvement à la cure des maladies. Paris : J.P. Baillière ;
1901
Göranssons Mekaniska Verkstadt La gymnastique médico-mécanique
de Zander, ses principes, ses applications suivis de quelques indications
sur la création d’établissements gymniques d’après
cette méthode Stockholm : Imprimerie royale, Norstedt
et Söner ; 1896
Zander G. Notice sur la gymnastique de Zander et l’établissement
de gymnastique médicale mécanique suédoise
à Stockholm. Paris : Imprimerie A. Reiff ; 1879
Guyenot P. : La mécanothérapie à l’institut
Zander d’Aix les Bains. Aix les Bains : Imprimerie Gérente ;
1904
Wischnewetzky L. The mechanico-therapeutic institute. Contributions
to mechanico-therapeutics and orthopedics Vol 1, N°1, New-York :
Mechanico-therapeutic and orthopedic Zander ; 1891
Petitdant B. Les appareils de mécanothérapie de Zander
Clystère 2015 ; 36 : 13-33
Ibid.
Régnier L.R.: La Mécanothérapie, application
du mouvement à la cure des maladies. Paris : J.P. Baillière ;
1901
Ibid.
Ibid .
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid
Dupont Lits, fauteuils, voitures et appareils mécaniques
pour malades et bléssés. Harambat : Paris ;
circa 1925
Gilles de La Tourette G. Considérations sur la médecine
vibratoire, ses applications et sa technique Nouvelle Iconographie
de la Salpêtrière 1892 ; 5 : 265-75
Loi n°46-857 du 30 avril 1946 Réglementation des professions
de masseur gymnaste médical, de masseur kinésithérapeute
et de pédicure Journal officiel de la République Française
1 mai 1946 p 3653
Macron A. La profession de masseur-kinésithérapeute
instituée par la loi n°46-857 du 30 avril 1946 genèse
et évolutions d’une profession de santé réglementée.
Thèse Faculté de Droit, Université de Montpellier
2015 |
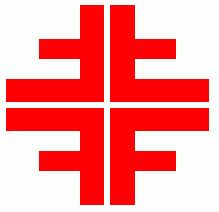
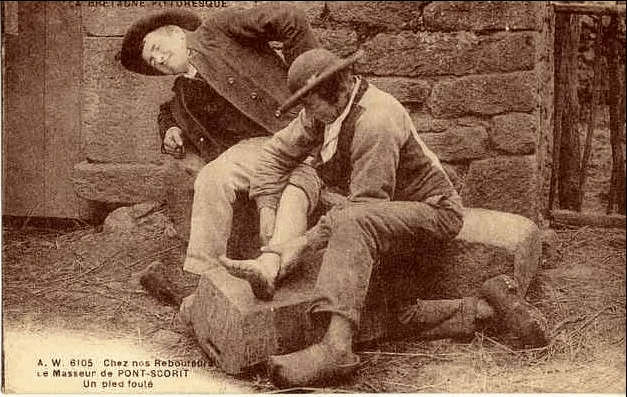

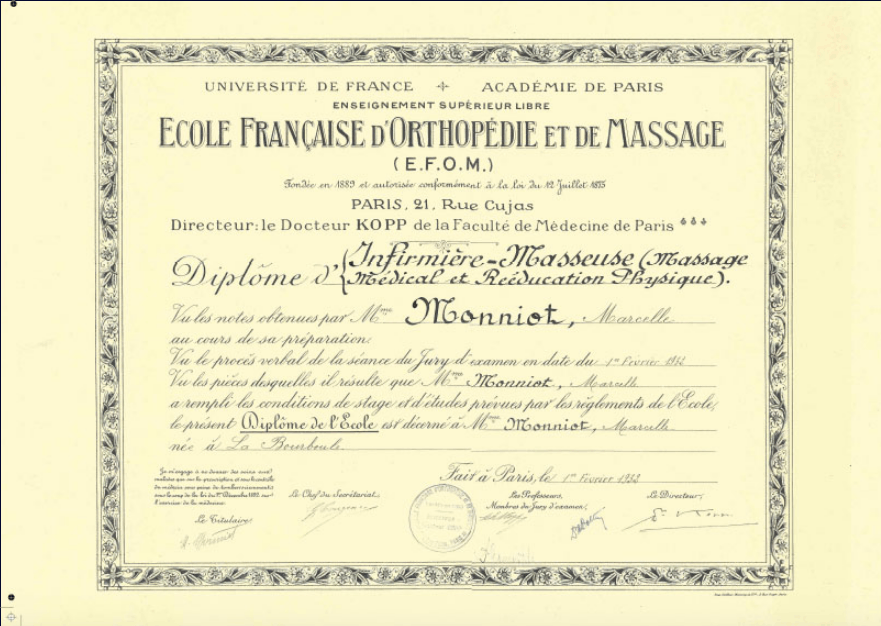
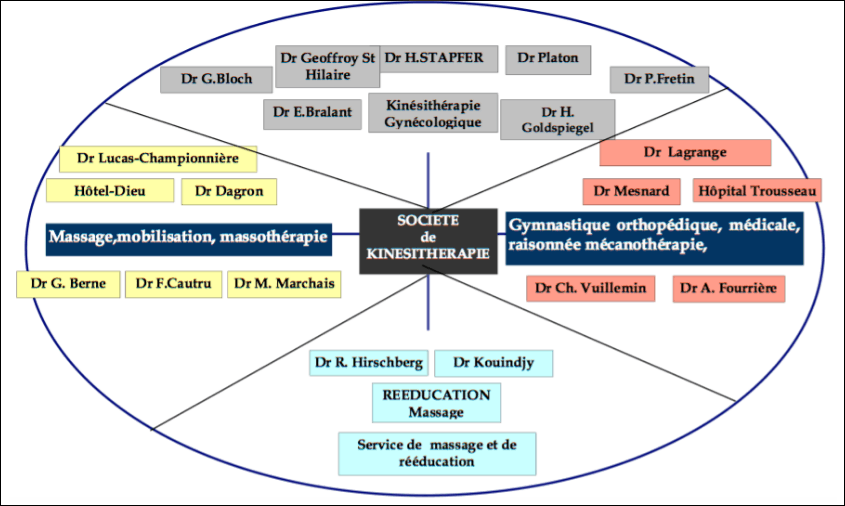



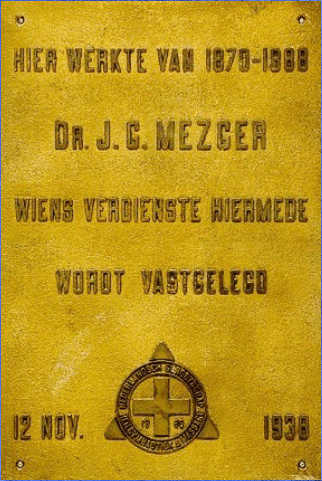
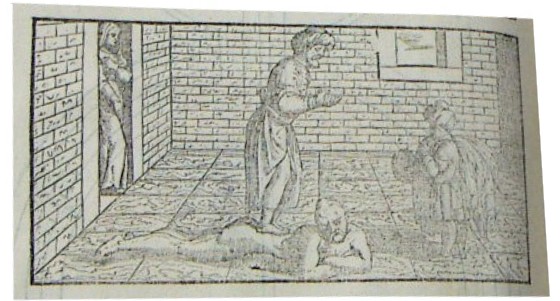
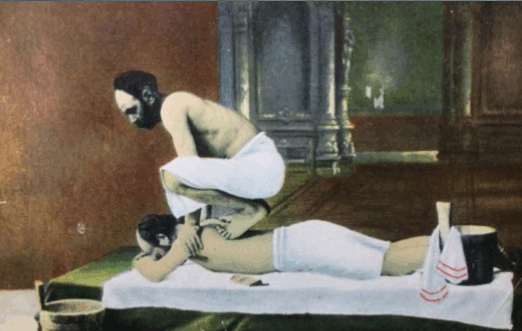
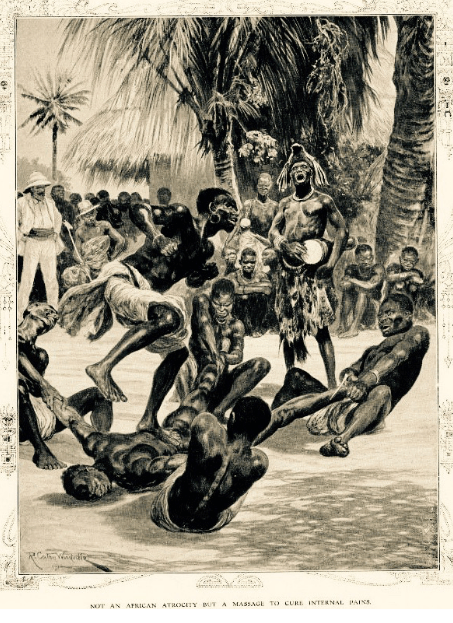
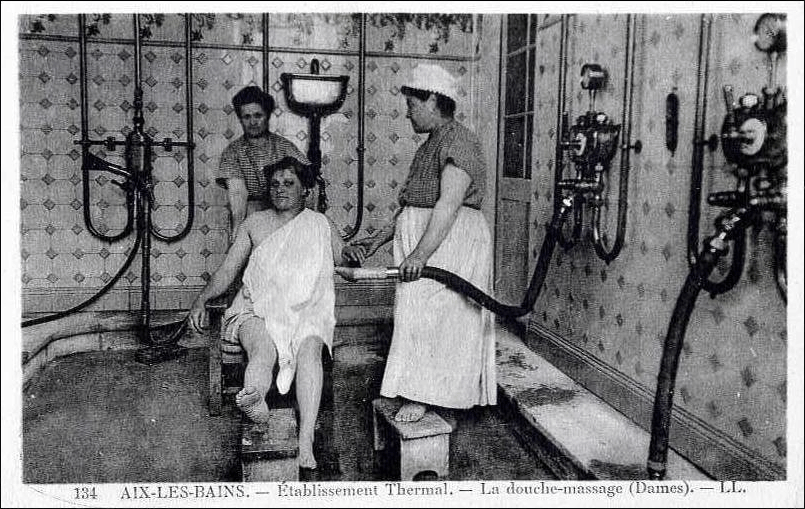
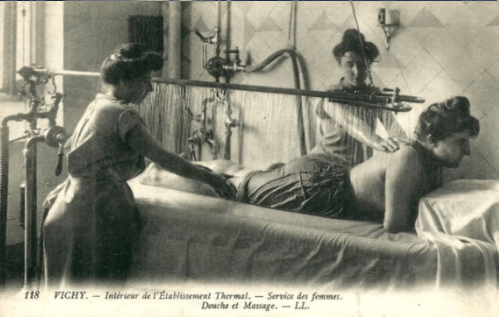
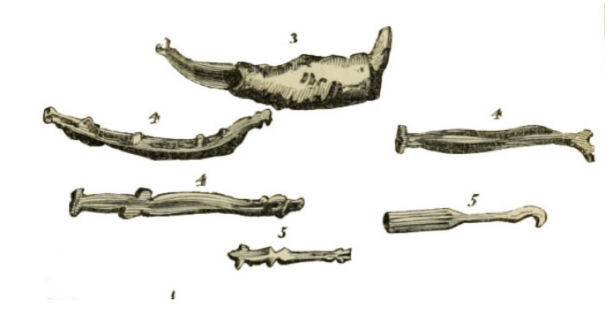

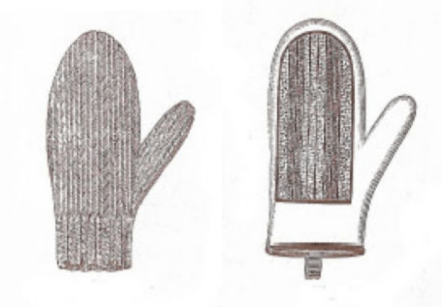

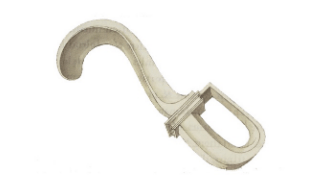
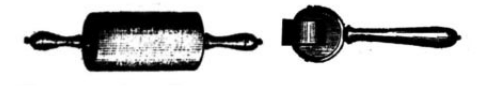
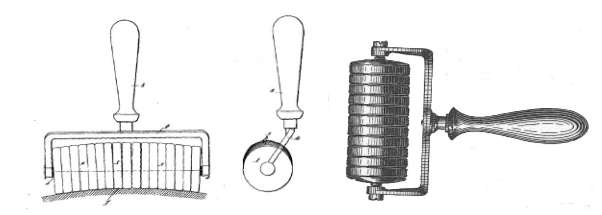
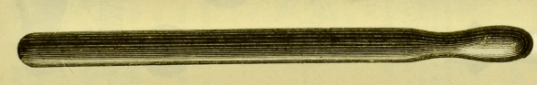

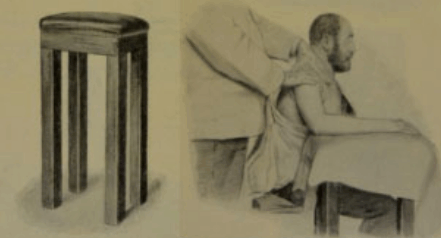
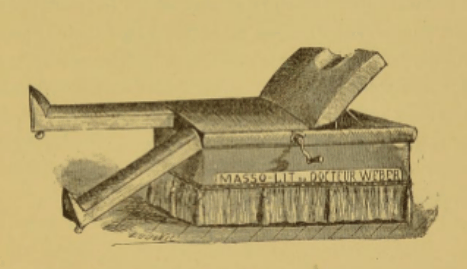
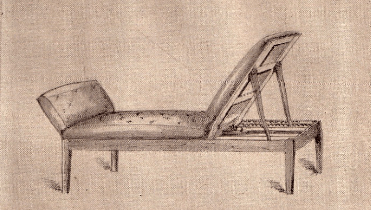
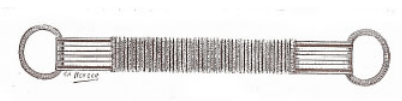
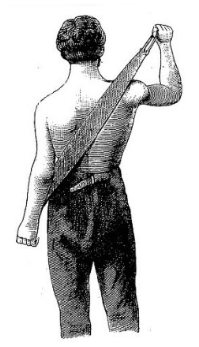
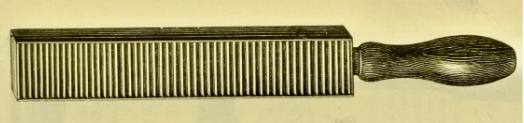
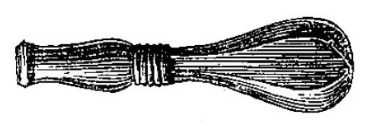
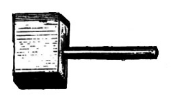
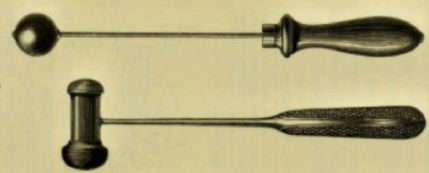
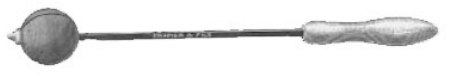
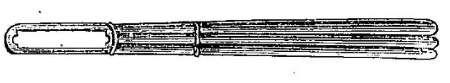
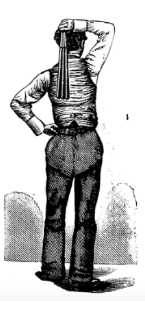
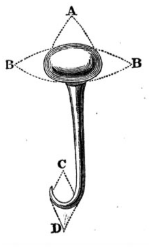
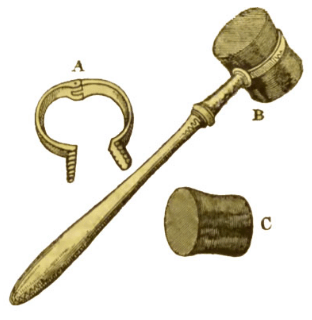
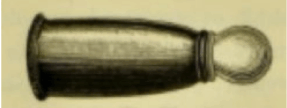

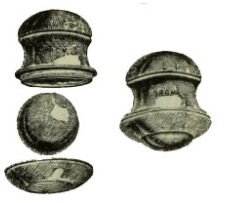

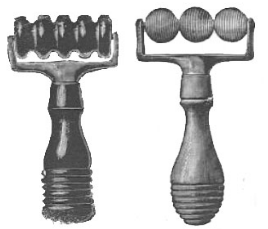
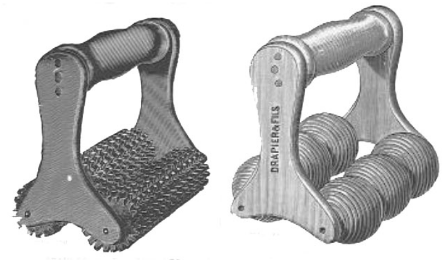
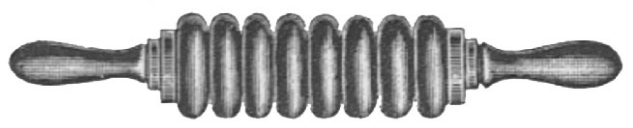


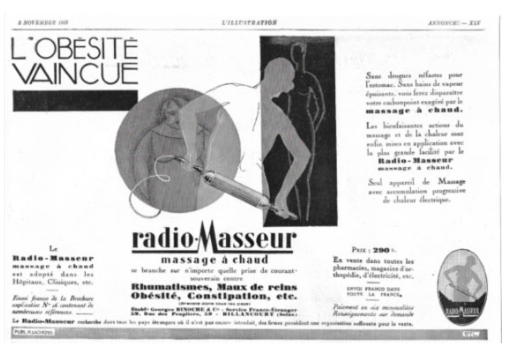
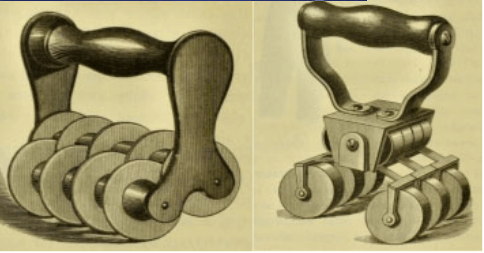
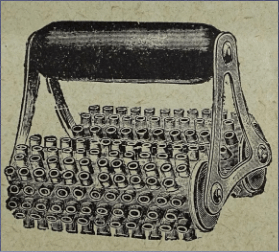


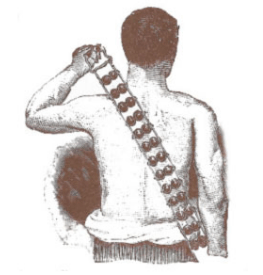
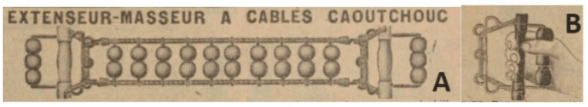






 Voir la fiche du CFRM
Voir la fiche du CFRM