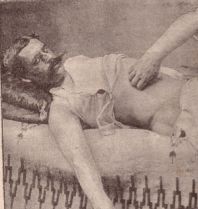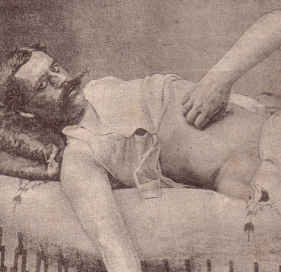Lettre K
Ka,  un des cinq éléments indissociables
composant l'être de son vivant pour les anciens Égyptiens : le
double spirituel qui naît en même temps que l'humain
et qui survit après la mort. Il représente la procréation
et la force transmise d'une génération à l'autre.
Les autres éléments sont le djet
un des cinq éléments indissociables
composant l'être de son vivant pour les anciens Égyptiens : le
double spirituel qui naît en même temps que l'humain
et qui survit après la mort. Il représente la procréation
et la force transmise d'une génération à l'autre.
Les autres éléments sont le djet  (le corps), le bâ
(le corps), le bâ  , improprement
traduit par âme, shout , improprement
traduit par âme, shout  , l'ombre, et
le nom, le ren , l'ombre, et
le nom, le ren  . Après
la mort, le ka est considéré comme le véritable
représentant de la personnalité humaine. Selon les
croyances égyptiennes, il faut conserver le corps afin que
le ka puisse en reprendre possession autant qu'il le souhaite ;
une statue à l'effigie du mort permet au ka de retrouver
les traits sous lesquels il était jadis incarné. Le
ka est souvent représenté par un homme portant deux
bras en opposition sur la tête et situé derrière
le personnage. Ce type de représentation concerne surtout
le pharaon car il est le seul à avoir son ka avec lui sur
Terre. Pour tous les autres, le ka reste dans l'autre monde. Mourir
se dit d'ailleurs « passer à son ka »
ou « rejoindre son ka ». . Après
la mort, le ka est considéré comme le véritable
représentant de la personnalité humaine. Selon les
croyances égyptiennes, il faut conserver le corps afin que
le ka puisse en reprendre possession autant qu'il le souhaite ;
une statue à l'effigie du mort permet au ka de retrouver
les traits sous lesquels il était jadis incarné. Le
ka est souvent représenté par un homme portant deux
bras en opposition sur la tête et situé derrière
le personnage. Ce type de représentation concerne surtout
le pharaon car il est le seul à avoir son ka avec lui sur
Terre. Pour tous les autres, le ka reste dans l'autre monde. Mourir
se dit d'ailleurs « passer à son ka »
ou « rejoindre son ka ».
 Kalaripayat, ou Kalarippayatt, Kalaripayat, ou Kalarippayatt,  art martial originaire du Kerala art martial originaire du Kerala  en Inde du Sud. Kalarippayatt signifie,
en malayalam, « le lieu des exercices », de
kalari, le lieu, l'arène, l'espace
de dialogue et payatt, dérivé de « payattuka »
signifiant combattre, s'exercer, s'exercer intensément. Le
kalarippayatt serait, avec le Varma Kalai
en Inde du Sud. Kalarippayatt signifie,
en malayalam, « le lieu des exercices », de
kalari, le lieu, l'arène, l'espace
de dialogue et payatt, dérivé de « payattuka »
signifiant combattre, s'exercer, s'exercer intensément. Le
kalarippayatt serait, avec le Varma Kalai  originaire de l'État
voisin du Tamil Nadu, l'une des plus anciennes techniques martiales
et mais aussi médicales connues. Les gurû de kalarippayatt,
appelés gurukkal, sont guerriers et médecins, car
ils sont censés connaître les techniques qui tuent
mais aussi celles qui soignent. Les danseurs de kathakali exercent
aussi leur art dans un espace consacré nommé kalari
et leur entraînement emprunte des exercices au kalarippayatt,
comme les quatre sortes de lancers de jambes (kalugal) mais aussi
ses techniques de massages liées à l'ayurveda.
originaire de l'État
voisin du Tamil Nadu, l'une des plus anciennes techniques martiales
et mais aussi médicales connues. Les gurû de kalarippayatt,
appelés gurukkal, sont guerriers et médecins, car
ils sont censés connaître les techniques qui tuent
mais aussi celles qui soignent. Les danseurs de kathakali exercent
aussi leur art dans un espace consacré nommé kalari
et leur entraînement emprunte des exercices au kalarippayatt,
comme les quatre sortes de lancers de jambes (kalugal) mais aussi
ses techniques de massages liées à l'ayurveda.
Livres associés : Le kalaripayat par Bindra Tiego Ed. Belles Lettres, 2005  (avec une entrée sur le massage par les pieds).
(avec une entrée sur le massage par les pieds).
Kamasutra,
Kamasutra.
 Kampo, Kampo,  (Kanpo igaku), aussi appelée plus simplement le Kampo, est une science japonaise
dérivée de la médecine traditionnelle chinoise.
Les principes fondamentaux de la médecine chinoise sont apparus
au Japon entre le VIIe
et le IXe siècle. Depuis, les japonais se sont véritablement
appropriés cette science pour créer leur propre médecine
à base de plantes. Le Kampo a de nombreux points communs
avec la Médecine
traditionnelle chinoise,
dont l’acupuncture et la moxibustion, mais repose principalement sur l’usage
des plantes. (Kanpo igaku), aussi appelée plus simplement le Kampo, est une science japonaise
dérivée de la médecine traditionnelle chinoise.
Les principes fondamentaux de la médecine chinoise sont apparus
au Japon entre le VIIe
et le IXe siècle. Depuis, les japonais se sont véritablement
appropriés cette science pour créer leur propre médecine
à base de plantes. Le Kampo a de nombreux points communs
avec la Médecine
traditionnelle chinoise,
dont l’acupuncture et la moxibustion, mais repose principalement sur l’usage
des plantes.
Kansu
 Kansu, ou massage au bol Kansu,
de son nom Kansa Vati, appartient à l’Ayurveda
est constitué d’un alliage de cuivre, de zinc
et de bronze. Kansu, ou massage au bol Kansu,
de son nom Kansa Vati, appartient à l’Ayurveda
est constitué d’un alliage de cuivre, de zinc
et de bronze.
Le cuivre, le plus conducteur, selon
cette technique, absorberait l'excès de chaleur
dans le corps et réduirait la graisse (Meddha
dhathu), en la remplaçant par du muscle (Mensa
dhathu). Le zinc oeuvre au niveau du tissu musculaire
(Mensa dhathu). Le bronze agirait comme catalyseur des
deux métaux.
Ce bol est utilisé en
association avec du ghee (beurre clarifié)
pour effectuer un massage de la plante des pieds
ou des paumes des
mains pour
équilibrer l'élément Pita (feu)
et donc rétabli le sommeil, évacuer le
stress, la nervosité, donner une grande sensation
de calme et améliorer le métabolisme en
général. Voir massage sonore ; Massages à onguents traditionnels.
|
 Kassal, mot d'origine
arabe qui signifie littéralement,
détendeur ou celui qui
permet de se détendre
et par association peut donc être lié à celui
de masseur,
de laveur. En effet celui-ci propose un
genre d'étirement parfois violent pour les personnes qui
n'en ont pas l'habitude et seulement après cela il frotte
la peau avec le gant
de kessa et le savon noir. Kassal, mot d'origine
arabe qui signifie littéralement,
détendeur ou celui qui
permet de se détendre
et par association peut donc être lié à celui
de masseur,
de laveur. En effet celui-ci propose un
genre d'étirement parfois violent pour les personnes qui
n'en ont pas l'habitude et seulement après cela il frotte
la peau avec le gant
de kessa et le savon noir.
 Kata, il n’existe pas de traduction littérale de ce
terme que l'on peut comprendre comme « la manière de
faire dans les règle de l'art quelque chose qui est accomplie
». Dans les arts martiaux les Katas sont des séquences
de mouvements de défense et d’attaque effectués jusqu’à
ce qu’ils deviennent automatiques. Au Japon, les Katas sont utilisés
dans toutes les formes d’art, comme la peinture, le théâtre,
les arrangements moraux, la cérémonie du thé
ainsi que les arts martiaux. Néanmoins, le terme «
Kata » à une signification plus large dans la culture
japonaise qui attache beaucoup d’importance à la manière
correcte de faire les choses au quotidiens. Syn. occidentalisable
: Ductus, déroulé
technique, modelé. Kata, il n’existe pas de traduction littérale de ce
terme que l'on peut comprendre comme « la manière de
faire dans les règle de l'art quelque chose qui est accomplie
». Dans les arts martiaux les Katas sont des séquences
de mouvements de défense et d’attaque effectués jusqu’à
ce qu’ils deviennent automatiques. Au Japon, les Katas sont utilisés
dans toutes les formes d’art, comme la peinture, le théâtre,
les arrangements moraux, la cérémonie du thé
ainsi que les arts martiaux. Néanmoins, le terme «
Kata » à une signification plus large dans la culture
japonaise qui attache beaucoup d’importance à la manière
correcte de faire les choses au quotidiens. Syn. occidentalisable
: Ductus, déroulé
technique, modelé.
Il semble que ce soit Tony
Neuman, qui l'ait utilisé le premier
en massage afin d’honorer la longue histoire du massage
japonais.
Kellak,
Tellaks,
Dellak/Dalek, voir aussi Tekssal
sont des garçons
de bain différemment écrit selon les
localisation, les époques et les auteurs.
– Gustave
Flaubert, parlant de son voyage en Égypte
écrit « C’est aux bains
que cela se pratique. On retient le bain pour soi (cinq francs),
y compris les masseurs, la pipe,
le café, le linge
et on enfile [sodomie]
son gamin dans une des salles. Tu sauras
du reste que tous les garçons
de bain sont bardaches  [homosexuel]. Les derniers masseurs,
ceux qui viennent vous frotter
quand tout est fini sont ordinairement de jeunes garçons
assez gentils. » ou encore « Ce jour-là, mon
Kellak
me frottait doucement, quand, étant arrivé
aux parties nobles, il a retroussé mes boules d'amour pour
me les nettoyer,
puis continuant à me frotter la poitrine de la main
gauche il s'est mis à tirer sur mon vit et le polluant par
un mouvement de traction [masturbation],
s'est penché sur mon épaule en me répétant
: batchis, batchis (pourboire, pourboire)... » [homosexuel]. Les derniers masseurs,
ceux qui viennent vous frotter
quand tout est fini sont ordinairement de jeunes garçons
assez gentils. » ou encore « Ce jour-là, mon
Kellak
me frottait doucement, quand, étant arrivé
aux parties nobles, il a retroussé mes boules d'amour pour
me les nettoyer,
puis continuant à me frotter la poitrine de la main
gauche il s'est mis à tirer sur mon vit et le polluant par
un mouvement de traction [masturbation],
s'est penché sur mon épaule en me répétant
: batchis, batchis (pourboire, pourboire)... »
Kéfir,
 (anc. Képhir)
est une boisson issue de la fermentation
du lait
ou de jus de fruits sucrés, préparés à
l’aide de « grains de kéfir », un levain
constitué essentiellement de bactéries lactiques et
de levures. La boisson obtenue est légèrement
gazeuse. En tant qu'aliment vivant, fournissant certains oligoéléments
et micro-organismes, il est considéré comme un probiotique
et utilisé pour ses propriétés diététiques
(flore intestinale, transit, système immunitaire, etc.).
Il contient un peu d'alcool en quantité très
faible comparé aux fermentations les plus courantes, le degré
alcoolique se situe à moins de 1 %, souvent aux alentours
de 0,5 %.
(anc. Képhir)
est une boisson issue de la fermentation
du lait
ou de jus de fruits sucrés, préparés à
l’aide de « grains de kéfir », un levain
constitué essentiellement de bactéries lactiques et
de levures. La boisson obtenue est légèrement
gazeuse. En tant qu'aliment vivant, fournissant certains oligoéléments
et micro-organismes, il est considéré comme un probiotique
et utilisé pour ses propriétés diététiques
(flore intestinale, transit, système immunitaire, etc.).
Il contient un peu d'alcool en quantité très
faible comparé aux fermentations les plus courantes, le degré
alcoolique se situe à moins de 1 %, souvent aux alentours
de 0,5 %.
Kesi Technique de tissage
chinoise utilisant le fil de soie. Sur le métier, la chaîne
"|||||" est tendue horizontalement. Les duites, sont les
fils que les navettes vont passer dessus/dessous afin de composer
le motif. Dans le cas du Kesi, deux fils de couleur différentes
sur le même alignement ne sont pas liés ensemble de
sorte qu'on voit de petites fentes dans les contours du dessin.
Sa fragilité nécessite que le Kesi reste suspendu
verticalement, dans le sens de la chaîne. Le tissage de soie
Kesi est une technique ancienne de tissage de la soie de Suzhou.
Il existe surtout à Suzhou et dans ses environs. Le tissage
de soie Kesi exige un métier à tisser en bois et des
navettes et plectres en bambou. Par la technique « Tongjingduanwei
»( faire passer le fil de chaîne et couper le fil de
trame), les fils de soie de couleurs différentes sont tissés
en un textile de toutes les échelles de couleurs. C’est un
textile à double face, dont le motif reste le même
à l’envers et à l’endroit. Au contour du motif et
là où il y a des variations d’échelle de couleurs,
la surface du textile présente des creux ou fêlures,
comme découpée par un petit couteau. D’où l’appellation
Kesi, qui veut dire en chinois soie sculptée.
L’industrie
de soie Kesi s’est beaucoup développée sous les Song
du sud. Et depuis les Ming, la soie Kesi était très
populaire à Suzhou et dans les villes aux alentours telles
que Likou, Lumu, Huangqiao, Guangfu, Dongzhu, et est devenue une
des formes d’expression culturelle les plus représentatives
de cette région. Sous les Ming, le tissage de la soie Kesi
s’est perfectionné et il est surtout renommé pour
ses robes impériales au motif de dragon et les peintures
de portrait en soie Kesi. Sous les Qing, le tissage de soie Kesi
s’est encore rénové en s’inspirant de techniques de
la peinture.
Le musée du CFDRM possède ainsi une pièce de soie chinoise
du 19ème siècle représentant
un massage
des pieds tissé et brodé selon la technique du kési. Voir.
khi deux,  ou
« chi carré ») permet, partant d'une
hypothèse et d'un risque supposé au départ,
de rejeter l'hypothèse si la distance entre deux ensembles
d'informations est jugée excessive. ou
« chi carré ») permet, partant d'une
hypothèse et d'un risque supposé au départ,
de rejeter l'hypothèse si la distance entre deux ensembles
d'informations est jugée excessive.
 Ki, ou Qi ou encore chi, énergie vitale. Ki, ou Qi ou encore chi, énergie vitale.
 Kiass, terme possiblement vernaculaire
d'origine maghrébine
qui désignerait un masseur
dans un beyt
skhoun
(étuve) que nous retrouvons dans
deux textes algérien Kiass, terme possiblement vernaculaire
d'origine maghrébine
qui désignerait un masseur
dans un beyt
skhoun
(étuve) que nous retrouvons dans
deux textes algérien  en ce 7 août
2018 mis en ligne en 2013 : "-Eh ! conduit-moi jusqu’au
Beyt eskhoun (l'étuve)
je ne sait pas marcher sur ce bois ! en appelant le Kiass (Le masseur)". en ce 7 août
2018 mis en ligne en 2013 : "-Eh ! conduit-moi jusqu’au
Beyt eskhoun (l'étuve)
je ne sait pas marcher sur ce bois ! en appelant le Kiass (Le masseur)".
Kiyassette,
nous plaçons ce vocable à la suite de kiass
comme son féminin possible au regard de la proximité
lexicale qu'il entretient avec lui. Dans un texte de judaicalgeria.com
nous lisons  : "Il y aussi les kiyassettes
des femmes qui nous massent et nous lavent le dos et qu'on
paye. Et chez les hommes ils les appellent les moutchous.". : "Il y aussi les kiyassettes
des femmes qui nous massent et nous lavent le dos et qu'on
paye. Et chez les hommes ils les appellent les moutchous.".
 kidding-massage méthode mise au point par Gilles
Orgeret pour le Massage
du bébé par le grand
public. Fait partie Panthéon
du massage du CFDRM. kidding-massage méthode mise au point par Gilles
Orgeret pour le Massage
du bébé par le grand
public. Fait partie Panthéon
du massage du CFDRM.
 Kinésiâtrique, des grecs et de celle des Tao-Ssé.... Dally dit dans Cinésiologie de 1857 TDM Kinésiâtrique, des grecs et de celle des Tao-Ssé.... Dally dit dans Cinésiologie de 1857 TDM  page 84. A définir plus justement.
page 84. A définir plus justement.
Kinésie, (source : http://ccrh.revues.org), La racine sémantique la mieux adaptée
et la plus convoitée, parce que la plus représentative
de la nouveauté technologique est « kinésie »,
qui donnera « kinésique » en 1900.
Si le mot « kinésithérapie »
est, à cette époque, encore peu employé, sa
première utilisation dans le titre d'une thèse date
de 1895 et ses dérivés francisés par substitution
du « k » en « c », « cinésithérapie »
et « cinésiologie », ont nettement moins de succès par
la suite.
 Kinésiologie, Kinésiologie,  Terme issu du grec kinêsis : mouvement. Introduit
aux États-Unis en 1886 par le baron suédois Nils Posse (1862-1895).
Il existe plusieurs formes de "kinésiologie", selon
les pays et les orientations suivies mais il s'agit de l'étude
des mouvements du corps humain, de ses composants biologiques (anatomiques,
physiologiques, neurologiques, biochimiques, biomécaniques)
et sociaux (sociologie, histoire, psychologie). Le rapport entre
la qualité du mouvement et la santé humaine globale
est également étudié. (C'est effets ne sont pas scientifiquement prouvés) Terme issu du grec kinêsis : mouvement. Introduit
aux États-Unis en 1886 par le baron suédois Nils Posse (1862-1895).
Il existe plusieurs formes de "kinésiologie", selon
les pays et les orientations suivies mais il s'agit de l'étude
des mouvements du corps humain, de ses composants biologiques (anatomiques,
physiologiques, neurologiques, biochimiques, biomécaniques)
et sociaux (sociologie, histoire, psychologie). Le rapport entre
la qualité du mouvement et la santé humaine globale
est également étudié. (C'est effets ne sont pas scientifiquement prouvés)
 Kinésique, Terme issu du grec kinêsis : mouvement. C'est l'étude du mouvement. Kinésique, Terme issu du grec kinêsis : mouvement. C'est l'étude du mouvement.
Kinésiatrique,
 Kinésithérapeute,
paramédical
qui pratique la kinésithérapie ou plutôt devrions-nous dire les kinésithérapies
tant celle d'aujourd'hui n'est déjà plus
celle de Georgii (1808-1881),
et celle de Françoise
Mézières (1909-1991)
n'est pas celle de Hede
Teirich-Leube 1903-1979.
Le masseur et chercheur
en massage Alain
Cabello-Mosnier disait de manière
sarcastique au sujet de la place du massage chez
les kiné et de l'utilisation abusive qu'ils en
ont fait par l'application stricte de leur monopole
"c'est peut-être parce que les kiné
faisaient tout sauf du massage
qu'ils ont cru bon de se l'approprier par la loi et
que, celui qu'ils croyaient faire était tellement
aux antipodes de sa diversité et de ce qu'était
vraiment le massage qu'ils furent incapables de le garder
pour eux car in fine, on ne destine jamais à
personne ce que l'on veut garder pour soi."
mais aussi "Si l'Ordre des kinésithérapeutes
avait été un régime politique,
ça aurait été une dictature." Kinésithérapeute,
paramédical
qui pratique la kinésithérapie ou plutôt devrions-nous dire les kinésithérapies
tant celle d'aujourd'hui n'est déjà plus
celle de Georgii (1808-1881),
et celle de Françoise
Mézières (1909-1991)
n'est pas celle de Hede
Teirich-Leube 1903-1979.
Le masseur et chercheur
en massage Alain
Cabello-Mosnier disait de manière
sarcastique au sujet de la place du massage chez
les kiné et de l'utilisation abusive qu'ils en
ont fait par l'application stricte de leur monopole
"c'est peut-être parce que les kiné
faisaient tout sauf du massage
qu'ils ont cru bon de se l'approprier par la loi et
que, celui qu'ils croyaient faire était tellement
aux antipodes de sa diversité et de ce qu'était
vraiment le massage qu'ils furent incapables de le garder
pour eux car in fine, on ne destine jamais à
personne ce que l'on veut garder pour soi."
mais aussi "Si l'Ordre des kinésithérapeutes
avait été un régime politique,
ça aurait été une dictature."
 Kinésithérapie, terme forgé par Georgii Auguste
en empruntant au grec kinêsis : mouvement,
littéralement « ce qui soigne par
le mouvement » synonyme de cinésie et thérapie
de therapeía (« cure »). L'appellation est actuellement toujours
utilisée dans les pays sous influence française
comme la Belgique, le Luxembourg, les pays d'Afrique
du Nord et quelques pays d'Afrique Noire, au Canada
on parlera davantage de Physiothérapie. Kinésithérapie, terme forgé par Georgii Auguste
en empruntant au grec kinêsis : mouvement,
littéralement « ce qui soigne par
le mouvement » synonyme de cinésie et thérapie
de therapeía (« cure »). L'appellation est actuellement toujours
utilisée dans les pays sous influence française
comme la Belgique, le Luxembourg, les pays d'Afrique
du Nord et quelques pays d'Afrique Noire, au Canada
on parlera davantage de Physiothérapie.
Néanmoins, la technique fut finalisée
au 19ème siècle issue d'une collation des recherches
suédoises, des rebouteux
que Georgii
fixera pour la première fois
en 1845 en suédois
[selon M. Hamonet
(C.), Contribution
à l’histoire de la médecine de rééducation.
À propos de l’utilisation du terme kinésithérapie, paru dans le Journal de Réadaptation
Médicale, vol.
13, 1993, n°2, p. 35-36.] ; l'édition française
sera publiée en France en 1847
:
– Kinésithérapie,
ou traitement des maladies par le mouvement selon la
méthode de Ling par
Georgii
Ed. Baillière Paris (1847) TDM  . C'est
une nouvelle pratique rassemblant la méthode
de Ling. . C'est
une nouvelle pratique rassemblant la méthode
de Ling.
Parmi
les buts recherchés de la kinésithérapie
il y a le soins mais aussi le Massage de rééducation,
le massage gynécologique, la kinésithérapie
respiratoire et une foule d'autres approches plus ou
moins reconnues, efficaces et surtout, acceptées.
– Kinésithérapie
gynécologique (méthode Brandt),
effet dynamogénique (cardio vasculaire) du massage
abdominal, par R. Titus,
thèse de médecine no 498, Paris, 1895 et la 1ère
à utiliser le mot kinésithérapie. TDM 
Paul Carnot,
professeur à la Faculté de médecine
de Paris et membre de l'Académie de médecine
au début du siècle, nous dit qu'elle recouvre
l'utilisation de l'électrothérapie, de la radiothérarapie et de ses dérivés,
de la kinésithérapie qui comporte le massage,
la gymnastique
et la mobilisation, de la mécanothérapie, de la balnéothérapie etc.
HISTOIRE : c'est grâce à la réunification
du Syndicat des masseurs médicaux et celui des gymnastes
médicaux, et dans un
souci d'éliminer ces derniers, que l'appellation
« kinésithérapeute »
a été proposée et conservée.
L'appellation « masseur »,
intégrée à la nouvelle dénomination,
elle résulte de l'activité puissante de
ce groupement professionnel, fort d'un diplôme
crée en 1922 qui associé au terme « kinésithérapeute »,
constitue, à travers un néologisme de
complaisance, une redondance mal acceptée de
nos jours.
[Note du CFDRM, alors,
Georgii est probablement
le premier à avoir employé ce terme dans
Kinésithérapie,
... Ed. Baillière Paris
1847 TDM  mais,
page 78,
il nous restitue tout-de-même un paragraphe écrit
par Branting
qui l'emploie en 1842.] mais,
page 78,
il nous restitue tout-de-même un paragraphe écrit
par Branting
qui l'emploie en 1842.]
« C’est l’art de traiter
ou de prévenir les maladies par le mouvement
». Comme l'interprète le titre de Georgii
selon Jacques Monet
dans Emergence de la Kinésithérapie
en France à la fin du XIXème et au début du XXème
siècle, volume 1.
Boris Dolto,
rectifie dans Le corps entre
les mains une nouvelle Kinésithérapie, de 1976 TDM  en introduction, p. 12, s’appuyant sur l’origine
grecque du terme kinésithérapie, il suggère que « la kinésithérapie
n’est pas un traitement par le mouvement,
mais le traitement du mouvement ». en introduction, p. 12, s’appuyant sur l’origine
grecque du terme kinésithérapie, il suggère que « la kinésithérapie
n’est pas un traitement par le mouvement,
mais le traitement du mouvement ».
En France
l'esprit de corps s'est rapidement constitué
autour d'un principe répressifs et malvenu en
s'accaparant abusivement, par la Loi
du 30 avril 1946 (N° 46 858), l'exclusivité
sur le mot massage
et tous ses dérivés alors qu'elle ne le
pratique pas. L'utilisation du massage en kinésithérapie l'oblige d'ailleurs à procéder
à une association de terme aussi inepte que le
massage
standard de Ling. "Il
y a bien une notion de soins par le mouvement
« kinésithérapie » et en même temps un soin par
le touché,
toucher qui pourrait être qualifié de thérapeutique et qui porterait le nom de « massage »,
d’où le terme de masso-kinésithérapie." Le diplôme d’État
de masseur-kinésithérapeute date quant
à lui du 25 mai 1948.
– Arnaud Choplin
Mémoire Apprendre le
toucher. Du toucher à la perception. Juin 2011 TDM  page
13. page
13.
– Nicolas Dally
dit dans Cinésiologie ou science du mouvement dans ses rapports
avec l'éducation, l'hygiène et la thérapie, Librairie Centrale des Sciences, 1857  page ix que la kinésithérapie
et la kinésiatrie sont des "composés
illégitimes" de cinésie. page ix que la kinésithérapie
et la kinésiatrie sont des "composés
illégitimes" de cinésie.
La kinésithérapie pratique également selon la loi la
gymnastique médicale.
Voir aussi L'institution de la kinésithérapie
en France (1840-1946) par Rémi
Remondiere  . .
 Kinésithérapie
et Art : "Les anges kinés", de 1,95 x 1,30 m. par
Patrick Boussignac au Musée du CFDRM de Paris, acquis par souscription
en février 2013. Kinésithérapie
et Art : "Les anges kinés", de 1,95 x 1,30 m. par
Patrick Boussignac au Musée du CFDRM de Paris, acquis par souscription
en février 2013.
Nous disposons
également de nombreuses représentations,
photographies, cartes-postales sur le thème
de la kinésithérapie.
|

|
– Boris Dolto,
dans Le corps entre les mains
une nouvelle Kinésithérapie de 1976
TDM  p. 12, s’appuie sur l’origine grecque du terme
kinésithérapie pour suggérer que « la kinésithérapie n’est pas un traitement par le mouvement,
mais le traitement du mouvement ». p. 12, s’appuie sur l’origine grecque du terme
kinésithérapie pour suggérer que « la kinésithérapie n’est pas un traitement par le mouvement,
mais le traitement du mouvement ».
Kinésithérapeute, praticien(ne) exerçant la kinésithérapie.
kinésiarque, peut-être pourrions-nous
parler ici de personnes plus que de kinésithérapeutes, associées à
la direction d'un exercice. Nous en retrouvons le terme
dans Kinésithérapie, par Georgii
Ed. Baillière, 1847 TDM *** **  page 91.
Mot assez proche de gymnasiarque. page 91.
Mot assez proche de gymnasiarque.
Voir Société de Kinésithérapie – Ordre des kinésithérapeutes – Taote Taurumi. |
 Kinesthésie, Kinesthésie,  n.f. (du grec) : kinesis signifiant "mouvement" et aisthesis : sensibilité) est un autre terme utilisé
parfois à la place de proprioception. La kinesthésie est une perception consciente de la position et des mouvements des différentes
parties du corps. Voir tactilo-kinesthésique. n.f. (du grec) : kinesis signifiant "mouvement" et aisthesis : sensibilité) est un autre terme utilisé
parfois à la place de proprioception. La kinesthésie est une perception consciente de la position et des mouvements des différentes
parties du corps. Voir tactilo-kinesthésique.
Kyphi,
 traduction de l'égyptien
kp.t)
est un parfum sous forme solide de l'Égypte antique. C'est une sorte d'encens
sacré. Les Égyptiens le faisaient brûler en
l'honneur du dieu Rê, qu'ils vénéraient. Ils
croyaient que chaque ingrédient composant le kyphi (généralement
de dix à seize, jusqu'à cinquante ingrédients
chez Nicolas Myrepsos) avait des propriétés magiques.
On y trouve notamment le souchet odorant,
du miel, de la cannelle, de la myrrhe,
des baies de genièvre et du bois de santal. traduction de l'égyptien
kp.t)
est un parfum sous forme solide de l'Égypte antique. C'est une sorte d'encens
sacré. Les Égyptiens le faisaient brûler en
l'honneur du dieu Rê, qu'ils vénéraient. Ils
croyaient que chaque ingrédient composant le kyphi (généralement
de dix à seize, jusqu'à cinquante ingrédients
chez Nicolas Myrepsos) avait des propriétés magiques.
On y trouve notamment le souchet odorant,
du miel, de la cannelle, de la myrrhe,
des baies de genièvre et du bois de santal.
 Kobido, signifie «
ancienne voie de la beauté » technique japonaise de
massage du visage. Voir Massage
kobido. Kobido, signifie «
ancienne voie de la beauté » technique japonaise de
massage du visage. Voir Massage
kobido.
 Koho
shiatsu, fondé sous cette appellation
en 1941
il eu pour pionnier Thierry
Riesser. Koho
shiatsu, fondé sous cette appellation
en 1941
il eu pour pionnier Thierry
Riesser.
Khôl,
Kohol ou Kohl
(en arabe : kuhl, en égyptien
ancien : mesdemet) est une poudre minérale
autrefois composée de sulfure de plomb
ou de sulfure d’antimoine,
utilisée soit à titre cosmétique soit thérapeutique.
Elle fut aussi composée dans le passé d'un mélange
de plomb sous forme de galène
 , de soufre , de soufre  et de gras animal,
voir de bois brûlé ou de bitume, utilisée pour maquiller ou soigner les yeux.
et de gras animal,
voir de bois brûlé ou de bitume, utilisée pour maquiller ou soigner les yeux.
 Krammgriff, [Terme de massage]
mot d'origine allemande kramm (1) et griff (poignée, "manche"
(de couteau) gestuelle
pratiquée avec le poing fermé
sur le ventre afin de favoriser la désobstruction
des intestins et dont nous retrouvons une gravure dans
le livre de George Berne
Le massage
publié en 1894
TDM Krammgriff, [Terme de massage]
mot d'origine allemande kramm (1) et griff (poignée, "manche"
(de couteau) gestuelle
pratiquée avec le poing fermé
sur le ventre afin de favoriser la désobstruction
des intestins et dont nous retrouvons une gravure dans
le livre de George Berne
Le massage
publié en 1894
TDM  page
249 que nous vous restituons voir. page
249 que nous vous restituons voir.
Berne en parle également page 256 dans un paragraphe
dans lequel il traite du massage abdominal citant Dujardin-Beaumetz
qui dit que grâce au massage, « Chez la plupart de nos malades dilatés
de l'estomac, la digestion s'active, le clapotement stomacal
diminue, le poids augmente. » Berne explique alors
« Les manoeuvres
consistent en pressions
dirigées de gauche à droite, vers le pylore.
C'est une espèce de "Krammgriff" ». Voir constipation.
|
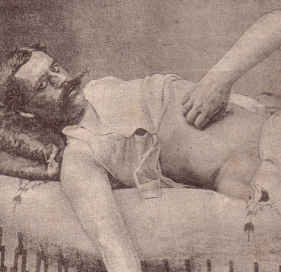
|
(1) kramm nous pose
davantage de problème, il peut venir de kramen
= fouiller farfouiller ou krampf (crampe)
(spasme)
puisque ce mouvement était conseillé
pour les problèmes de constipation ce qui, associé
avec griff signifierait enlever une crampe musculaire
avec le poing. |
Kundalini, terme sanskrit lié au Yoga qui désigne
une puissante énergie lovée dans le chakra appelé
muladhara et dont le positionnement symbolique correspond dans le
corps humain au périnée. Elle est représentée
comme un serpent enroulé sur lui-même trois fois et
demi.
Kung-fu,
voir Cong-Fou.
Kynodesme, fine bande
de cuir portée par les athlètes de la Grèce
antique autour de leur prépuce (qu'ils nommaient posthe). Le kynodesme était solidement fixé à
l’akroposthion,
c’est-à-dire à l’extrémité du prépuce,
ainsi qu'à la taille. Il pouvait également être
fixé à la base du pénis de telle sorte que celui-ci paraissait vrillé.
Dans les jeux sportifs, les Grecs concouraient nus mais ils n’aimaient
pas montrer leur gland qu’ils considéraient comme l’un des plus importants
ornements corporels du corps masculin. La longueur du prépuce était, chez eux, gage de respectabilité.
Du grec kunodesmon,
laisse de chien, le terme « chien » désignant
ici le gland.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |