|
Il
faut savoir que la translittération qui permet le glissement
d'une langue méconnue vers la prononciation d'une langue
commune compromet de fait l'intégrité formelle de
celle-ci. Le linguiste Marcel
Jousse avait créé le terme d'algerbrose
pour désigner la latinisation désastreuse des langues
orales. La traduction d'un glype en mot puis un mot en son donne
des résultats parfois plus que discutés
ce qui nous fait dire qu'une langue est non
fixée c'est-à-dire sujette
à variations, à interprétation, comme le sera
le français du XVIe siècle. Il faut savoir que plusieurs
hiéroglyphes peuvent servir à désigner un même
mot et les égyptologues ne sont pas toujours d'accords. Il
n'existe donc pas de transcription  universelle des hiéroglyphes
qui soit unanimement reconnue donc ce n'est pas cette page qui va
changer quelque chose. Ici nous ne proposons qu'un répertoriage incomplet
touchant à notre domaine. universelle des hiéroglyphes
qui soit unanimement reconnue donc ce n'est pas cette page qui va
changer quelque chose. Ici nous ne proposons qu'un répertoriage incomplet
touchant à notre domaine.
1. Un hiéroglyphe peut
désigner par exemple un organe mais ce même organe
peut disposer de hiéroglyphes différents voir toute
une combinaison de symboles de nature à désigner le
dit organe.
2. voir ici la façon dont nous utilisons les
symboles mais pour ceux concernant l'Égypte, un icône-type sera affecté :
 le sphinx pour
les dieux ou apparentés / le sphinx pour
les dieux ou apparentés /  le masque pour
les rois/ le masque pour
les rois/  l'arabe pour les hommes/ l'arabe pour les hommes/  le site pour les
lieux, le site pour les
lieux, le chameau pour les égyptologues et/ou voyageurs enfin, le chameau pour les égyptologues et/ou voyageurs enfin,  le facies
d'oiseau pour les divers. le facies
d'oiseau pour les divers.
Voir aussi Dieux,
Rois et Personnes de l'Égypte ancienne associés au
massage..., par
Alain Cabello-Mosnier
du mercredi 25 septembre 2019
Les obstacles : ce n'est pas parce que deux signes juxtaposés
forment un mot comme massage que mis ailleurs et accompagnés d'autres signes
ils ne désigneront pas autre chose parce que le contexte
aura changé.

 d-mdw = réciter (djed
médou litt. lire les paroles ou, en introduction d'une formule
magique "paroles à réciter") jn. Personne
ne sait comment l'égyptien ancien se prononçait mais
les égyptologues ont mis en place une prononciation conventionnelle d-mdw = réciter (djed
médou litt. lire les paroles ou, en introduction d'une formule
magique "paroles à réciter") jn. Personne
ne sait comment l'égyptien ancien se prononçait mais
les égyptologues ont mis en place une prononciation conventionnelle
 regardes bien regardes bien
Lettre
A
Abeille,
bj.t se prononce (bit).
Amon, 
  (Égypte) dieu égyptien. Entrée avec le massage développée
dans le Dico
des noms propres. (Égypte) dieu égyptien. Entrée avec le massage développée
dans le Dico
des noms propres.
Amulette, objets du quotidien
et funéraire que l'on portait comme un bijou dans les cheveux,
en collier, en boucles d'oreilles, en ceinture, en bracelets de
poignets ou de chevilles ou en bague pour, non pas tant détruire
les mauvaises entités que pour les repousser puisque pour
posséder un corps ils leurs fallait passer par une voie naturelle.
D'autres encore étaient plus thérapeutiques puisque
capables de soulager, parfois soigner, voir les guérir du mal qui les rongeait. Plus
prosaïquement, certaines de ces amulettes avaient pour fonction
de protéger son porteur des maux de son quotidien tels que
les chutes ou les attaques d'animaux sauvages, les morsures comme
le montre les représentations de déesse scorpion,
une mouche (mal vue dans cette Afrique où elle faisait des
dégâts) ou un crocodile. Le saou magicien
ou sounou Voir Comment bien choisir son amulette en Egypte
ancienne ?  par Amandine
Marshall. Les matériaux dans lesquelles elles
étaient sculptées pouvaient agir sur le mal que l'on
cherchait à combattre en fonction de leur texture, de leur
couleur. par Amandine
Marshall. Les matériaux dans lesquelles elles
étaient sculptées pouvaient agir sur le mal que l'on
cherchait à combattre en fonction de leur texture, de leur
couleur.
– Pline
l'Ancien Remacle
Livre 29 se propose de guérir du mal de tête dans cet emprunt à
l'Égypte par une amulette
suivit d'un petit massage
: "XXXVI. 1. On a encore le suint,
les os de la tête d'un vautour portés en amulette, la cervelle
de cet oiseau avec de l'huile
et de la résine de cèdre ; on frotte
la tête avec ce mélange, et on en introduit dans les
narines.
Anubis,    (Égypte) Translittération
Hannig (Égypte) Translittération
Hannig  ?npw. à développer. ?npw. à développer.
Aisselle,  (Dico d'anatomie)
Raymond Oliver Faulkner la référence telle que (Dico d'anatomie)
Raymond Oliver Faulkner la référence telle que 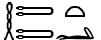 Faulkner p. 181, Wb. III p. 204, 15-17. JEAN 2010 TDM Faulkner p. 181, Wb. III p. 204, 15-17. JEAN 2010 TDM  p. 57 3.3) la cite. p. 57 3.3) la cite.
B
Lettre
B
Bassin, [consonne]  translittération translittération
 [correspond au son ch de chat] Code Gardiner [correspond au son ch de chat] Code Gardiner  : N37. : N37.
Bitume, Mennen, (pour
le rituel
d'embaumement) voir (sefetj).
Bouche, [consonne]  Translittération
ms Translittération
ms r/r/r r/r/r [r] resh
hébreu Code Gardiner [r] resh
hébreu Code Gardiner  :
D21. :
D21.
Description
: Bouche (Idéogramme dans rA 'la bouche', d'où dérive
la phonème (son) 'r'.)
Signification : —
Entre par exemple dans la
composition de "oindre" par Faulkner.
Dans le pLouvre n° E 32847
{Bardinet TDM  p. 82, Fig. 27} D21:O34 forment le cadrat p. 82, Fig. 27} D21:O34 forment le cadrat avec la bouche D21posée sur le verrou, O34. avec la bouche D21posée sur le verrou, O34.
Bras (générique),
Bras (paume ouverte), [semi-consonne bilitère] des. : Bras tendu,
main paume vers le haut, se nomme aïn, translittération des. : Bras tendu,
main paume vers le haut, se nomme aïn, translittération  et le code gardiner
est D36. et le code gardiner
est D36.
Signification : —
C
Lettre
C
Cartouche,
Cadrat,  
Demi-cadrat horizontal,
Demi-cadrat vertical,
Quart de cadrat,
Chouette, [consonne] ou, plus tardivement ou, plus tardivement Côte d'animal [Aa15], translittération
m [correspond au son m "en qualité de, comme..."]
Code Gardiner Côte d'animal [Aa15], translittération
m [correspond au son m "en qualité de, comme..."]
Code Gardiner  : G17. : G17.
Classification
de Gardiner,  méthodologie
mise en place pour organiser les hiéroglyphes. Un lettre définie la famille à laquelle
il appartient et le numéro correspond à l'ordre d'arrivée
dans cette liste. Ci-dessous les familles qui nous concernent, sinon,
voir les autres méthodologie
mise en place pour organiser les hiéroglyphes. Un lettre définie la famille à laquelle
il appartient et le numéro correspond à l'ordre d'arrivée
dans cette liste. Ci-dessous les familles qui nous concernent, sinon,
voir les autres  ) )
- A. Homme et ses occupations
- B. Femme et ses occupations
- C. Divinités anthropomorphes
- D. Parties du corps humain
Cobra,
[consonne]  translittération translittération
 [correspond
au son d de dieu] Code Gardiner [correspond
au son d de dieu] Code Gardiner  : I10. : I10.
Coeur,  aty, ou ib, le siège de la personnalité, de la mémoire
et de la conscience. aty, ou ib, le siège de la personnalité, de la mémoire
et de la conscience.
Le cœur, à cause de ses
pulsations est une porte privilégié pour le malin
qui s'infiltre par des vents qui viennent de l'extérieur
puis de lui, se propagent à l'ensemble du corps. Le
mal peu aussi entrer par l'oeil gauche et ressortir par le nombril comme
nous ne lisons dans le pLouvre {Bardinet p.35 et suivantes TDM  }. }.
Colonne vertébrale, et côtes. Dans La mère, l'enfant et le lait en Égypte
ancienne, par Richard-Alain
JEAN et Anne-Marie Loyrette, Ed. L'Harmattan 2010 TDM  page 45 il est dit qu'elle peut être symbolisée
par des signes comme page 45 il est dit qu'elle peut être symbolisée
par des signes comme  F37, F37,  F38 F38 F39 etc jusqu'à 41. La
vertèbre seule est la F139 F39 etc jusqu'à 41. La
vertèbre seule est la F139 et les signes
D157 et D 157 pour la partie de rachis pouvant
être classé dans les représentations humaines.
La colonne peut aussi être symbolisée par le
pilier-djed représentée sous forme d'amulettes
qui évoquait le rachis
du dieu mort Osiris,
Amandine Marshall
dans Comment bien choisir son amulette en Egypte ancienne ? et les signes
D157 et D 157 pour la partie de rachis pouvant
être classé dans les représentations humaines.
La colonne peut aussi être symbolisée par le
pilier-djed représentée sous forme d'amulettes
qui évoquait le rachis
du dieu mort Osiris,
Amandine Marshall
dans Comment bien choisir son amulette en Egypte ancienne ?
 6:12. 6:12.
Corps
(le), Djet,
Corbeille à anse,
 [consonne unilitère] se nomme kaf, translittération
k comme castor. Son code Gardiner [consonne unilitère] se nomme kaf, translittération
k comme castor. Son code Gardiner  est : V31. est : V31.
Côte Description : Côte d'animal, côté. Son code Gardiner Description : Côte d'animal, côté. Son code Gardiner  est Aa15,
M /gs /im /m. Associé au Verrou
O34
cela nous donne oindre est Aa15,
M /gs /im /m. Associé au Verrou
O34
cela nous donne oindre . .
Cou, wsr.t  JEAN et Anne-Marie
Loyrette, Ed. L'Harmattan 2010 TDM JEAN et Anne-Marie
Loyrette, Ed. L'Harmattan 2010 TDM  page 46 où ils abordent les différentes
parties du cou et comment cela s'écrit en hiéroglyphes. page 46 où ils abordent les différentes
parties du cou et comment cela s'écrit en hiéroglyphes.
Crible, corbeille ou placenta, [consonne unilitère]
translittération [consonne unilitère]
translittération
 [Le h cupule en égyptien dispose
de quatre formes (h1,
h2,
h3, h4),
celui-ci correspond au reu allemand comme dans achtung,
on lui donne le code x mais celui de Gardiner [Le h cupule en égyptien dispose
de quatre formes (h1,
h2,
h3, h4),
celui-ci correspond au reu allemand comme dans achtung,
on lui donne le code x mais celui de Gardiner  est : Aa1.]
Il s'agit d'un cercle ethmoïde ou présentant un cannage. est : Aa1.]
Il s'agit d'un cercle ethmoïde ou présentant un cannage.
D
Lettre
D
Décontracturant, ici nous en avons la mention hiéroglypgique
avec Jean/Loyrette, Éd. L'harmattan 2010 TDM  (Chapitre V) - 5.2.1. p. 90 « Le rhizome du « souchet comestible
(Chapitre V) - 5.2.1. p. 90 « Le rhizome du « souchet comestible
 », Cyperus
esculentus L., est utilisé
dans nombre de formulations médicales égyptiennes
anciennes, par ex. sous forme d'huile en
compagnie d'autres graisses,
mr », Cyperus
esculentus L., est utilisé
dans nombre de formulations médicales égyptiennes
anciennes, par ex. sous forme d'huile en
compagnie d'autres graisses,
mr t,
dans un décontracturant
musculaire (pRamesseum,
V. n° III n) » t,
dans un décontracturant
musculaire (pRamesseum,
V. n° III n) » 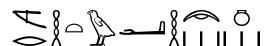 [Classification
de la formulation en présence : par le logiciel : (JSesh) [Classification
de la formulation en présence : par le logiciel : (JSesh)  U7:D21-V28-X1-G43-D36-V28-N12:Z2-nw:Z2].
U7:D21-V28-X1-G43-D36-V28-N12:Z2-nw:Z2].
Déconstruction hiéroglyphique
: A FAIRE |
|
|
|
|
|
|
Département
d'égyptologie du CFDRM, voire
dico
des noms Propres.
Dieux maléphiques,
Seth, Khonsou  , ,  (répand les cancers Bardinet p. 37), Sekhmet, (répand les cancers Bardinet p. 37), Sekhmet,
E
Lettre
E
Enduire , (Enduire son dos
[en hiéroglyphes]) Jean/Loyrette, Éd. L'harmattan 2010 TDM  (Chapitre VII - 7.2.1. p. 116) pEbers 836.
97, 10-11ab (Chapitre VII - 7.2.1. p. 116) pEbers 836.
97, 10-11ab 
[Classification
de la formulation en présence : Aa15/O34 + A24 + F37/X1+Z1 + F51/O34 + M17 + G17 et
par le logiciel
: (JSesh)  Aa15:O34-A24-F37:X1-Z1-F51:O34-M17-G17] Aa15:O34-A24-F37:X1-Z1-F51:O34-M17-G17]
• Chapitre XV 15.3. p. 237 "Avant l’examen, les textes nous indiquent
que l’on doit enduire la
poitrine et les deux bras de la femme avec de l’huile neuve
à son coucher (pKahun 26. 3, 12b-13a ; pBerlin
196 vs. 1, 9b-9d)."
Déconstruction
hiéroglyphique :
|

Description : Côte d'animal
Aa15
M /gs /im /m
Signification : côte, côté

Des. : Verrou
O34
(var.Aa8)
Translittération : Z/S
Signification : — |

Des. : Homme frappant avec un baton
A24
(var.D40)
Trans. : in
Signification : force, effort, travail, violence,
enseigner
|

Des. : Colonne vertébrale et côtes
F37
(var.F38,F39,M20) (gr.M21)
ps /sm/ /sm/  t t
Signification : dos

X1
Trans. : t
Des. : pain
Signification : le concept de féminin |

F51
Des. : Morceau de chair
Signification : chair, viande, partie du corps

Déterminatif
Z1
|

Des. : Roseau
Appelé : yod
M17
Trans. :  ou J ou J
Signification : homme, humain, [je]
|

Des. : Chouette
G17
Trans. : m
Signification : —
|
F
Lettre
F
Filet d'eau, [consonne
unilitère] ou plus tardivement ou plus tardivement la couronne de
basse Égypte translittération
n parfois nt [correspond au son n] Code Gardiner la couronne de
basse Égypte translittération
n parfois nt [correspond au son n] Code Gardiner  : N35. : N35.
Flan
de colline, [consonne unilitère] appelé
le qof, appelé
le qof,  ou q correspondant au qaf arabe
venant du fond de la bouche, code Gardiner ou q correspondant au qaf arabe
venant du fond de la bouche, code Gardiner  : N29. : N29.
Flasque, 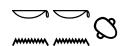 knkn. Déconstruction
hiéroglyphique : knkn. Déconstruction
hiéroglyphique :  N35 N35 V31 V31 Aa2 Jean/Loyrette, Éd. L'harmattan 2010 TDM Aa2 Jean/Loyrette, Éd. L'harmattan 2010 TDM  p. 256 (Wb V, 134, 10). [Code de la formulation en présence
selon le logiciel (JSesh) p. 256 (Wb V, 134, 10). [Code de la formulation en présence
selon le logiciel (JSesh)  :
V31:N35-V31:N35-Aa2] "Ne
doit pas convenir pour désigner la flaccidité de la verge flasque ou de la
peau mais concerne seulement les tissus sous-cutané
je pense." R-A J. :
V31:N35-V31:N35-Aa2] "Ne
doit pas convenir pour désigner la flaccidité de la verge flasque ou de la
peau mais concerne seulement les tissus sous-cutané
je pense." R-A J.
|
Friction , Jean/Loyrette, Éd. L'harmattan 2010 TDM  (Chapitre XX) 20.1.1. p.
323) pEbers 808.
95, 1-3 (Chapitre XX) 20.1.1. p.
323) pEbers 808.
95, 1-3 
[Classification
de la formulation en présence : par le logiciel : (JSesh)  S29-M17-K1:N35-nw:D36]
S29-M17-K1:N35-nw:D36]
• Déconstruction hiéroglyphique : |

Description : Vêtement plié
S29
Translittération : s/z
Signification : — |

Des. : Roseau
Appelé : yod
M17
Trans. :  ou J ou J
Signification : homme, humain, [je] |

Des. : perche du Nil (Tilapia nilotica) [bilitère]
K1
Trans. : in
Signification : Poisson boulti |

Des. : Filet d'eau
N35
Trans. : n/nt
Signification : —
|

Des. : pot (ind.D12,N33,Y24)
W24
Trans. : nw
Signification : pot, vase, mesure, tributs,
bière, liquides, boisson, ivresse, oindre [c'est
un bilitère]. |

Des. : Bras tendu, main paume vers le haut
D36
Signification : — |
Frotter, « verbe »
Sjn, = zjn.

Dans Un massage obstétrical
en Égypte entre la XVIIe et VIe dynastie chez Edwin SMITH (1822-1906), par Alain Cabello-Mosnier, 10/07/2018 nous retrouvons cette valeur
associée à une préparation destinée
à un massage
vaginal XX, 18c,
section II (nous retrouvons une thérapeutique
présentant un massage du vagin dans les cas
d'hématométrie.). Nous avons aussi une entrée avec
le verbe frotter p. 182 (c).
[Code de la formulation en présence
selon le logiciel (JSesh)  : S29-M17-K1:N35-Aa2:D36]
: S29-M17-K1:N35-Aa2:D36]
Déconstruction hiéroglyphique : forme linéaire |

|

Description : Vêtement plié
S29
Trans. : s/z
Signification : —
|

Des. : Roseau
Appelé : yod
M17
Trans. :  ou J ou J
Signification : homme, humain, [je] |

Des. : perche du Nil (Tilapia nilotica) [bilitère]
K1
Trans. : in
Signification : Poisson boulti
|

Des. : Filet d'eau
N35
Trans. : n/nt
Signification : —
|

Des. : Pustule, ou substitut de divers signes
Aa2
Signification : maladie, états du corps,
enfler, odeur, excréments, sale |

Des. : Bras tendu, main paume vers le haut
D36
Signification : —
|
G
Lettre
G
Ganglion lymphatique,
Ges, onguent, (pour
le rituel
d'embaumement).
Les égyptiens disposaient de dix onctions pour l'embaumement
du corps
:
1 - (segen, correspond à l'onction) de la tête jusqu'aux pieds, onguents de l'Ouverture de la bouche, onguent de fête, onguent nekhenem (?), onguent iber(?), onguent de sapin âch, onguent de Manou (?), fard des lèvres.
Graisse,  ,
'âdj, "graisse animale" bovins
et volailles notamment entraient dans la préparation
de nombreux onguents en médecine, en esthétique,
pour l'éclairage, l'artisanat... On l'extrayait
en boucherie, avec la viande, la peau et les os qui
eux aussi étaient utiles ! ,
'âdj, "graisse animale" bovins
et volailles notamment entraient dans la préparation
de nombreux onguents en médecine, en esthétique,
pour l'éclairage, l'artisanat... On l'extrayait
en boucherie, avec la viande, la peau et les os qui
eux aussi étaient utiles !
Déconstruction
hiéroglyphique :

La main [consonne unilitère]
translittération d
Code Gardiner  : D46. : D46. |

Des. : pot (ind.D12,N33,Y24)
W24
Trans. : nw
Signification : pot, vase, mesure,
tributs, bière, liquides, boisson,
ivresse, oindre [c'est un bilitère]. |
|
|
|

 ,
'âdj' ,
'âdj'
|
Griffe,  signe qui ne dispose pas de
code mais désigne les ongles entrant dans la formation du
mot manucure lorsqu'il est accompagné de l'oeil = jret qui signifie faire. signe qui ne dispose pas de
code mais désigne les ongles entrant dans la formation du
mot manucure lorsqu'il est accompagné de l'oeil = jret qui signifie faire.
H
Lettre
H
Hiéroglyphe,  voir
dico des noms communs : hiéroglyphes. voir
dico des noms communs : hiéroglyphes.
Hyène, terme féminin
qui se dit Hétjet avec ce hiéroglyphe correspondant
au code correspondant
au code  E82. Dans Un massage obstétrical en Égypte
entre la XVIIe et VIe dynastie chez Edwin SMITH (1822-1906), par Alain
Cabello-Mosnier, 10/07/2018 chapitre - Sur
la hyène développé
à partir de Jean/Loyrette, Éd. L'harmattan 2010 TDM E82. Dans Un massage obstétrical en Égypte
entre la XVIIe et VIe dynastie chez Edwin SMITH (1822-1906), par Alain
Cabello-Mosnier, 10/07/2018 chapitre - Sur
la hyène développé
à partir de Jean/Loyrette, Éd. L'harmattan 2010 TDM  nous avons une masso entrée. Signe hors classification de Gardiner. nous avons une masso entrée. Signe hors classification de Gardiner.
I
Lettre
I
Imhotep, ou Eimophth, (Égypte) mais entrée développée dans le
Dico
des noms propres. (Égypte) mais entrée développée dans le
Dico
des noms propres.
Ikhékhi,  (Égypte) haut masso-personnage mais entrée développée
dans le Dico
des noms propres. (Égypte) haut masso-personnage mais entrée développée
dans le Dico
des noms propres.
Article
afférent : Le
mastaba d'Ikhékhi, par Alain
Cabello-Mosnier le 28 août 2018 p/o le CFDRM de Paris.
Iwn-n-pt, lin.
J
Lettre
J
Jambe, ou pied [consonne unilitère] translittération b [correspond au son
b]. Code Gardiner
translittération b [correspond au son
b]. Code Gardiner  : D58 : D58
K
Lettre
K
Khnoum,    (Égypte), entrée développée dans le Dico
des noms propres (Égypte), entrée développée dans le Dico
des noms propres
Khnoumhotep,   (Égypte) (Égypte)  . Entrée
développée dans le Dico
des noms propres. . Entrée
développée dans le Dico
des noms propres.
Nous disposons aussi d'un Dico hiéroglyphique.
Khonsou,    (Égypte), entrée développée dans le Dico
des noms propres. (Égypte), entrée développée dans le Dico
des noms propres.
L
Lettre
L
Les sept huiles, http://www.hierogl.ch/hiero/tpt#_2
twAwt huile touaout.
Lien, ou entrave pour
les animaux, désigne la consonne unilitère désigne la consonne unilitère
 Trans.
: IFAO Trans.
: IFAO  t de tiers. Code Gardiner t de tiers. Code Gardiner  : V13 (var.V14). : V13 (var.V14).
M
Lettre
M,
en égyptien, la lettre M représente des vagues pour
signifier en hiéroglyphe "l'eau (Filet d'eau)"
qui correspond au code Gardiner  : N35 : N35 . Il se dit mem
dans la langue du peuple sémitique. La lettre sera verticalisée
en alphabet protosinaïtique vers -1700, avant d'être
de nouveau allongée par les phéniciens vers -1000.
Les grecs en font une version avec la jambe droite plus longue,
les étrusques la copient et pour terminer, les romains lui
donnent la forme que l'on connaît. Source Augustine Éditions . Il se dit mem
dans la langue du peuple sémitique. La lettre sera verticalisée
en alphabet protosinaïtique vers -1700, avant d'être
de nouveau allongée par les phéniciens vers -1000.
Les grecs en font une version avec la jambe droite plus longue,
les étrusques la copient et pour terminer, les romains lui
donnent la forme que l'on connaît. Source Augustine Éditions
 .
D'ailleurs, dans le pEbers 808. 95, 1-3, le symbole est utilisé pour écrire
« Frictionner » .
D'ailleurs, dans le pEbers 808. 95, 1-3, le symbole est utilisé pour écrire
« Frictionner » . Ce qui est intéressant c'est que
la sonorité "mem" correspond avec "même",
ce qui en massage suppose le vis-à-vis, la similitude
et enfin la symbolique de l'eau qui renvoie au bain, aux Massage
par affusion. C'est aussi la première lettre
de "mouvement",
on ne peut plus essentiel pour nous. . Ce qui est intéressant c'est que
la sonorité "mem" correspond avec "même",
ce qui en massage suppose le vis-à-vis, la similitude
et enfin la symbolique de l'eau qui renvoie au bain, aux Massage
par affusion. C'est aussi la première lettre
de "mouvement",
on ne peut plus essentiel pour nous.
 Main, [consonne unilitère] Main, [consonne unilitère] translittération
d Code Gardiner translittération
d Code Gardiner
 : D46. : D46.
c'est ce que nous retrouvons ci-contre associée
à l'oeil = jret ce qui donnerait (manucure).
Ce hiéroglyphe
est gravé dès l'entrée du mastaba
de Niankhknoum
et de Khnoumhotep,
les "Superviseur
des manucures du palais royal".
Voir la vignette de droite ci-dessous, néanmoins,
la main dispose de nombreuses représentations
selon ce que l'on veut lui faire dire et c'est au regard
de son importance dans la
pratique des massages,
(nous le ferons avec le pied aussi), que nous restituerons
tous les hiéroglyphes et que nous les répertorierons.
           
D46 D46A
D46B
D46C D47
D47A
D48
D265
D266
D267
D268
D269
   
D270 D271
D370
D409
R-A Jean p. 45 nous dit par exemple "Un
autre terme pour dos [...] est utilisé pour désigner
la nageoire qui est sur le dos du synodonte (pBerlin
71. 6,11) dans des expressions comme s n n  rt
"dos de la main" (pSmith
20. 8, 2). rt
"dos de la main" (pSmith
20. 8, 2).
Maladie, pour les égyptiens elle est soit
parasitaire soit démoniaque. Bardinet p. 141. |
 Manucure, Jrw-'nwt Manucure, Jrw-'nwt  serait
la représentation la plus "probable"
pour former le signe manucure, sachant que rien n'est définitivement
fixé. Donc ici nous sommes en présence
de l'association de l'oeil = jret (à lire iret qui veut dire faire), code Gardiner serait
la représentation la plus "probable"
pour former le signe manucure, sachant que rien n'est définitivement
fixé. Donc ici nous sommes en présence
de l'association de l'oeil = jret (à lire iret qui veut dire faire), code Gardiner  D4 et de la griffe D4 et de la griffe  qui,
elle, ne dispose pas de code mais désigne
les ongles ce qui nous donne faire les ongles. qui,
elle, ne dispose pas de code mais désigne
les ongles ce qui nous donne faire les ongles.
Jret sert à
écrire le verbe jrj (lire iri) =
"faire, agir" qui peut donner
jriw (lire iriou) "celui qui fait",
et désigner ici le préposé
aux ongles ('nwt), donc une personne qui
"fait les ongles", bon c'est un
peu raccourci mais c'est en gros l'étymologie
de l'expression "manucure" en
égyptien.
Cet exemple provient de L'intrigante
histoire du Papyrus du web... par Alain Cabello, le vendredi 5 juillet 2013. |
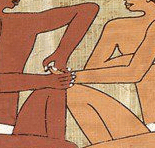
|
– Ci-contre, la sources paléographiques
en provenance du mastaba de
Niankhknoum
et de Khnoumhotep

 (Boucle
de cheveux (var.D3a). Gardiner D3 EGPZ 57464 (e078) dont la Translittération
serait (Boucle
de cheveux (var.D3a). Gardiner D3 EGPZ 57464 (e078) dont la Translittération
serait  ny/ ny/ ni. ni.
Commentaires
: Déterminatif dans Sny 'les cheveux', 'les poils',
et les mots apparentés ; dans inm 'la peau',
et les verbes et substantifs en relation avec la notion
de deuil.  . Le symbole peut ainsi entrer
dans de nombreux hiéroglyphe comme celui de la peau. . Le symbole peut ainsi entrer
dans de nombreux hiéroglyphe comme celui de la peau.
|

Lire jrw-'nwt, avec l'oeil et la griffe (manucure). |
MASSAGE, je rappelle que
tout cela reste à vérifier mais nous retrouvons
cette composition dans le pLouvre n°
E 32847
{Bardinet TDM  p. 82,
Fig. 27}. D21:O34 forment
le cadrat p. 82,
Fig. 27}. D21:O34 forment
le cadrat avec
la bouche
D21posée
sur le verrou, O34. avec
la bouche
D21posée
sur le verrou, O34.
MASSER, c'est l'ouvrage Médecins et magiciens à la
cour du pharaon. Une étude du papyrus médical
Louvre
E 32847, par Thierry Bardinet, Ed. Khéops et
musée du Louvre, Paris, 2018 TDM  p. 72 - fig. 22 ci-dessous. (Attention, Fig. 19 p. 67 nous avons
ce signe et pourtant pas de trace de massage
mais juste d'huile, idem p. 75, donc pousser
les recherches. En effet, ce n'est pas parce que deux
signes juxtaposés forment le mot par exemple
massage que mis ailleurs et accompagnés
d'autres signes qu'ils désigneront toujours massage
parce que le contexte aura changé. p. 72 - fig. 22 ci-dessous. (Attention, Fig. 19 p. 67 nous avons
ce signe et pourtant pas de trace de massage
mais juste d'huile, idem p. 75, donc pousser
les recherches. En effet, ce n'est pas parce que deux
signes juxtaposés forment le mot par exemple
massage que mis ailleurs et accompagnés
d'autres signes qu'ils désigneront toujours massage
parce que le contexte aura changé.
Dans JEAN, LOYRETTE 2010 TDM  p.
105 (c) nous retrouvons cette valeur. p.
105 (c) nous retrouvons cette valeur.
[Classification par le logiciel : (JSesh)  de la formulation en présence
: $r-V31A:X1-$b-O34:D21-G14-[[-W24:Z2-+l
(masser)+s-]]-R15-D58-X1:Z9-A24-Aa2:D40-W24-Z7-M36:D21-Z7-Z7-F51-D2-Z1-I9-[[-Aa13:O34-+l
(oindre)+s-]]-V1:D40-M23-Z7-D21-N5-Z2]
de la formulation en présence
: $r-V31A:X1-$b-O34:D21-G14-[[-W24:Z2-+l
(masser)+s-]]-R15-D58-X1:Z9-A24-Aa2:D40-W24-Z7-M36:D21-Z7-Z7-F51-D2-Z1-I9-[[-Aa13:O34-+l
(oindre)+s-]]-V1:D40-M23-Z7-D21-N5-Z2] |

|
Déconstruction
hiéroglyphique :  |

Des. : pot (ind.D12,N33,Y24)
W24
Trans. : nw
Signification : pot, vase, mesure, tributs,
bière, liquides, boisson, ivresse, oindre [c'est
un bilitère]. |
Et le pluriel Z2 |
|
Mèche de lampe,
[consonne unilitère] dérivant
probablement de Hat
'mèche', (gr.W22) translittération dérivant
probablement de Hat
'mèche', (gr.W22) translittération
 pointé [Le h en égyptien dispose de quatre formes
(h1, h2, h3,
h4),
celui-ci correspond au son emphatique h de Mohamed], signifierait
possiblement : chandelle, mèche Code Gardiner
pointé [Le h en égyptien dispose de quatre formes
(h1, h2, h3,
h4),
celui-ci correspond au son emphatique h de Mohamed], signifierait
possiblement : chandelle, mèche Code Gardiner  : V28. : V28.
Met, se dit mt (prononcé
mèt) ou son pluriel Mtw metou (w=ou) terme
générique nommant les organes tubulaires, on parle
aussi de conduit-mt amenant
l'air ou les liquides eau/urine comme veines et artères, la trachée, l'urètre etc.
"désigne tout ce qui est considéré
comme différents tubes voisinant dans l'organisme et se chevauchant,
un peu comme un fagot, se faisant suite ou non. Ainsi, il existe
des metou organes
pleins [comme les muscle]et des metou organes creux." ou "...des gros metou évidés
transporte l'aire ou des liquides (artères,
veines et d'autres tuyaux comme par exemple les uretères). « deux metou sont sous elles (les clavicules, l'un à droite
et l'autre à gauche de la gorge et du larynx. Ils alimentent
les poumons. » - soit, les deux bronches souches reliant les
poumons à la trachée." À
propos des instruments médico-chirurgicaux métalliques
égyptiens..., par R.-A.
JEAN, Éd. Cybele, Paris, 2012 TDM  p. 11. p. 11.
Néenmoins,
on parlera des « deux metou pour les deux testicules, ce sont eux qui donnent la semence. » - il s'agit
des canaux déférents. p. 12.
Muscle,
se dit mt (prononcé
mèt) considéré
comme un organe
tubulaire plein. Bardinet, Ed. Khéops
et musée du Louvre, 2018 TDM  p. 61 chapitre Patients
souffrants des conduits-mt et des extrémités des membres. p. 61 chapitre Patients
souffrants des conduits-mt et des extrémités des membres.
N
Lettre
N
Neheh, huile,
(pour le rituel d'embaumement).
Netjerou,  désigne les
« dieux », les hommes se nomment remeth. désigne les
« dieux », les hommes se nomment remeth.
Niankhknoum,  (Égypte) (Égypte)  , entrée
développée dans le Dico
des noms propres. , entrée
développée dans le Dico
des noms propres.
Niousserre, 6ème   ( (Pharaon d'Égypte), entrée développée dans le Dico
des noms propres. ( (Pharaon d'Égypte), entrée développée dans le Dico
des noms propres.
O
Lettre
O
Odeur, « =
sty ».
Dans JEAN, LOYRETTE 2010 TDM  p.
105 (c) nous retrouvons cette valeur. p.
105 (c) nous retrouvons cette valeur.
[Classification
de la formulation en présence : S29+X1/Aa2 & S29+V13/Aa2 sty et par le logiciel : (JSesh)  S29-X1:Aa2
& S29-V13:Aa2]
S29-X1:Aa2
& S29-V13:Aa2] |
Odeur en hiéroglyphe

|
Déconstruction hiéroglyphique :
|

Description : Vêtement plié
S29
Transliteration IFAO  s/z s/z
Signification : — |

Des. : Lien pour les animaux
V13
(var.V14)
Trans. : IFAO  t t
Signification : — |

Des. : Pustule, ou substitut de divers signes
Aa2
Signification : maladie, états du corps,
enfler, odeur, excréments, sale |
Oeil, = Jret (à
lire iret) avec pour code
Gardiner avec pour code
Gardiner  D4, translittération
m D4, translittération
m /ir (bilitère) qui
devient le déterminatif des mots en relation avec l'action
de voir et l'organe de la vue et pour signification : œil, vision,
états ou actions de l'œil mais aussi de faire. Par exemple, l'oeil combiné avec la griffe /ir (bilitère) qui
devient le déterminatif des mots en relation avec l'action
de voir et l'organe de la vue et pour signification : œil, vision,
états ou actions de l'œil mais aussi de faire. Par exemple, l'oeil combiné avec la griffe  permet la formation
de manucure. permet la formation
de manucure.
Selon {Bardinet p.36 et suivantes TDM  note de bas de page au sujet du passage de Ebers 855}
le mal peu aussi entrer par l'oeil gauche et ressortir
par le nombril comme nous ne lisons dans le pLouvre. note de bas de page au sujet du passage de Ebers 855}
le mal peu aussi entrer par l'oeil gauche et ressortir
par le nombril comme nous ne lisons dans le pLouvre.
Oeil d'Oudjat ou l'œil d'Horus = Oudjat,  . En 1911, l'égyptologue
Georg Möller . En 1911, l'égyptologue
Georg Möller  identifia à
partir de documents du Nouvel Empire, que certains
signes hiéroglyphiques pouvaient raisonnablement servir à
mesurer des volumes de grains notamment l'œil
d'Horus dit Oudjat. identifia à
partir de documents du Nouvel Empire, que certains
signes hiéroglyphiques pouvaient raisonnablement servir à
mesurer des volumes de grains notamment l'œil
d'Horus dit Oudjat.
|
 Oindre, « verbe »
g Oindre, « verbe »
g et ses variantes. et ses variantes.
Dans JEAN, LOYRETTE
2010 TDM  Chapitre XVI - 16.1.2. p.
259/260 : Notes — nous retrouvons
cette entrée. "(c) Chapitre XVI - 16.1.2. p.
259/260 : Notes — nous retrouvons
cette entrée. "(c) 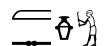 g g « oindre » : Wb V, 210,12 - 202,13
; Alex. 77.4689, 78.4481 (« oindre », aussi « taner » à
l’huile)
; Hannig-Wb II,2 - 3621 « salben » (oindre) - 36126
; PtoLex.
p. 1106 « to anoint » (oindre) ; ERICHSEN 1954, p. 562, dém. g « oindre » : Wb V, 210,12 - 202,13
; Alex. 77.4689, 78.4481 (« oindre », aussi « taner » à
l’huile)
; Hannig-Wb II,2 - 3621 « salben » (oindre) - 36126
; PtoLex.
p. 1106 « to anoint » (oindre) ; ERICHSEN 1954, p. 562, dém. g « oindre » ; BARDINET 1995, p. 442 « enduire »
; WESTENDORF 1999, p. 4360 « salben ». Voir
le mot « oindre » ; BARDINET 1995, p. 442 « enduire »
; WESTENDORF 1999, p. 4360 « salben ». Voir
le mot  g g : Wb V, 202, 14-16 ; Alex. 78.4482 «
onguent » ; : Wb V, 202, 14-16 ; Alex. 78.4482 «
onguent » ;
|
PtoLex*. p. 1107 « ointment,
unguent » (pommade,
onguent) ; ERICHSEN 1954, p. 592, dém. gs «
onguent ». pEbers 104.
25,11  * « les onguents
g * « les onguents
g w » dont le JSeth est
: Aa15:O34-A24-W23:Z2. w » dont le JSeth est
: Aa15:O34-A24-W23:Z2.
* A ptolemaic lexikon par
P. Wilson Ed. Peeters, Leuven, 1997.
[Classification
de la formulation en présence : Aa15/O34+W23+A24 sty et par le logiciel : (JSesh)  Aa15:O34-W23-A24]
Aa15:O34-W23-A24] |
Oindre en hiéroglyphe
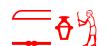
|
Déconstruction hiéroglyphique :
|

Description : Côte animale
Aa15
Trans. : M
/gs /im /m
Signification : côte, côté |

Des. : Verrou
O34
(var.Aa8)
Trans. : Z/S
Signification : — |

Des. : pot à anses
(gr.W22)
W23
Signification : pot, vase, mesure, tributs,
bière, liquides, boisson, ivresse, oindre |

Des. : Homme frappant avec un bâton
A24
(var.D40)
Trans. : in
Signification : force, effort, travail, violence,
enseigner |
Source : Raymond O. Faulkner - dictionnaire
Faulkner page 42 - rang : 17
Mot : ama
- Translitteration m.
* Note : R-A J. Faceb. me dit "Oindre dans pRamesseum (-1991 à -1783 av. J.-C.) IV.E 1. 1-2 vient
en remplacement du précédent [Classification
de la formulation en présence : par le logiciel : (JSesh)  Aa15:D40].
Aa15:D40]. Donc
là nous avons un raccourcissement avec l'emploi
des deux premiers glyphes présents dans le pEbers 104
(?-?). Donc
là nous avons un raccourcissement avec l'emploi
des deux premiers glyphes présents dans le pEbers 104
(?-?). |
|
|
|
|
|
|
Oindre par Faulkner : dictionnaire Raymond O. Faulkner page 65 -
rang : 2 - consacrer par l'onction,
oindre,
enduire, farder
Mot : wrH  wr wr -
consacrer par l'onction, oindre
qn, m
'avec' de l'onguent ; enduire d' huile. -
consacrer par l'onction, oindre
qn, m
'avec' de l'onguent ; enduire d' huile.
[Classification
de la formulation en présence : et par le logiciel : (JSesh)
Ff301-G36:D21-V28-W23-A24] |

|
|

Des. : Hirondelle ou martinet
G36
Translittération wr
Signification : hirondelle, oiseau |

Des. : bouche
(Idéogramme dans rA 'la bouche', d'où
dérive la phonème 'r'.)
D21
Trans. : ms r/r/r r/r/r
Signification : — |

Des. : Mèche de lampe (gr.W22)
V28
Trans. :  valeur phonétique ?, dérivant
probablement de Hat 'mèche' valeur phonétique ?, dérivant
probablement de Hat 'mèche'
Signification : chandelle |

Des. : pot à anses
(gr.W22)
W23
Signification : pot, vase,
mesure, tributs, bière, liquides, boisson, ivresse,
oindre |

Des. : Homme frappant avec un bâton
A24
(var.D40)
Trans. : in
Signification : force, effort, travail, violence,
enseigner |
Jean Capart
 nous restitue
p. 52 nous restitue
p. 52  de tome 1 TDM de tome 1 TDM
 le mot oindre ou râcler. Il nous dit "Le terme
le mot oindre ou râcler. Il nous dit "Le terme  est
fréquemment employé avec ce sens dans
les textes médicaux." est
fréquemment employé avec ce sens dans
les textes médicaux."
[Classification
de la formulation en présence : par le logiciel : (JSesh)  O34:K1:N35]
O34:K1:N35] |

|
|

Des. : Verrou
O34
(var.Aa8)
Trans. : Z/S
Signification : — |

Des. : perche du Nil (Tilapia nilotica)
K1
Trans. : in
Signification : Poisson boulti [trilitère] |

Des. : Filet d'eau
N35
Trans. : n/nt
Signification : —
Maïm en Cananéen est devenu en
grec mu, et en latin, M. Le serpent c'est N |
|
|
Ouâb, de Sekhmet
 , ,  (Égypte), entrée développée dans le Dico
des noms communs. (Égypte), entrée développée dans le Dico
des noms communs.
Ouam,
Ounas,  (Égypte), entrée développée dans le Dico
des noms propres. (Égypte), entrée développée dans le Dico
des noms propres.
P
Lettre
P
Pain, [consonne unilitère] désigne
le principe de féminin, translittération
t [correspond au son t]. Code Gardiner désigne
le principe de féminin, translittération
t [correspond au son t]. Code Gardiner  : X1. : X1.
Peau, (Dico
d'anatomie) (idem, op.
cit.  supra JEAN, LOYRETTE 2010 TDM supra JEAN, LOYRETTE 2010 TDM  p. 56). La peau
en égyptien se nomme p. 56). La peau
en égyptien se nomme       mais sa graphie
dans le (pSmith 21. 3-6 det. mais sa graphie
dans le (pSmith 21. 3-6 det.  D3) nous
donne D3) nous
donne jnm. Le pEbers en propose une autre variante et le copte l'écrit jnm. Le pEbers en propose une autre variante et le copte l'écrit
 nom B,
(peau du corps). Selon les mouvements linguistiques, le type de
peau concernée, {humaine, animale}, la formulation peut ainsi
bouger. Peau
semble aussi vouloir désigner les bêtes d'un troupeau
comme nous parlons encore de tête. nom B,
(peau du corps). Selon les mouvements linguistiques, le type de
peau concernée, {humaine, animale}, la formulation peut ainsi
bouger. Peau
semble aussi vouloir désigner les bêtes d'un troupeau
comme nous parlons encore de tête.
Per médjat, (bibliothèque
en égyptien). Bibliographie :
•
La mère, l'enfant et le lait en Égypte
ancienne, par Richard-Alain
JEAN et Anne-Marie Loyrette, Ed. L'Harmattan 2010 TDM 
- Page 313 : « Le traitement habituel
consiste à faire des massages circulaires avec expression manuelle du lait,
afin d’assouplir l’aréole et de soulager la pression. »
•
À propos des instruments
médico-chirurgicaux métalliques égyptiens conservés
au musée du Louvre, par
Richard-Alain
JEAN Éd. Cybele, Paris, 2012 TDM 
• Une
approche nouvelle de l'embaumement
dans l'ancienne Égypte : les instruments
des prêtres-embaumeurs par Francis
Janot 1998 et dans ce pdf page 14 un
extrait d'un livre de Leca (Ange-Pierre Leca, Les momies, p.54).
• Une rue de tombeaux a Saqqarah,
par Jean
Capart Ed. Vromant & Cie 1907 TDM  tome 1 (massage
et pédicure) et TDM tome 1 (massage
et pédicure) et TDM  tome 2 (planches de
pédicure n° LXVII (67) tome 2 (planches de
pédicure n° LXVII (67)  ) )
• Estradère, Du massage
de 1863 TDM  page 11,
« D'après Alpinus, les Égyptiens se servaient aussi du massage. » voir aussi p. 46/47.
page 11,
« D'après Alpinus, les Égyptiens se servaient aussi du massage. » voir aussi p. 46/47.
• Alpinus De Medicina
Egyptiorum 1591 TDM  pages
11,
25, 27 et 47 pages
11,
25, 27 et 47
•
Claude-Étienne
Savary,
Lettres sur l’Égypte de 1785 en 3 volumes TDM 
• Abdeker,
1754 (article : un
massage égyptien ?)
•
Sydney-Hervé Aufrère, Thot Hermès
l'Egyptien : De l'infiniment grand à l'infiniment petit,
éditions L'Harmattan, Collection KUBABA, Série Antiquité
XIII, Paris, 2007.
Peret
en ouân, (baies
de genévrier). Peret c'est la sortie, c'est-à-dire la germination
et ouân c'est le genévrier  .
L'huile de cade (sefetj
per em ouân) issue du genévrier
qui rentrent dans l'onguent précieux (merehet chepeset) &
l'onguent de minéral divin (merehet
net aât netjeret) du
Rituel de l'Embaumement. .
L'huile de cade (sefetj
per em ouân) issue du genévrier
qui rentrent dans l'onguent précieux (merehet chepeset) &
l'onguent de minéral divin (merehet
net aât netjeret) du
Rituel de l'Embaumement.
Phallus, (Dico d'anatomie)
D53  b b  /mt. [bAH]
mais Bardinet p. 64 dit que phallus ne s'est jamais désigné
sous le terme de mt. Voir testicule. /mt. [bAH]
mais Bardinet p. 64 dit que phallus ne s'est jamais désigné
sous le terme de mt. Voir testicule.
       
D52
D52A
D281 D282
D380
D390 D410
D410A
Pied ou
jambe, [consonne] translittération
b [correspond au son b] Code Gardiner translittération
b [correspond au son b] Code Gardiner  : D58. : D58.
Placenta,
JEAN, LOYRETTE 2010 TDM  p. 329 "En
ce qui le concerne, le placenta correspondant pour les Égyptiens
au sang non encore utilisé pour la confection de la chair
de l’embryon, voir encore le pRam. IV, C 17-18 (JEAN, LOYRETTE,
dans ERUV II, 2001, p. 561-563)." p. 329 "En
ce qui le concerne, le placenta correspondant pour les Égyptiens
au sang non encore utilisé pour la confection de la chair
de l’embryon, voir encore le pRam. IV, C 17-18 (JEAN, LOYRETTE,
dans ERUV II, 2001, p. 561-563)."
Plan
d'édifice, [consonne] translittération
h aspiré représente le plan d'une maison. [Le
h en égyptien dispose de quatre formes (h1, h2,
h3,
h4),
celui-ci correspond au son h du hot anglais], il dispose
du code Gardiner translittération
h aspiré représente le plan d'une maison. [Le
h en égyptien dispose de quatre formes (h1, h2,
h3,
h4),
celui-ci correspond au son h du hot anglais], il dispose
du code Gardiner  : O4. : O4.
Pot
(vase),  (ind. D12,N33,Y24)
avec pour code Gardiner (ind. D12,N33,Y24)
avec pour code Gardiner  : W24 ; bilitère tranlitéré : nw (nous). Signification
: pot, vase, mesure, tributs, bière, liquides, boisson, ivresse,
oindre. Ce hiéroglyphe
servira à écrire le mot mais aussi friction : W24 ; bilitère tranlitéré : nw (nous). Signification
: pot, vase, mesure, tributs, bière, liquides, boisson, ivresse,
oindre. Ce hiéroglyphe
servira à écrire le mot mais aussi friction tel que l'indique
Jean/Loyrette, Éd. L'harmattan 2010 TDM tel que l'indique
Jean/Loyrette, Éd. L'harmattan 2010 TDM  (Chapitre
XX) 20.1.1. p. 323) pEbers 808. 95, 1-3 mais aussi le massage associé à Z2 {Bardinet
TDM (Chapitre
XX) 20.1.1. p. 323) pEbers 808. 95, 1-3 mais aussi le massage associé à Z2 {Bardinet
TDM  p. 72 - fig. 22}. p. 72 - fig. 22}.
Pot à anse,  (gr.W22)
W23.
Signification : pot, vase, mesure, tributs, bière, liquides, boisson,
ivresse, oindre. (gr.W22)
W23.
Signification : pot, vase, mesure, tributs, bière, liquides, boisson,
ivresse, oindre.
Ptahshepses,
 (Égypte)
masso-personnage développée
dans le Dico
des noms propres. (Égypte)
masso-personnage développée
dans le Dico
des noms propres.
Pubis, pubis féminin
 m.t. p. 170. m.t. p. 170.
Q
Lettre
Q
R
Lettre
R
Roseau, [semi-consonne
bilitère]  appelé : yod appelé : yod  , tranlitéré , tranlitéré  eng. ou J Fr. &Germ.
M17 prononcé "ieux" comme yacht. Le double
roseau dit double yod tranlitéré y. Même prononciation.
Signification : homme, humain, [je]. eng. ou J Fr. &Germ.
M17 prononcé "ieux" comme yacht. Le double
roseau dit double yod tranlitéré y. Même prononciation.
Signification : homme, humain, [je].
Remet,
désigne communément les « hommes »
et le terme netjerou  les « dieux ».
Sert aussi pour désigner : les homme(s), les humains, les
mortels, l'humanité, les gens, les personnes, le personnel. les « dieux ».
Sert aussi pour désigner : les homme(s), les humains, les
mortels, l'humanité, les gens, les personnes, le personnel.
Ro,
à translittérer
'r(3)' prononcer " rA ") correspond donc à un volume,
à une unité de mesure égyptienne, soit une
fraction correspondant pour nous à 0,060 litre (0,0600625).
Par exemple, une mesure jp.t (lire " oïpé "),
comprend 320 r(3) = 320 parties (pour nous : 320 partie de 19,22
litre). Les fractions de "l'œil d'Horus" se déclinent aussi en parties r(3).
Dans Un massage obstétrical en Égypte
entre la XVIIe et VIe dynastie chez Edwin SMITH (1822-1906),
par Alain Cabello-Mosnier,
10/07/2018 nous retrouvons cette valeur associée
à une préparation destinée à un massage
vaginal XX,
15c, section I (Plante-ouam,
20 ro, huile 1/8 ro, bière douce 40 ro,).
S
Lettre
S
Saqqarah,   (site d'Égypte)
importante nécropole ayant lien avec
le massage mais voir dans
le Dico des noms propres.
Abydos en est un autre, où se trouvait le tombeau
d'Osiris, le dieu principal des morts, (site d'Égypte)
importante nécropole ayant lien avec
le massage mais voir dans
le Dico des noms propres.
Abydos en est un autre, où se trouvait le tombeau
d'Osiris, le dieu principal des morts,
Sang, (snfw). Le sang est
un liant, il fabrique le fœtus dans le ventre maternelle, transforme
la nourriture en chair, cicatrise, mais lorsqu'il est freiné
dans son circuit naturel et fait enfler la partie, particulièrement
dans le cas de blessures, il se retourne alors contre le corps et
le ronge sous l'emprise du malin comme en témoigne la présence
de pus réputé dévoreur de chair. Ce sang vicié
apporte de la vermine et doit être stoppé. {Bardinet
p. 37 TDM  }. }.
Saou,
magicien qui chargeait les amulettes (également appelée
Sa) de pouvoirs magiques afin que les dieux mais aussi les défunts
mal intentionnés qui revenaient de l'au-delà.
Scribe,
s'appelait zakhau, en égyptien c'est-à-dire
"celui qui utilise le pinceau".
Sefetj, goudron
végétal, voir (Mennen)
Sein,  JEAN, LOYRETTE 2010 TDM JEAN, LOYRETTE 2010 TDM  p.
293 (i) = mn:n Y5:N35-D:D27-F51:Z1 p.
293 (i) = mn:n Y5:N35-D:D27-F51:Z1
Siège, [consonne unilitère] translittération
p [correspond au son p] Code Gardiner translittération
p [correspond au son p] Code Gardiner  : :
Sounou,
médecin-magicien
d'Égypte
Sperme,
semence
masculine
(mtw.t, mwy, mw) est
considérée par les Égyptiens comme constitutive
de la matière
osseuse.
Nous avons aussi ce témoignage dans {Bardinet
p. 34 TDM  } avec
la mère d'Horus, Isis la magicienne,
recueillant le sperme de son fils et le répandant sur les laitues
que mange le Seth tous les matins pour se calmer incorporant ainsi
sans le savoir la semence de son rival. } avec
la mère d'Horus, Isis la magicienne,
recueillant le sperme de son fils et le répandant sur les laitues
que mange le Seth tous les matins pour se calmer incorporant ainsi
sans le savoir la semence de son rival.
Seth,  (Égypte)
mais entrée développée dans le Dico
des noms propres. Voir aussi ses dieux
maléphiques. (Égypte)
mais entrée développée dans le Dico
des noms propres. Voir aussi ses dieux
maléphiques.
Sueur,
"fdyt"
Support de jarre, [consonne] tranlitéré g de grenouille, code
Gardiner [consonne] tranlitéré g de grenouille, code
Gardiner  : W12. : W12.
T
Lettre
T
Tablette
d'offrandes pour les sept huiles sacrées,
Testicule, (Dico d'anatomie)
hrwy [Xrwy] D283 D283 D284 D284 D411. Dans À propos des instruments médico-chirurgicaux
métalliques égyptiens...,
par R.-A.
JEAN, Éd. Cybele, Paris, 2012 TDM D411. Dans À propos des instruments médico-chirurgicaux
métalliques égyptiens...,
par R.-A.
JEAN, Éd. Cybele, Paris, 2012 TDM  p. 11, on parlera
des « deux metou pour les deux testicules, ce sont eux qui donnent la semence. » - il s'agit
des canaux déférents. p. 12. p. 11, on parlera
des « deux metou pour les deux testicules, ce sont eux qui donnent la semence. » - il s'agit
des canaux déférents. p. 12.
Téti,   (Pharaon d'Égypte)
Roi fondateur mais voir dans le Dico
des noms propres. (Pharaon d'Égypte)
Roi fondateur mais voir dans le Dico
des noms propres.
Tjaty,  vizir vizir
 égyptien mais voir dans le Dico
des noms propres.
égyptien mais voir dans le Dico
des noms propres.
Transpirer, action de suer. JEAN, LOYRETTE 2010 TDM  p. 325 "Il s'agit probablement d'un superlatif de p. 325 "Il s'agit probablement d'un superlatif de / / b b jw "mouiller" ((pSmith 7. 3,19, glose D, en
parlant de la sueur qui « dégouline »), c’est-à-dire
ici : « répartir b jw "mouiller" ((pSmith 7. 3,19, glose D, en
parlant de la sueur qui « dégouline »), c’est-à-dire
ici : « répartir b b b (un liquide) en arrosant baba c’est-à-dire en
« l’inondant »." (un liquide) en arrosant baba c’est-à-dire en
« l’inondant »."
U
Lettre
U
V
Lettre
V
Vase, voir pot.
Ventre de vache (pis et queue), [consonne unilitère] translittération translittération
 (kh)
[Le h en égyptien dispose de quatre formes (h1, h2, h3, h4), celui-ci correspond
au son [ç] comme dans l'allemand ich], on lui donne le code X mais celui de Gardiner (kh)
[Le h en égyptien dispose de quatre formes (h1, h2, h3, h4), celui-ci correspond
au son [ç] comme dans l'allemand ich], on lui donne le code X mais celui de Gardiner  est
: F32. est
: F32.
Vêtement
plié, [consonne unilitère] tranlitéré
s ou tranlitéré
s ou  , codage IFAO , codage IFAO  s/z S29. s/z S29.
Verrou, tranlitéré
Z/S [correspond
au son s et au pronom elle] son code Gardiner tranlitéré
Z/S [correspond
au son s et au pronom elle] son code Gardiner  est
: O34 (var.Aa8). Associé à la côte animale
Aa15 cela nous donne oindre est
: O34 (var.Aa8). Associé à la côte animale
Aa15 cela nous donne oindre . Dans le pLouvre n° E 32847
{Bardinet TDM . Dans le pLouvre n° E 32847
{Bardinet TDM  p. 82, Fig. 27} D21:O34 forment le cadrat p. 82, Fig. 27} D21:O34 forment le cadrat avec la bouche D21posée sur le verrou, O34. avec la bouche D21posée sur le verrou, O34.
Vipère (à corne), parfois associé
au malin tant elle était dangereuse. [consonne] translittération f [correspond au son f et
au pronom il]
Code Gardiner translittération f [correspond au son f et
au pronom il]
Code Gardiner  :
I9. Ajouté au pain ça donnera it (père). :
I9. Ajouté au pain ça donnera it (père).
Visage, (Ìr), faciès
( mnƒ.t )  . .
W
Lettre
W
X
Lettre
X
Y
Lettre
Y
Z
Lettre
Z1, ce n'est
pas un signe
à proprement parler mais il s'ajoute parfois pour signifier
le sens réel, littérale du signe hiéroglyphique
correspondant. Le
principe de la classification c'est d'accorder à chaque
glyphe un code qui lui est propre et s'il correspond par exemple
à un bonhomme et que son code est suivit de ce signe Z1, cela équivaudra à
ne pas chercher un autre sens métaphorique mais qu'il s'agit vraiment d'un bonhomme
comme un "fils"
(garçon).
Zaou,
magicien ayant des fonctions de médecins.
Zjn,
voir sjn, verbe « frotter ».
Zounou, (swnw),
forme la plus commune de médecin. JEAN
À propos des instruments médico-chirurgicaux
métalliques égyptiens...,
Éd. Cybele, Paris, 2012 TDM  p. 34. voir aussi "Grand de la chair" our aâ
ou. p. 34. voir aussi "Grand de la chair" our aâ
ou. |
|
![]() Département
d'égyptologie du CFDRM Livres
de la bibliothèque > Dictionnaire
interne de hiéroglyphes du CFDRM
Département
d'égyptologie du CFDRM Livres
de la bibliothèque > Dictionnaire
interne de hiéroglyphes du CFDRM